
La ville contre la cour
265
LE SIÈCLE DES LUMIÈRES
L
umières en France, Enlightenment en Angleterre,
Aufklärung, en Allemagne, les lumières désignent le
pouvoir d’intelligibilité de la raison humaine, la raison
naturelle ; et en même temps que l’on met en évidence le pouvoir
judicatoire que recèle la raison et l’étendue de son domaine de
juridiction, on a confiance que par la seule force de la raison critique,
les ténèbres de l’ignorance et de la superstition, du fanatisme et du
dogmatisme, du despotisme et de la tyrannie vont reculer et
disparaître.
L’esprit de liberté qu’attisent tous les philosophes du siècle, de
Montesquieu à Kant en passant par les Encyclopédistes et
l’inclassable Rousseau, triomphe enfin concrètement : l’ancien régime
Gravure frontispice de l’Encyclopédie

Les grandes figures du monde moderne
266
s’effondre, le siècle se termine par la Déclaration d’indépendance des
États-Unis, la Révolution française et l’avènement de l’État de droit.
Le régime nouveau se prépare à assurer à toute l’humanité cette
liberté, cette égalité civile, cette propriété inviolable et sacrée, cette
souveraineté de la nation pour lesquelles on avait combattu
dogmatisme et autorité et fait la guerre à tous les discours, à toutes
les pratiques faisant obstacle au progrès de l’humanité, donc à son
bonheur.
Dans la civilisation européenne, la Déclaration des droits
devient le nouvel évangile. Malgré la défaite de la France et la
chute de la première République dont le souvenir demeure malgré
tout comme une légende et une prophétie, la face du monde reste
changée. Un monde nouveau se lève qui prépare et annonce le nôtre.
« C’est bien du XVIII
e
siècle que nous sommes les descendants
directs ».
Josiane Boulad-Ayoub

La ville contre la cour
267
CHAPITRE 14
LA VILLE CONTRE LA COUR
SAPERE AUDE
L
e XVIII
e
siècle, ce siècle plein d’allant et de résolution,
s’est appelé lui-même le siècle des Lumières.
Ces lumières sont tout bonnement les lumières de la raison
que l’esprit libre s’applique à propager partout, les lumières de la
philosophie et des sciences, les forces de la vérité et du progrès qui
viendront à bout du mal et de l’erreur, comme le proclame le programme
optimiste de ses militants.
Ainsi l’homme sera délivré de toutes les chaînes qui le retiennent
prisonnier et qui l’empêchent de se réaliser en tant qu’homme, c’est-à-
dire comme enfant de la raison et fils libre de la nature.
Siècle par excellence de révolutions, intellectuelle, politique et sociale,
le dix-huitième siècle s’ouvre par les
Principia de Newton, voit naître
et s’établir une nouvelle théorie de la connaissance (Hume, Condillac),
une nouvelle morale (Helvétius, d’Holbach, Diderot), une nouvelle
politique (Rousseau), hostiles à toutes les formes de métaphysique, de
dogmatisme et de tyrannie, de superstition et de fanatisme.
C’est l’époque où se créent les académies, les revues scientifiques, où
le français remplace le latin. La recherche est orientée vers l’utile et
l’amélioration de la santé humaine. Le progrès scientifique et technique
fait des pas de géant en mathématiques, physique, astronomie, chimie,
sciences naturelles pendant que commencent à se former les sciences
de l’Homme selon les principes essentiels du déterminisme et de la
relativité avec, comme procédés, l’observation des faits et le
raisonnement expérimental : anthropologie, sciences naturelles
(Buffon), chimie (Lavoisier) érudition, sociologie (Montesquieu),
économie politique (Smith, Physiocrates), histoire (Voltaire,
Condorcet), droit (Montesquieu, Beccaria), éducation (
Encyclopédie).
Même les voyages sont entrepris moins pour des motifs intéressés que
par souci de recherche scientifique.
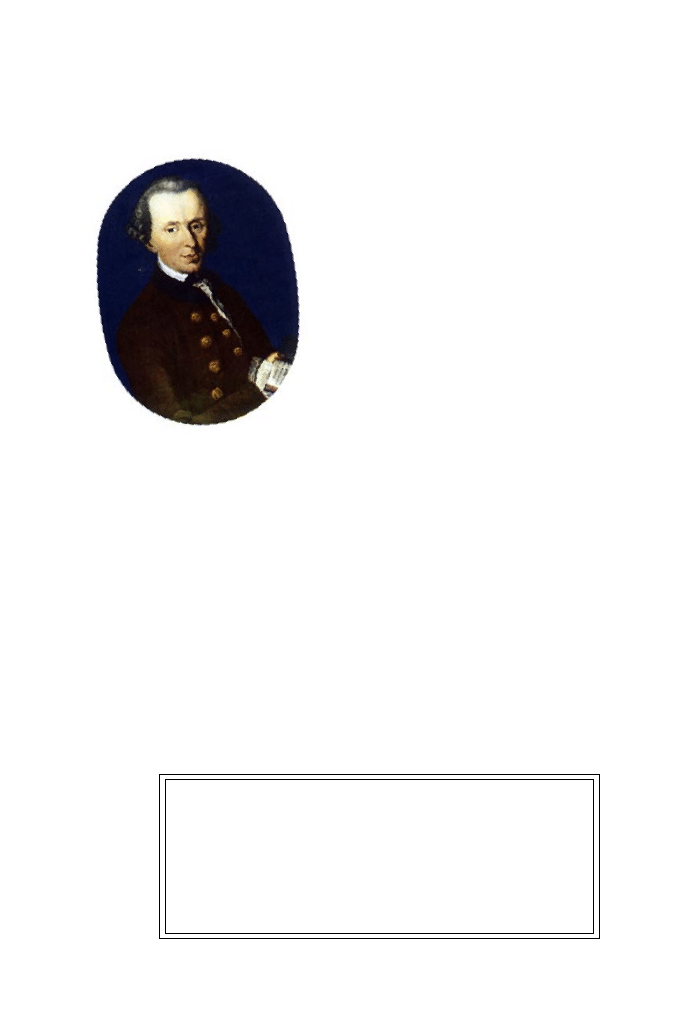
Les grandes figures du monde moderne
268
Emmanuel Kant (1724-1804)
Kant, le plus grand philosophe du siècle, définit l’
Aufklärung
comme la sortie de l’homme de sa minorité, minorité dont il est lui-
même responsable.
Minorité, c’est-à-dire incapa-
cité de se servir de son entendement
sans la direction d’autrui.
Sapere aude ! dit-il, Aie le
courage de te servir de ton propre
entendement.
Cette devise des Lumières tra-
duit un optimisme pédagogique
fondé sur deux principes ambitieux :
l’intelligibilité de la nature et la
perfectibilité de l’homme.
La vraie profession de foi des
Lumières, de l’
Enlightenment, de
l’
Aufklärung est bien celle-ci : « Aie la raison pour guide, la culture pour
base et le progrès pour but ».
Le dix-huitième siècle, tout en continuant les travaux commencés
au siècle précédent, tout en suivant des principes déjà posés, tout en
poursuivant certaines directions déjà indiquées, ce sont là les grands
points de continuité à partir desquels s’engage le combat des Lumières,
le dix-huitième siècle donc entreprend d’aller au-delà des déplacements
opérés par le Grand Siècle.
Les sciences qui se développent prodigieusement et qui finiront
par former un édifice complet couronné par les sciences sociales, le
progrès indéniable des connaissances, développent la foi en un progrès
continu de l’humanité vers un état supérieur. Aussi les Lumières sont-
elles résolues à changer, dans un esprit résolument scientifique, les
façons de penser et, en même temps, la société et la vie.
Le dix-septième siècle s’est achevé dans un tourbillon d’idées mais aussi
dans une atmosphère de conflit généralisée. La crise est à son comble :
crise des idées politiques et sociales, guerres et crises des États, crise
des idées et des sentiments où s’affrontent newtoniens et cartésiens...
Pourtant ne doit-il pas sa fécondité en grande partie à ses crises ? Dans
sa poursuite des remèdes contre celles-ci, dans sa lutte contre les forces
de dissociation et de destruction, l’homme multipliait ses inventions
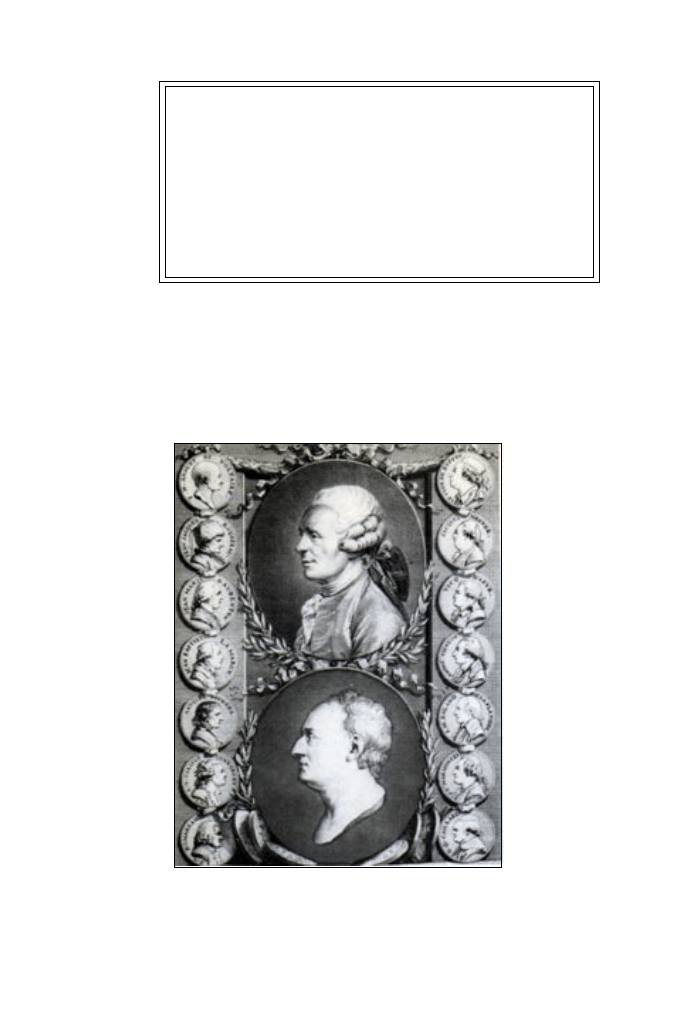
La ville contre la cour
269
dans tous les domaines et se dépassait. Nations et individus, tout en
s’affrontant et rivalisant, accentuaient leurs caractères propres, leurs
créations particulières, les échangeaient, s’éveillaient par comparaison
à des créations nouvelles et les multipliaient.
L’homme du dix-septième siècle pense et agit en homme libre, en
conquérant, en découvreur, et c’est cette liberté relative de la pensée
et de l’action, cet individualisme qui lui donnent son pouvoir, son esprit
de conquête et sa grandeur. C’est sur cet arrière-fond que le dix-
huitième siècle engagera ses révolutions.
Les Lumières font cependant davantage que parachever le
mouvement commencé au siècle précédent. Elles ne se contentent pas
d’ébranler les principes sur lesquels s’appuyaient les forces rétrogrades
mais entreprennent systématiquement de les détruire.
Les maîtres d’œuvre de l’Encyclopédie, et, en médaillon, les collaborateurs
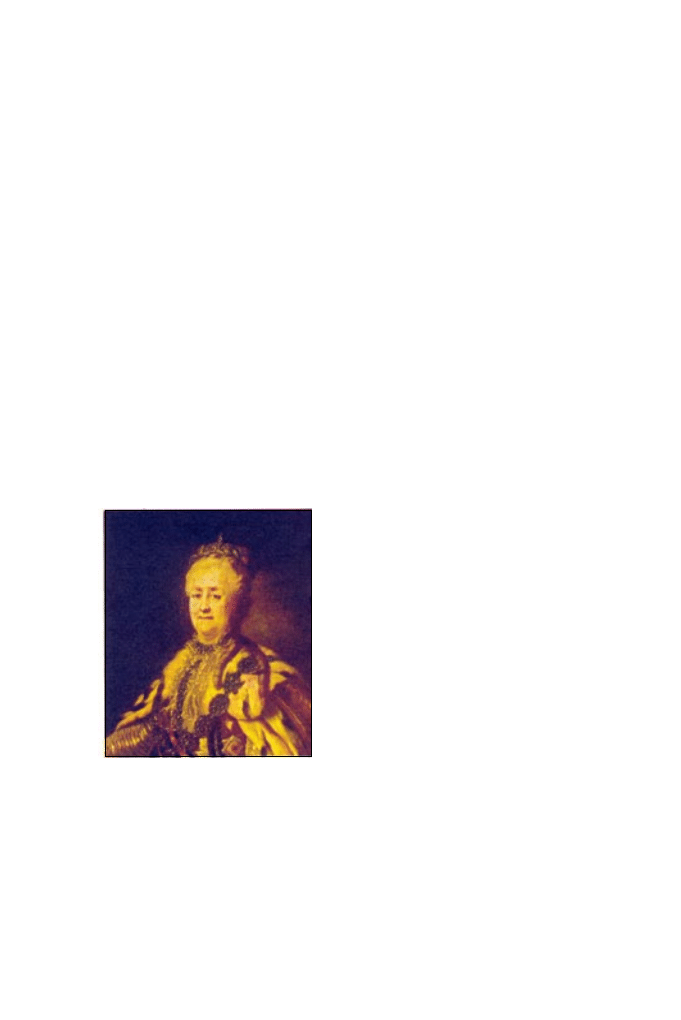
Les grandes figures du monde moderne
270
L’esprit général qui le caractérise, pour reprendre les mots du grand
Diderot, est l’esprit de liberté qui souffle partout. Pensons au combat
des lumières contre la nuit tel que le met en scène le plus grand musicien
de l’époque, Mozart, dans
La Flûte enchantée.
La rationalité nouvelle, dans ses combats menés au nom de la
raison, entre en lutte contre le cartésianisme, au nom du cartésianisme
même, ne gardant de Descartes que sa méthode de doute et de libre
examen qu’on applique à la société. Si ce siècle, sur le plan strictement
scientifique, est pour Newton et Locke, ils admirent Descartes dont le
génie, comme dit Condorcet, ouvre un nouvel âge de l’humanité en
imprimant aux esprits cette impulsion générale, premier principe d’une
révolution dans les destinées de l’espèce humaine. Et d’Alembert dans
la préface de
l’Encyclopédie, le symbole du siècle, voit dans la révolte
cartésienne contre la scolastique, l’opinion, l’autorité, les préjugés, un
service essentiel rendu à la philosophie dont les Lumières recueillent
maintenant les fruits : « Les armes dont nous nous servons pour le
combattre ne lui en appartiennent pas moins parce que nous les
tournons contre lui ».
Catherine II vue par l’ambassadeur
d’Angleterre (1778)
L’impératrice a d’un homme la force de
caractère, l’obstination dans la poursuite de ses
plans et l’intrépidité dans leur exécution mais
il lui manque les vertus les plus viriles de la
délibération, de la patience dans la prospérité,
de l’acuité du jugement, alors qu’elle possède à
un haut degré les faiblesses ordinairement
attribuées à son sexe – l’amour de la flatterie et
son inséparable compagnon, la vanité, le
dédain des conseils déplaisants, mais
salutaires, et une propension à la volupté, qui
la conduit à des excès...
Catherine II, 1762-1796,
la « Sémiramis du Nord »
Le dix-huitième siècle est aussi un siècle de transformations
économiques avec les débuts de l’industrie et la révolution agricole.
Une révolution démographique l’accompagne car le recul de la mortalité
permet une croissance de la population, et un recul des crises de
subsistance.

La ville contre la cour
271
Si le dix-septième siècle avait vu triompher le système de la
réglementation avec les manufactures d’État, les compagnies de
commerce privilégiées et le renforcement des corporations, les
physiocrates du dix-huitième siècle préconisent la liberté économique
que Gournay, leur chef de file, résume dans une formule célèbre :
« Laissez faire, laissez passer ».
Dans toute l’Europe, l’accroissement de la circulation de l’or et
de l’argent, l’augmentation du nombre d’hommes, l’essor du commerce
et l’essor colonial, l’intensification des échanges avec les pays d’outre-
mer font monter les prix réels, ouvrant des débouchés, multipliant les
profits. Partout les villes se gonflent (
l’air de la ville rend libre, dit Kant),
la bourgeoisie croit en nombre et en puissance, devenant la classe
essentielle tout en améliorant sa situation civile et politique.
C’est aussi, sauf en France, l’époque du despotisme éclairé dont
Frédéric II de Prusse est le modèle avec Catherine II de Russie et
Joseph II d’Autriche : le roi doit être philosophe, c’est-à-dire conduire
par la raison, adopter les valeurs de tolérance, de bienfaisance,
encourager les savants et les arts.
Frédéric II de Prusse, 1740-1786, le roi-philosophe
D’Alembert peut
écrire à Frédéric II :
« Les philosophes et
les gens de lettres de
toutes les nations, et en
particulier de la nation
française, vous regardent
depuis longtemps comme
leur chef et leur modèle ».

Les grandes figures du monde moderne
272
RAISON, TOLÉRANCE, HUMANITÉ
P
renant enfin pour cri de guerre : raison, tolérance,
humanité... une nouvelle figure monte à l’horizon, celle du
philosophe, une sorte d’intellectuel engagé, en qui se résume
l’idéal des Lumières.
Auteur de la doctrine du
« despotisme éclairé », Joseph
II, fils de la grande Marie-
Thérèse, est un prince cultivé,
intelligent et plein de bonnes
intentions.
Il accorde dès 1781 un Édit de
tolérance accordant la liberté de
culte aux protestants et aux
orthodoxes et leur permettant
l’accès à tous les emplois.
Il écrit à ce propos : « J’ai fait
de la philosophie la législatrice
de mon Empire. Ses
applications logiques vont
transformer l’Autriche »
Homme à principes, Joseph II résume son programme, dans une de
ses
Lettres :
Je me suis résolu dès le début de mon règne d’orner ma couronne de l’amour de
mon peuple, d ’agir dans l ’administration des affaires selon la justice,
l’impartialité et les vues les plus libérales ; c’est pourquoi j’ai proclamé l’Édit de
tolérance levant le joug qui opprimait les protestants depuis des siècles.
Le fanatisme ne sera désormais connu dans mes états que par le mépris qu’on
doit éprouver à son endroit ; personne ne sera plus persécuté en raison de ses
croyances ; dorénavant aucun homme ne sera contraint de professer la religion
de l’État si elle est contraire à sa foi.
Joseph II d’Autriche, 1765-1790
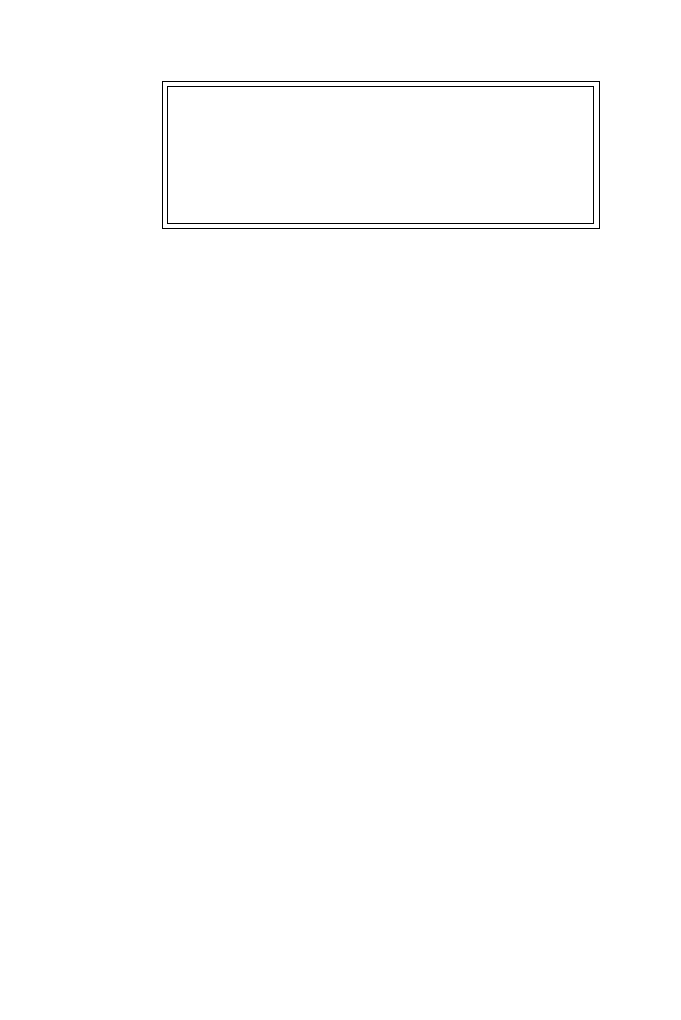
La ville contre la cour
273
La tolérance est l’effet heureux du progrès des Lumières qui éclairent maintenant
l’Europe tout entière et que l’on doit à la philosophie et aux efforts de ces grands
hommes ; elle donne une preuve indubitable de la perfectibilité de l’esprit
humain qui a su frayer audacieusement sa voie en dépit du frein de la
superstition [...] une voie qui heureusement pour le genre humain est désormais
fréquentée par les monarques (trad. J. Boulad-Ayoub).
Au dix-huitième siècle, personnes cultivées et écrivains relèvent
tous, plus ou moins, comme adeptes ou comme adversaires, de l’esprit
philosophique. Ceux qui le possèdent au plus haut degré et contribuent
le plus à sa diffusion revendiquent le titre de « philosophes ». Définir le
philosophe, c’est donc caractériser avec cette notion capitale l’esprit
général du dix-huitième siècle, cet esprit philosophique qui anime les
pensées et le comportement à l’époque.
L’article « philosophe » dans l’
Encyclopédie en fixe les traits.
Longtemps attribué à Diderot, le texte est en fait de Dumarsais, un
grammairien très radical. Il développe avec beaucoup de clarté la
conception du philosophe, pensant et agissant selon la raison, sociable
et humain tel que l’entendait en général le dix-huitième siècle. Ce texte
montre aussi les oppositions fondamentales dans la société de l’époque
entre foi et raison dont le parti des philosophes se fait le propagandiste,
et monte bien en épingle le souci caractéristique de l’utile et du mieux-
être social.
Les autres hommes sont déterminés à agir sans sentir ni connaître les
causes qui les font mouvoir, sans même songer qu’il y en ait. Le
philosophe, au contraire, démêle les causes autant qu’il est en lui, et
souvent même les prévient, et se livre à elles avec connaissance : c’est
une horloge qui se monte, pour ainsi dire, quelquefois elle-même [...].
La raison est à l’égard du philosophe ce que la grâce est à l’égard du
chrétien. La grâce détermine le chrétien à agir, la raison détermine le
philosophe [...].
De cette connaissance que les principes ne naissent que des ob-
servations particulières, le philosophe en conçoit de l’estime pour la
science des faits. [...] ainsi, il regarde comme une maxime très opposée
aux progrès des lumières de l’esprit que de se borner à la seule
méditation et de croire que l’homme ne tire la vérité que de son propre
fond [...].
L’esprit philosophique est donc un esprit d’observation et de justesse,
qui rapporte tout à ses véritables principes, mais ce n’est pas l’esprit
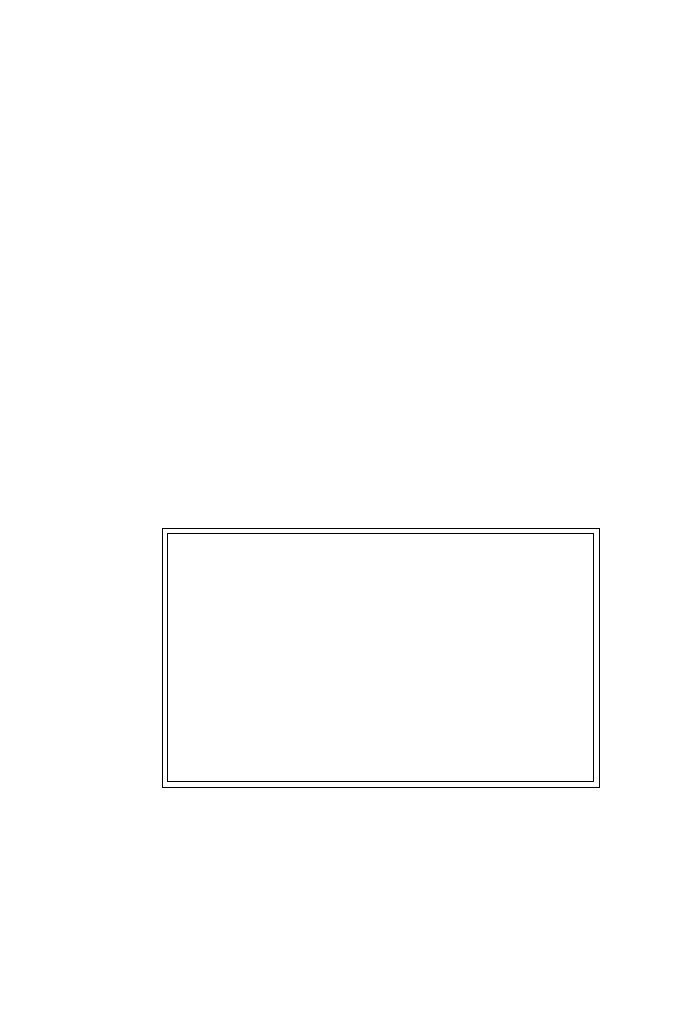
Les grandes figures du monde moderne
274
seul que le philosophe cultive, il porte plus loin son attention et ses
soins.
L’homme n’est point un monstre qui ne doive vivre que dans les abîmes
de la mer ou au fond d’une forêt ; les seules nécessités de la vie lui
rendent le commerce des autres nécessaire ; et dans quelque État où il
se puisse trouver, ses besoins et le bien-être l’engagent à vivre en société.
Ainsi, la raison exige de lui qu’il étudie, et qu’il travaille à acquérir les
qualités sociales. Notre philosophe ne se croit pas en exil dans ce
monde ; il ne croit point être en pays ennemi ; il veut jouir en sage
économe des biens que la nature lui offre ; il veut trouver du plaisir
avec les autres ; et pour en trouver, il en faut faire. Ainsi il cherche à
convenir à ceux avec qui le hasard ou son choix le font vivre ; et il trouve
en même temps ce qui lui convient ; c’est un honnête homme qui veut
plaire et se rendre utile.
[...] La société civile est, pour ainsi dire, la seule divinité qu’il reconnaisse
sur la terre ; il l’encense, il l’honore par la probité, par une attention
exacte à ses devoirs, et par un désir sincère de n’en être pas un membre
inutile ou embarrassant [...].
Le vrai philosophe est donc un honnête homme qui agit en tout par
raison, et qui joint à un esprit de réflexion et de justesse, les murs et les
qualités sociales.
Tandis que le philosophe au sens traditionnel est avant tout un
spécialiste de la théorie et de l’abstraction, le philosophe du dix-
huitième siècle, c’est-à-dire, en général, tout homme éclairé, pénétré
d’esprit critique, est donc d’abord un homme pratique et soucieux de
la réalité quotidienne.
Les principes essentiels qui orientent son style de vie sous la conduite
de la raison sont : i) le souci d’être utile en exerçant des activités qui
contribuent au maintien et au progrès de la civilisation ; ii) la sociabilité
en vivant dans la cité des hommes et non dans la solitude ; ce qui donne
aux lieux habituels de réunion, clubs, salons, cafés, une influence
décisive ; iii) le cosmopolitisme en constituant, par-dessus les
frontières, une sorte d’internationale des esprits.
Tout ceci se fait non au gré du hasard mais sous l’égide de la raison
critique.
Le sourire de la raison, telle était la façon dont Carré, un
critique, définissait la philosophie de Fontenelle mais que l’on peut
étendre à tous les auteurs de l’époque.
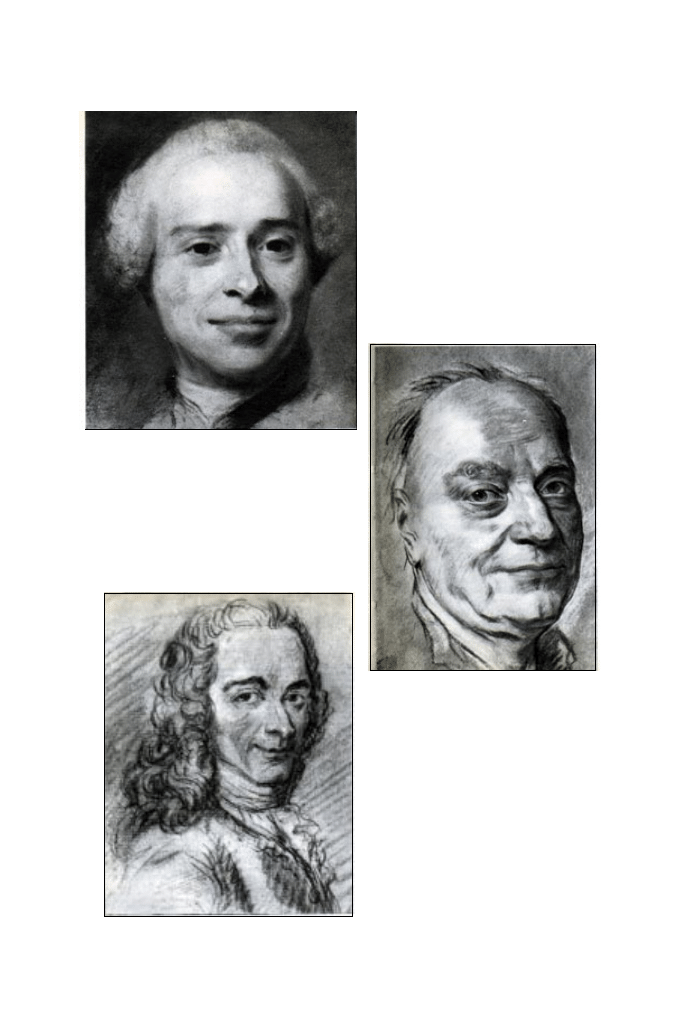
La ville contre la cour
275
Ces portraits témoignent bien de la façon dont
devait s’éclairer le regard et se nuancer le sourire
de ces philosophes :
D’Alembert, 1717-1783
Voltaire, 1694-1718
« Sous la joie de l’intelligence vive et
derrière l’esprit critique un peu désabusé
à qui rien n’échappe, vibre une riche
sensibilité et se dévoile un profond désir
de comprendre tout ce qui est humain ».
Crébillon, 1674-1762
Il est frappant de constater que ce sourire
se retrouve au dix-huitième siècle sur les
visages d’auteurs aussi différents que
Crébillon le dramaturge, Voltaire le
polémiste et l’ironiste, ou d’Alembert, le
mathématicien et le collaborateur de
l’
Encyclopédie, comme on peut le voir
sur les pastels que Quentin de La Tour
(1704-1788) a fait de ces personnages.
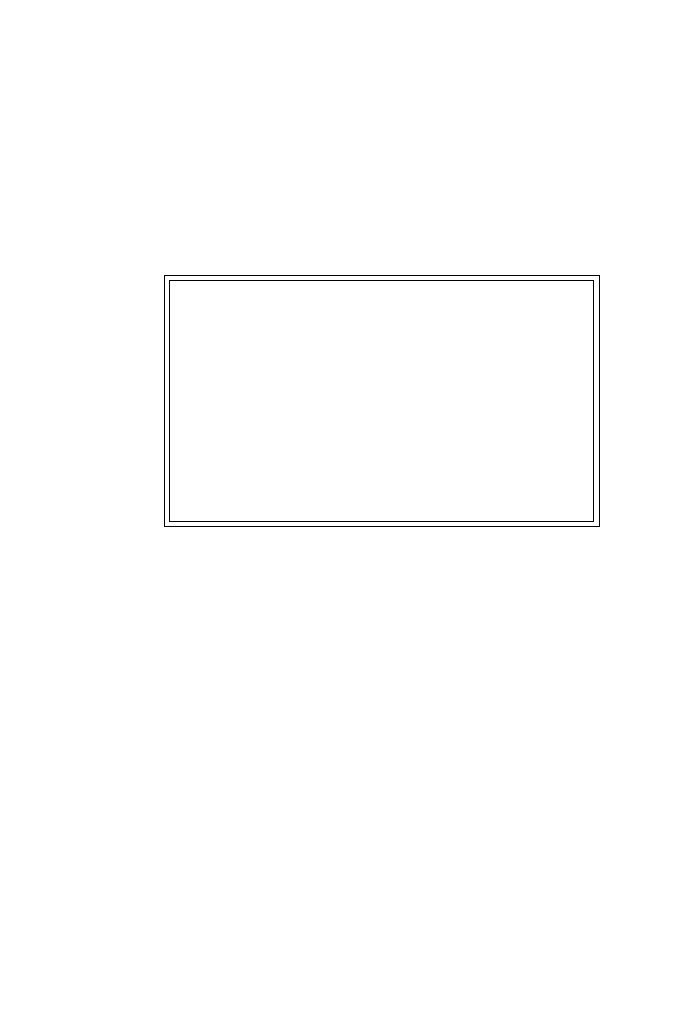
Les grandes figures du monde moderne
276
La raison, cette faculté, dont parlait déjà le dix-septième siècle de
Descartes et de Boileau, prend une signification nouvelle : elle inspire
l’esprit critique dont le droit de regard s’étend désormais à tous les
domaines, en vue de construire un monde éclairé.
Prolongeant les recherches de Descartes, de Pascal, et surtout des
libertins de la fin du siècle précédent, le philosophe s’acharne à
perfectionner les méthodes qui permettent d’atteindre à la vérité : la
critique du témoignage, notamment, est la base de tout raisonnement.
Parler du philosophe, c’est s’en tenir à une notion abstraite et
impersonnelle à laquelle chaque philosophe (Voltaire, Montesquieu,
Diderot, Rousseau, et d’autres), tout en étant des représentants de
l’esprit philosophique, a apporté sa contribution, mais qui ne s’identifie
totalement et exactement à aucun d’eux, en particulier, car chaque
philosophe est un individu concret et original développant chacun une
philosophie propre.
Aussi bien la lutte philosophique ne s’est-elle pas livrée seulement entre
les philosophes et le pouvoir, mais, à l’occasion, entre les philosophes
eux-mêmes. Ainsi d’Holbach-Diderot contre Voltaire ; Voltaire contre
Rousseau.
LA VIE DE SOCIÉTÉ AU XVIII
e
SIÈCLE ET LA
PROPAGATION DE L’ESPRIT CRITIQUE
L
e dix-huitième siècle fut avant tout un siècle d’idées
nouvelles mais ces idées ne purent se répandre que
parce que la mort de Louis XIV, en 1715, fut suivie d’un
affaiblissement de l’autorité qui provoqua une importante évolution
des mœurs.
Par réaction contre l’austérité des dernières années du règne de
Louis XIV, le goût du plaisir, du luxe et de l’argent se déchaînent sous
la Régence, c’est-à-dire durant l’époque où l’héritier du trône, Louis
XV, âgé de cinq ans à son avènement, fut suppléé dans ses pouvoirs
effectifs par le duc Régent, Philippe d’Orléans, neveu de Louis XIV.
Les hommes de lettres ne participent guère à cette richesse. La
condition des écrivains reste marquée, sur le plan matériel, par la
médiocrité et l’insécurité parce que la propriété littéraire ne fait encore
l’objet d’aucune législation et parce que la censure et les persécutions
constituent des risques très réels.
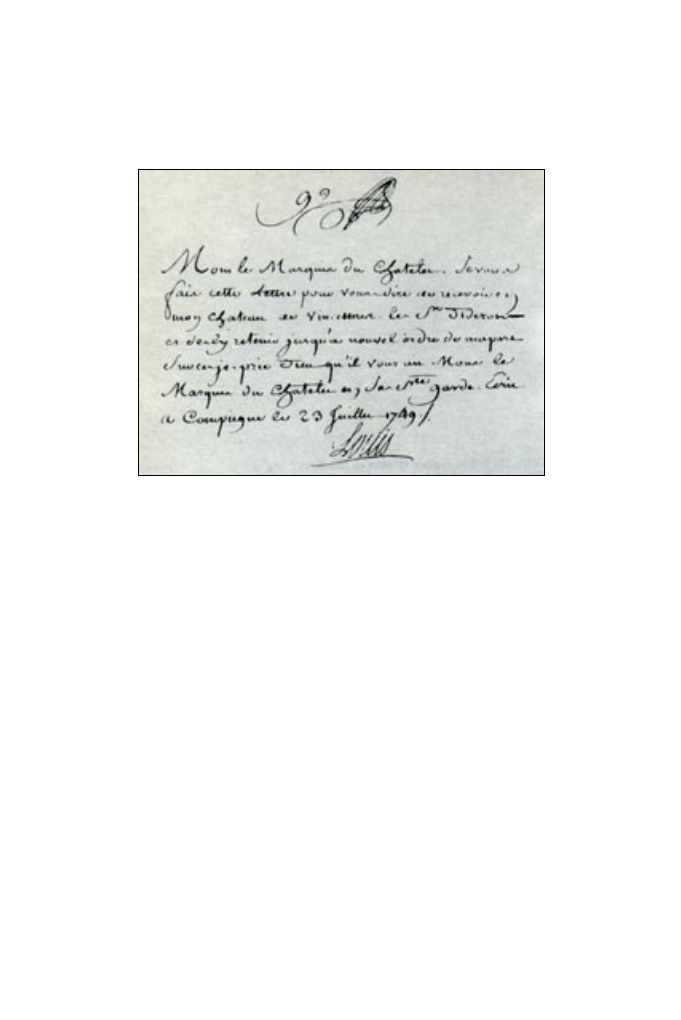
La ville contre la cour
277
En revanche, c’est l’époque de la sacralisation de l’écrivain qui
acquiert un prestige social beaucoup plus grand qu’au XVII
e
siècle.
L’écrivain devient ainsi un interprète et un véritable guide de l’opinion.
La lettre de cachet ordonnant l’emprisonnement de Diderot à Vincennes
en tant qu’auteur de la Lettre sur les aveugles
Cette situation explique pour beaucoup, puisque les hommes de
lettres ne fréquentent que très rarement la cour, l’apparition à Paris, et
dans les grandes villes, de nouveaux foyers de vie intellectuelle où les
écrivains et leur public se sentent plus libres et ont plus d’influence.
La vie de société s’épanouit principalement dans les salons, les
cafés, les clubs. Pour présenter ces centres bouillonnants de vie
intellectuelle, premiers lieux de la propagation de l’esprit philosophique
et critique, nous laissons la parole aux mémorialistes du dix-huitième
siècle qui les décrivent d’une plume alerte.
Tout d’abord les salons, ces « écoles brillantes de civilisation » selon
les mots du comte de Ségur, où l’on « trouvait [...] les littérateurs, les
philosophes les plus distingués, et cet esprit de liberté qui devait
changer la face du monde en l’éclairant ».
Il s’agit de l’institution par excellence du dix-huitième siècle. Plus
qu’ailleurs les femmes s’y sont fait leur place et parlent avec égalité avec
les plus grands hommes. Tous et toutes sont animés par un même but :
diffuser les Lumières, lutter contre l’obscurantisme, dans tous les
domaines, politique, artistique, mais aussi économique.

Les grandes figures du monde moderne
278
Chaque salon a sa spécialité, ses couleurs, si l’on préfère. Ainsi le
premier salon où l’on se réunit, dès 1699, fut tenu par la duchesse du
Louise de Bourbon-Condé (1670-1753),
duchesse du Maine.
Paul-Henry Thiry, baron d’Holbach
Maine dans son domaine de
Sceaux, célèbre surtout par l’éclat
de ses fêtes. Ce sont en majorité des
poètes qu’elle accueille.
À partir de 1710, le salon de la
marquise de Lambert, rue de Ri-
chelieu, à Paris, réunit les écrivains
et les gens de qualité qui font assaut
de jeux d’esprit.
Chez Madame de Tencin, rue
Saint-Honoré, la société est plus
nombreuse, plus mêlée, plus
cosmopolite.
C’est le premier « salon
philosophique » proprement
dit.
On y encourage les
propos brillants ou piquants,
la discussion des idées nou-
velles. Mettant à la mode les
entretiens philosophiques, ce
salon a beaucoup contribué à
la diffusion des idées
nouvelles.
Enfin au salon de
l’opulent baron d’Holbach
(1723-1789), le grand phi-
losophe matérialiste qui
soutient financièrement la
cause des Encyclopédistes,
c’est toute l’Europe intellec-
tuelle qui se retrouve autour
de sa table. Aussi Grimm le
surnommait-il plaisamment
le maître d’hôtel de l’Europe.
Voici un extrait des
Mémoires de l’abbé Morellet évoquant le salon
de d’Holbach et la figure du maître de céans.

La ville contre la cour
279
L’extrait est assez long mais on le préférera à des descriptions plus
courtes d’autres salons, en raison de la personnalité importante de
d’Holbach, l’auteur retentissant du
Système de la nature (1770), du
Système social (1773) et de la Politique naturelle (1773), entre autres
ouvrages maîtres du matérialisme des Lumières, et de l’efficacité de
son salon dans la diffusion de l’esprit philosophique, mais aussi à cause
de la vivacité avec laquelle Morellet recrée l’atmosphère de ce véritable
modèle de salon philosophique.
Mais parmi les sociétés dont mon zèle pour la cause de la philosophie
m’ouvrit l’entrée, je dois mettre au premier rang, pour l’utilité,
l’agrément et l’instruction que j’en ai retirés, celle du baron d’Holbach.
Le baron d’Holbach, que ses amis appelaient baron parce qu’il était
allemand d’origine, et qu’il avait possédé en Westphalie une petite terre,
avait environ 60 000 livres de rente, fortune que jamais personne n’a
employée plus noblement que lui, ni surtout plus utilement pour le bien
des sciences et des lettres.
Sa maison rassemblait dès lors les plus marquants des hommes de lettres
français, Diderot, J.-J. Rousseau, Helvétius [...] Raynal, Suard,
Boulanger, Marmontel, Saint-Lambert, La Condamine, le chevalier de
Chastellux, etc.
Le baron lui-même était un des hommes de son temps les plus instruits,
sachant plusieurs des langues de l’Europe, et même un peu des langues
anciennes, ayant une excellente et nombreuse bibliothèque, une riche
collection des dessins des meilleurs maîtres, d’excellents tableaux dont
il était bon juge, un cabinet d’histoire naturelle contenant des morceaux
précieux, etc. À ces avantages, il joignait une grande politesse, une égale
simplicité, un commerce facile, et une bonté visible au premier abord.
On comprend comment une société de ce genre devait être recherchée.
Aussi y voyait-on, outre les hommes que je viens de nommer, tous les
étrangers de quelque mérite et de quelque talent qui venaient à Paris ;
à Paris qui était alors, comme l’appelait Galiani, le café de l’Europe. Je
ne finirais pas si je disais tout ce que j’y ai vu d’étrangers de distinction
qui se faisaient honneur d’y être admis, Hume, Wilkes, Sterne, Galiani,
Beccaria, Caraccioli, le lord Shelburne, le comte de Creutz, Verri, Frisi,
Garrick, le prince héréditaire de Brunswick, Franklin, Priestley, le
colonel Barré, le baron Dalberg, depuis électeur de Mayence, etc.
Le baron d’Holbach avait régulièrement deux dîners par semaine, le
dimanche et le jeudi : là se rassemblaient, sans préjudice de quelques
autres jours, dix, douze, et jusqu’à quinze et vingt hommes de lettres et
gens du monde ou étrangers, qui aimaient et cultivaient même les arts
de l’esprit. Une grosse chère, mais bonne, d’excellent vin, d’excellent
café, beaucoup de dispute, jamais de querelle ; la simplicité des

Les grandes figures du monde moderne
280
manières, qui sied à des hommes raisonnables et instruits, mais qui ne
dégénérait point en grossièreté ; une gaieté vraie sans être folle : enfin
une société vraiment attachante, ce qu’on pouvait reconnaître à ce seul
symptôme, qu’arrivés à deux heures, c’était l’usage de ce temps-là, nous
y étions souvent encore presque tous à sept et huit heures du soir.
Or, c’est là qu’il fallait entendre la conversation la plus libre, la plus
animée et la plus instructive qui fût jamais : quand je dis libre, j’entends
en matière de philosophie, de religion, de gouvernement, car les
plaisanteries libres dans un autre genre en étaient bannies.
Cicéron a dit en quelque endroit qu’il n’y a point d’opinion si
extravagante qui n’ait été avancée par quelque philosophe. Je dirai de
même qu’il n’y a point de hardiesse politique et religieuse qui ne fût là
mise en avant et discutée
pro et contra, presque toujours avec beaucoup
de subtilité et de profondeur.
Souvent un seul y prenait la parole, et proposait sa théorie paisiblement
et sans être interrompu. D’autres fois, c’était un combat singulier en
forme, dont tout le reste de la société était tranquille spectateur :
manière d’écouter que je n’ai trouvée d’ailleurs que bien rarement.
C’est là que j’ai entendu Roux et Darcet exposer leur théorie de la terre ;
Marmontel, les excellents principes qu’il a rassemblés dans ses
Éléments
de littérature ; Raynal, nous dire à livres, sous et deniers le commerce
des Espagnols aux Philippines et à la Vera-Cruz, et celui de l’Angleterre
dans ses colonies ; l’ambassadeur de Naples et l’abbé Galiani, nous faire
de ces longs contes à la manière italienne, espèces de drames qu’on
écoutait jusqu’au bout ; Diderot, traiter une question de philosophie,
d’arts ou de littérature, et, par son abondance, sa faconde, son air
inspiré, captiver longtemps l’attention.
C’est là, s’il m’est permis de me citer à côté de tant d’autres hommes si
supérieurs à moi, c’est là que moi-même j’ai développé plus d’une fois
mes principes sur l’économie publique.
C’est là aussi, puisqu’il faut le dire, que Diderot, le D
r
Roux et le bon
baron lui-même établissaient dogmatiquement l’athéisme absolu, celui
du
Système de la Nature, avec une persuasion, une bonne foi, une
probité édifiante, même pour ceux d’entre nous qui, comme moi, ne
croyaient pas à leur enseignement.
Le salon de Madame Geoffrin (1699-1777), rue Saint-Honoré, était
l’un des centres de la vie parisienne.
Madame Geoffrin était la veuve d’un riche industriel, célèbre par
sa beauté et son esprit mais qui ne put être jamais reçue à la Cour, à
cause de ses origines bourgeoises.
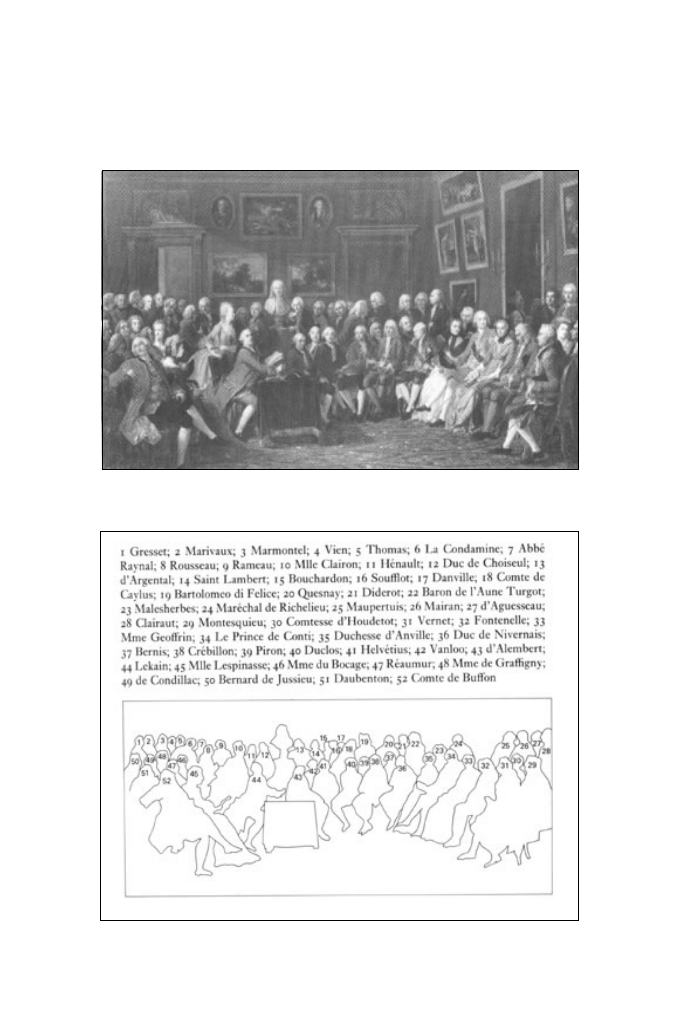
La ville contre la cour
281
Voici l’évocation tout à fait symbolique de ce salon où Lemonnier, au siècle suivant,
réunit tous les écrivains du dix-huitième siècle, écoutant la lecture de l’
Orpheline de Chine,
autour d’un buste de Voltaire. Les clés du tableau figurent immédiatement après.

Les grandes figures du monde moderne
282
Tous vantaient à l’envi son salon ; l’écrivain Jean-François
Marmontel (1723-1799) décrit l’hôtesse dans ses
Mémoires :
Assez riche pour faire de sa maison le rendez-vous des lettres et des
arts et voyant que c’était pour elle un moyen de se donner dans sa
vieillesse une amusante société et une existence honorable, Madame
Geoffrin avait fondé chez elle deux dîners. [...] elle avait le bon esprit
de ne parler jamais que de ce qu’elle savait très bien et de céder sur tout
le reste la parole à des gens instruits, toujours poliment attentive, sans
même paraître ennuyée de ce qu’elle n’entendait pas [...].
La société se retrouve aussi dans les cafés, plus démocratiques que
les salons.
Dès les débuts du règne de Louis XIV, ce breuvage commence à
connaître un succès extraordinaire.
Le premier café
s’ouvre à Marseille en
1654, à Paris en 1667. En
1715, à la mort de Louis
XIV, il y en a 300 à Paris,
dont le célèbre café Pro-
cope, ouvert en 1695, et
celui de la Régence. La
mode se répand dans le
monde de transformer
certains jours les salons
en café.
C’est au café qu’on
apprend les nouvelles,
qu’on les commente ; les
gens font cercle autour
des joueurs d’échecs ou
des « orateurs en chef »
qui président les discus-
sions.
Les grands auteurs,
Voltaire, Diderot, Fon-
tenelle, ne dédaignent
pas d’y paraître et d’y
entretenir leur publicité. C’est là qu’on peut acheter les libelles interdits
qui circulent sous le manteau, c’est là qu’on peut lire les journaux, peu

La ville contre la cour
283
répandus encore au début du siècle, mais dont la diffusion augmente :
en 1787, le « Mercure de France » se vend toutes les semaines à 15 000
exemplaires.
Voici comment, à la fin du siècle, l’écrivain Louis Sébastien Mercier
(1740-1814) dans son
Tableau de Paris, montre le rôle joué par les cafés
dans la vie politique et littéraire de l’Ancien régime :
On compte six à sept cents cafés ; c’est le refuge ordinaire des oisifs et
l’asile des indigents ; ils s’y chauffent l’hiver pour épargner le bois chez
eux. Dans quelques-uns de ces cafés, on tient bureau académique : on y
juge les auteurs, les pièces de théâtre ; on y assigne leur rang et leur
valeur ; et les poètes qui vont débuter y font ordinairement le plus de
bruit, ainsi que ceux qui, chassés de la carrière par les sifflets, deviennent
ordinairement satiriques : car le plus impitoyable des critiques est
toujours un auteur méprisé [...].
Tel homme arrive au café sur les dix heures du matin pour n’en sortir
qu’à onze heures du soir ; il dîne avec une tasse de café au lait et soupe
avec une bavaroise [...].
Chaque café a son orateur en chef ; tel, dans les faubourgs, est présidé
par un garçon tailleur ou par un garçon cordonnier ; et pourquoi pas ?
Ne faut-il pas que l’amour-propre de chaque individu soit à peu près
content ?
Les clubs, enfin, dont la vocation est nettement plus politique. Le
public est plus restreint.
Le plus célèbre est le club de l’Entresol, fondé par l’abbé Alary en
1720, une compagnie privée qui réunit une vingtaine de personnalités
de 1720 à 1731 « raisonnant hardiment mais ne concluant que
sobrement ».
Le nom de ce club
lui venait de
l’appartement en
entresol de l’hôtel
du président
Hénault, place
Vendôme, où
logeait le
fondateur du
club.

Les grandes figures du monde moderne
284
En province, dans les grandes villes, des Académies, des Sociétés
de lecture se constituaient à l’exemple de Paris.
L’un des membres du club de l’Entresol, le marquis d’Argenson,
futur ministre des Affaires étrangères, nous apprend dans ses
Mémoires
(publiés en 1823) ce qu’était la conférence, c’est-à-dire l’échange de vues,
qui s’y tenait tous les samedis, de cinq heures du soir à huit heures.
La conférence, qui durait trois heures, était divisée en trois parties assez
égales.
La première comprenait la lecture de mes extraits de gazettes, la
réponse aux questions, et la conversation curieuse sur les nouvelles
publiques, les raisonnements, les conjonctures politiques, les
éclaircissements que nous fournissaient principalement nos anciens
ambassadeurs. Nous avions toujours un grand atlas sur la table pour
suivre la position locale des événements.
La seconde heure était consacrée à suppléer par la conversation aux
nouvelles écrites. On débitait sans aucune réserve, et avec une entière
confiance, tout ce qui se disait dans le monde sur les affaires de quelque
importance. Jamais cette partie de la conférence n’a cessé d’être
soutenue et animée : car la première avait mis la curiosité et le
raisonnement dans une grande action, et l’on a toujours eu de la peine
à terminer cette causerie pour donner place au troisième exercice.
Celui-ci consistait à lire, à peu près tour à tour, et pendant une heure,
les ouvrages des académiciens sur les matières déduites ci-dessus. On
observera qu’il arrivait souvent de substituer à la lecture de nos ouvrages
les relations, qui conduisaient à notre objet, des traités conclus
récemment et que chacun s’efforçait d’avoir de la première main.
Plusieurs s’étaient ingéniés pour avoir des correspondances en pays
étrangers.
Josiane Boulad-Ayoub
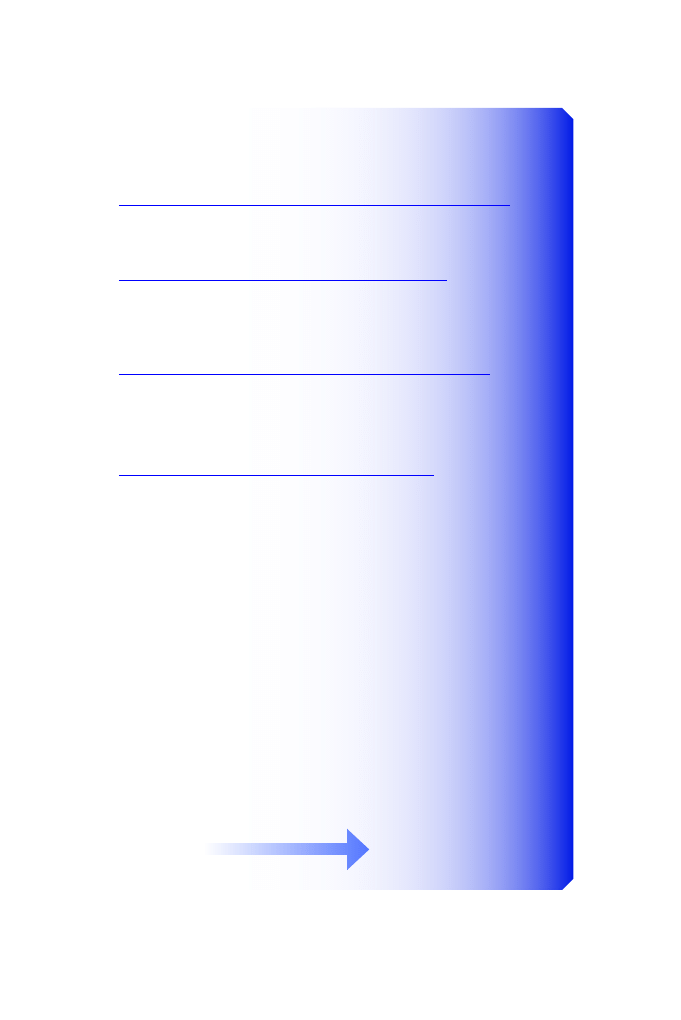
Textes Électroniques Clandestins du dix-hui-
tième siècle
http://www.vc.unipmn.it/~mori/e-texts/index_fr.htm
Eighteenth-Century Resources
http://andromeda.rutgers.edu/~jlynch/18th/
LA VICTOIRE DE L’ETAT DE DROIT
http://members.aol.com/vlib7/num14/page2.htm
Un site bibliographique consacré à la théorie
politique
Wyszukiwarka
Podobne podstrony:
Hume Essai sur l'étude de l'histoire
Fin de Siecle (Ostatni Felieton)
Fin de Siecle
Hume Essai sur l'étude de l'histoire
Richard de Bury Histoire de St Louis, Roi de France
Adolphe Thiers Histoire de la Revolution Francaise, II
Adolphe Thiers Histoire de la Revolution francaise, V
Adolphe Thiers Histoire de la Revolution française, VIII
Adolphe Thiers Histoire de la Revolution francaise, IV
Voltaire Histoire des Voyages de Scarmentado
Adolphe Thiers Histoire de la Revolution francaise, III
Adolphe Thiers Histoire de la Revolution française, IX
Adolphe Thiers Histoire de la Revolution francaise, I
Histoire et philologie de la Scandinavie ancienne et médiévale
Histoire de noeuds
Brasil Política de 1930 A 2003
TEMPETE DE GLACE
więcej podobnych podstron