
VOUK VOUTCHO
UN HOMME CHANCEUX
Récit d’un survivant
Editions de Chambre

Dédié à notre
inoubliable Cookie,
qui nous a donné mille preuves
que le vrai grand amour
s’obtient contre paiement
si on achète un chien

PREMIER ACTE
Accroupi sur le toit de la maison mortuaire, je domine le
croisement de deux parcelles du cimetière. Le tintement d’une cloche
annonce l’apparition prochaine d’un cortège funèbre. Curieusement, ce
doux matin de printemps s’accorde à merveille avec la fin d'une vie.
Soudain, un bruit sourd se fait entendre dans le ciel, un bourdonnement
de plus en plus fort qui se transforme, au-dessus de ma tête, en
rugissement. Une explosion assourdissante secoue la cime des
marronniers, dont les fleurs tombent en s’égrenant. Le souffle de la
bombe fauche une volée d’hirondelles et les précipite à terre : ce ne
sont plus que des boules de chair et de plumes hachées.
Les tympans transpercés, je sursaute, faillant dégringoler de mon
observatoire. Je ne connais que trop l’horreur qui m’entoure, je l’ai déjà
vécue, il y a longtemps. Cependant, mes souvenirs restent confus. Mon
attention est attirée par un événement qui se déroule au ras du sol, au
bord de notre tombeau familial, dont la pierre se soulève, comme sous
la pression d’une éruption souterraine. Sortant de leur fosse, éblouis par
le soleil et se frottant les yeux, mon père et mon oncle n’ont rien de
l’allure macabre des morts vivants. Ils sont vêtus de leur robe de
chambre, comme interrompus durant une paisible partie de cartes et
s’abandonnent à la colère.
« Que se passe-t-il ? s’écrie papa en français. Qui diable fout tout
ce bordel ?
- On nous bombarde ! hurle mon oncle, indigné.
- Mais qui diable nous bombarde ? crie papa. Encore ces sacrés
Allemands ?
- Les Alliés, les Américains, les Anglais, les Français !
- Nom d'un chien, arrêtez ! s'égosille papa. Nous ne sommes pas
des autochtones ! Nous sommes des Français de vieille souche ! Nés à

Lyon de parents français, petits-fils de Français, arrière-petits-fils de
Français ! »
Un obus au napalm lui coupe la parole, et les deux revenants, les
cheveux en feu, disparaissent dans une énorme rose de flammes et de
fumée noire.
_
En dépit de ces rêves mi-drôles mi-pénibles qui me hantent depuis
des semaines, je suis un homme chanceux. Grâce à la bonté de Mme
d’Alembert, j’ai pu m’en tirer et refaire surface. Aujourd'hui, jour
anniversaire de sa mort, j’ai allumé une bougie pour le repos de son
âme, une de ces chandelles en cire d’abeille que je fais brûler quatre
fois par an en souvenir de mes chers disparus.
J’ai travaillé sans répit du matin au soir. J’ai décrotté et astiqué
toutes les chaussures de M. Canac, ses bottines, brodequins et autres
mocassins. Il serait très content de les voir alignés sur la cheminée sous
son fusil de chasse. J’ai empesé et repassé le linge de table de Mme
Canac, ses nappes et serviettes, bordées de dentelles. Elle serait
heureuse de les voir rangées dans l’armoire de la salle à manger, à côté
de sa ménagère lustrée.
Parfois, je regrette leur absence et ces après-midi paisibles au
cours desquels je leur servais des babas et du thé vert dans la pièce
dite salon ouest. Même à présent, quand je dépoussière leurs bergères,
je vois se refléter sur la table haricot le visage de M. Canac, carré,
barbu et tailladé, ressemblant à s’y méprendre à son chien schnauzer,
et la petite tête de son épouse, engoncée dans un col de dentelle et
arborant un chignon haut, blanc comme la neige.
Grâce à l’appui de Mme d’Alembert, je suis serviteur chez M. et
Mme Canac. Nourri et logé dans leur grand chalet, sur le flanc est du
Praz-de-Lys, en Haute-Savoie, je suis attaché à plusieurs fonctions :
celle de valet de chambre et celle de valet de pied, celles de chauffeur,
de jardinier, de blanchisseur, de cuisinier, de sommelier et de maître
d’hôtel.
Avant de devenir leur homme à tout faire, leur homme de
confiance, j’ai dû subir quelques épreuves, les laisser juger de mes
capacités. Concernant la cuisine, informé par Mme d’Alembert de leurs
péchés mignons en matière de bonne chère, j’ai préparé pour mes

futurs maîtres leurs mets préférés : canard Montmorency aux cerises
dans sa gelée froide pour M. Canac, et crevettes poivrées au fenouil
pour Mme Canac, admiratrice de la cuisine italienne. Sommelier
débutant, armé d’un guide œnologique pour choisir les vins appropriés,
j’ai mis dans le mille en fouillant la cave de M. Canac, grand
connaisseur de vins.
« Quinze sur vingt ! » ont estimé mes futurs maîtres.
Puis j’ai conduit, dans l’épreuve du chauffeur, la vieille limousine
de monsieur Canac sur la route en lacet du pont des Gets, au Praz-de-
Lys, maîtrisant parfaitement les sept virages en épingle, sans
commettre une seule erreur, sans renverser la moindre goutte de la
coupe de champagne que mon futur maître, assis sur la banquette
arrière, tenait dans ses mains.
« Dix-sept sur vingt ! » a-t-il jugé.
S’en sont ensuivis des tests destinés à évaluer mon savoir-faire
en matière de couture (coudre une dizaine de boutons à trous et à
queue pour Mme Canac), de lingerie (repasser plusieurs de ses cols en
dentelle) et d’argenterie (astiquer douze fois douze pièces de sa
ménagère). Enfin, il a fallu jouer aux échecs avec le maître des lieux et
accepter la défaite avec humilité.
L’examen le plus difficile a été celui de l’art de dresser la table,
épreuve dirigée par Mme Canac, femme du monde, qui ignorait que
j’avais lu bon nombre de fois l’ouvrage de feu Mme d’Alembert, Voyage
autour de ma table. Elle m’a interrogé de la façon suivante : « Comment
dresser une table de déjeuner pour quatre personnes ? » J’ai répondu :
« La nappe doit pendre tout autour de la table sur une hauteur de
quarante-deux centimètres. L’intervalle qui sépare le centre de deux
assiettes plates doit être au minimum de soixante centimètres. Autour
de ces assiettes plates, nous disposons verres et couverts. En France,
le couteau de table et le couteau à poisson sont placés à droite. En
Angleterre, la fourchette à huîtres se trouve du côté des couteaux, dont
le tranchant est tourné vers l’assiette. Les couverts sont alignés non
pas par le haut, mais par le bas. Le verre à eau est à gauche, et le verre
à vin à droite. L’assiette à beurre est placée à gauche... »
Durant mon exposé, elle n’a cessé de me scruter à travers son
lorgnon, fermant à demi ses yeux bridés, comme si elle me jaugeait.
« Cela suffit, a-t-elle dit. Dix-neuf sur vingt !

- Et pourquoi pas vingt sur vingt ? a protesté M. Canac, satisfait de
ma défaite aux échecs.
- Nous ne mangeons pas d’huîtres britanniques », a tranché son
épouse.
Néanmoins, c’est son mari, ancien fabriquant d’explosifs et
artificier pendant la Grande Guerre, qui a jugé l’épreuve décisive. Cet
examen dangereux, surnommé le bain de foudre, a eu lieu lors du
premier orage de l’été. Muni de son parapluie de berger, tout de bois, M.
Canac m’a invité à le suivre sur les hautes crêtes de la pointe de
Marcelly afin d’y « avaler une bonne bouffée d’électricité ».
Après avoir gravi un sentier abrupt, nous nous sommes retrouvés
au milieu d'un cirque rocheux, fouettés par une pluie et un vent violents.
Le ciel, se déchirant comme sous l’effet d’un coup de sabre des dieux
en colère, s’est mis à cracher sur la montagne des éclairs en forme de
flèches incandescentes qui zigzaguaient au-dessus de nos têtes avant
de s’écraser sur le rocher. Dans cet air ionisé, une odeur de soufre m’a
soudain pris à la gorge, et le souffle de la foudre, qui est tombée tout
près, m’a projeté sous un abri de pierre. J’ai enlevé discrètement mon
appareil auditif, échappant ainsi au fracas du tonnerre.
Tête nue, trempé, la poitrine bombée et les jambes écartées, mon
maître chétif pointait son parapluie de berger vers la tourmente, défiant
les éléments déchaînés.
« Je vous jette mon gant, ô cieux ! a-t-il vociféré à travers sa
moustache de schnauzer. Je vous nargue, je vous dis mille merdes. Je
vous avalerai tout rond, je ne ferai qu’une bouchée de vous ! Vive
monsieur Benjamin Franklin, inventeur du paratonnerre ! »
De retour au chalet, M. Canac m’a qualifié d’« homme au cœur
bien accroché ». Il a noté mes coordonnées bancaires et le lendemain
matin, par téléphone, a demandé à son banquier d’effectuer, tous les
mois, un virement au bénéfice de son nouveau chauffeur, cordon bleu,
sommelier et maître d'hôtel.
_
Celui-ci, serviteur ingrat, vient de faire une chose indécente :
prendre une douche dans la salle de bains de son employeur, au lieu de
se servir de sa propre salle d'eau. Ce faux pas malencontreux ne peut
être expliqué ni pardonné par l'absence durable de monsieur Canac.

L'expression « absence durable » est un euphémisme, appliquée à un
homme absent pour toujours. Appelons un chat un chat, bien que cela
ne nous plaise guère : M. Georges Canac est mort foudroyé, il y a de
cela presque un an. Il y a laissé ses bottes -restées sur la falaise
escarpée de la pointe de Marcelly -, déchaussé par la foudre qui a
frappé avec perfidie, par derrière, sa tête carrée.
Au bord du cirque rocheux, sous son abri, son chauffeur et maître
d'hôtel a été témoin de la tragédie, de ce moment où une boule de feu a
mis fin aux provocations de l'homme maigrelet qui outrageait les
divinités de la montagne. Avant de lui assener le coup de grâce, ladite
boule vert-jaune, de la taille d'un ballon de football, a enflammé son
parapluie et les pans de son imperméable. Le petit homme, ancien
sportif, dans une colère noire, l’a malmenée, lui infligeant un coup de
pied digne d'un vrai champion. Malheureusement, cette « putain infâme
» - selon les propres termes de M. Canac -, maligne, recourant à un tour
de passe-passe, a fait un tête-à-queue pour l'attaquer de dos et lui a
calciné l'occiput et la colonne vertébrale.
Son corps, enveloppé dans mon caban de toile cirée, les pieds
nus, m’a paru encore plus petit quand je l’ai déposé sur le spacieux
canapé de la salle de séjour. Bizarrement, Mme Canac était déjà au
courant. Malgré son hostilité envers les chiens, elle avait pris très au
sérieux les pleurs de Byzance, le schnauzer femelle de M. Canac, qui
s'était mise à pousser des gémissements à vingt-trois heures vingt,
heure de la mort de son maître.
« Il ne faut pas réveiller le chien qui dort », a-t-elle bougonné,
dodelinant sa petite tête fanée.
Les pompiers étaient déjà prévenus, ainsi que la morgue d'un
hôpital de la vallée. Le lendemain, vers la fin de l'après-midi, j’ai conduit
Mme Canac et Byzance à la gare de Saint-Gervais. La vieille dame a
claqué la portière de sa limousine au nez de la vieille chienne,
l'empêchant ainsi de sortir. Elle ne lui avait pas pardonné son caniche
en peluche, déchiqueté. Byzance a gardé bonne contenance derrière sa
mèche touffue. Apparemment, toutes deux étaient contentes de cette
séparation. Chose curieuse, pour la première fois, j'ai entendu Byzance
pousser un cri plaintif quand elle m’a vu quitter la voiture.
« Je vous téléphonerai de temps en temps, m’a lancé Mme
Canac par-dessus la fenêtre de son single. Prenez soin de mes

philodendrons. Je veux que vous m’en envoyiez une photo en couleurs
tous les trois mois. »
Elle ne m’a téléphoné que deux fois de sa villa préférée, celle de
Biarritz, pour louer mes photographies, enthousiasmée par la croissance
de ses « philos grimpants ». Elle n'avait jamais aimé la haute
montagne, et la vue de son séjour sur le mont Blanc ne lui plaisait
guère. Contrairement à son époux, pour qui le géant majestueux était le
« vestibule du palais divin », elle craignait la proximité de Dieu,
déclarant parfois que « cette grosse pierre monstrueuse menaçait de
l'écraser ».
Les virements automatiques ordonnés par M. Canac se
poursuivaient sans interruption. S'il appréciait l'argent, transformant en
or tout ce qu'il touchait, il boudait, en revanche, tout contact physique
avec lui, retranché derrière ses prélèvements bancaires. Toutes les
factures étant réglées automatiquement, ce « système sanguin » a
continué à fonctionner à merveille durant l'année qui a suivi sa
disparition, et ma vie solitaire dans son chalet n’a été troublée par aucun
changement désagréable.
Le seul « robinet » qui s’est fermé juste après la mort de M.
Canac a été celui de l'approvisionnement du chalet en vivres, qu’avait
toujours géré sa veuve. Cette restriction ne m’a pas causé grand souci.
Souffrant d’une colite chronique, contractée jadis en Nouvelle-
Calédonie, je me contente d'un bol de riz, de quelques légumes et d'un
fruit par jour. Quant à Byzance, qui endure les mêmes maux, mon
salaire me permet de lui offrir, en plus du riz, de belles cuisses de
poulet.
Je me trouve donc dans une situation paradoxale, aussi agréable
que fragile, insouciant comme un clochard de luxe marchant sur des
rasoirs et susceptible de se retrouver, d'un jour à l'autre, dans de beaux
draps. C'est pour cette raison que je me suis permis d'usurper la salle
de bains de feu mon maître pour prendre une douche, puisque ma loge
est dépourvue d'eau chaude.
Depuis la mort de M. Canac, la belle pièce de marbre nacré n’est
plus chauffée et elle garde toujours le souvenir d'un hiver
exceptionnellement froid et enneigé. La vapeur de ma douche a
entièrement embué le grand miroir au cadre doré qui, du sol au plafond,
couvre le mur faisant face à la baignoire. Plus tard, je me servirai du
sèche-cheveux de M. Canac avant de me vêtir, comme tous les jours,

de ma redingote grise de sommelier et d’enfiler mes gants blancs.
Quoique je sache que personne ne viendra ce soir, j'ai à cœur de ne pas
me négliger et de passer la soirée comme d'habitude, prêt à accomplir
mes devoirs.
Machinalement, d'un coup de serviette, j'essuie devant moi la
surface de la glace. L'image qui émerge de ses profondeurs me frappe
de stupeur : on dirait que je suis transparent, invisible, comme si ce
reflet appartenait à une créature étrange, à un inconnu dissimulé
derrière mon dos. Ce sexagénaire aussi grand que moi, maigre comme
un hareng, n'a que la peau sur les os, une peau flasque et plissée aux
aisselles. Ses épaules et sa poitrine sont parsemées de plaques
brunâtres et de vilaines taches squameuses. Ses cheveux clairsemés,
couleur poivre et sel, tout comme sa barbe, donnent à son visage
maussade un air malpropre.
Écœuré, plein de dégoût, je cherche à chasser cette sale tête d'un
revers de la main. Hélas ! à ma grande surprise, il en fait de même,
comme il sied à un sosie. Je lui réplique en grimaçant, en ricanant, et
mon double me rend la pareille. C'est la première fois depuis des
années que je me vois aussi nu qu’un ver, moche comme un pou : j’ai
pris un terrible coup de vieux. De plus, ce corps malingre à la peau
cendreuse et au torse courbé, prêt à s'écrouler, paraît sorti tout droit
d'un four au beau milieu de sa crémation. Je l'observe sans regret ni
compassion et je commence à comprendre certaines choses. Le
vieillissement n'est qu'un simple processus de combustion. Après avoir
brûlé d'envie, brûlé de passion, brûlé les planches, brûlé ses vaisseaux,
on finit par sentir le brûlé, pour terminer sa vie en brûlant tout court.
Cendres, là où le feu régna.
Enfant, j’observais avec tristesse la courte vie des éphémères, ces
étincelles vivantes qui, joyeuses et insouciantes, brûlent les étapes de
leur destin. Nés le matin pour mourir le soir, ils me semblaient
pitoyables, à moi, gamin de douze ans, qui avais encore une longue
existence devant moi. Alors, m’apitoyant sur la vie si brève des
éphémères, j'ignorais que le même sort m’attendait. Morveux
prétentieux et dégourdi, malgré mon infirmité, je ne pouvais
comprendre que la dissemblance des vies rendait la longévité tout à fait
relative et que cette seule journée, qui séparait la naissance de ces
insectes-éclairs de leur mort, était une longue vie extrêmement riche,
passée en vol perpétuel.

Cette frénésie, je la compare aux voyages, dévoreurs de temps, et
aux longs séjours dans des contrées étrangères, qui vous obligent à
voler sans cesse, sans jamais toucher terre. Ce vol épuisant se nourrit
du temps ; et des années, voire des décennies entières, s’écoulent
imperceptiblement, en deux temps trois mouvements.
Après avoir quitté mon pays natal, pourvu d’un coquet héritage, j’ai
vécu dix ans à Paris. Là, j’ai eu la chance de me faire des amis
formidables, dont le souvenir ravive toujours une sourde douleur. J’étais
fier de l’amitié qui nous unissait et nous empêchait de vieillir, tandis
qu’ensemble nous voyagions aux quatre coins du monde, que,
fréquemment, nous séjournions en Corse. On dit que la foudre ne tombe
jamais deux fois au même endroit. Hélas ! l’unique coup de tonnerre qui
s’est abattu sur nous dans la maison de mon père, près de Bonifacio, a
été suffisant pour réduire en cendres tous nos rêves et projets. Tombé
dans la dépression, seul rescapé de l’incendie criminel qui a ravagé ma
petite demeure, j’ai assisté impuissant au transport des dépouilles
calcinées de mes hôtes et amis, Sandrine, Prosper, Inès et Villi.
J’ai erré longtemps comme une âme en peine, inconsolable. Puis,
suivant la belle Kartini et quittant la France, j’ai fini par jeter l’ancre dans
sa patrie, en Nouvelle-Calédonie, à vingt mille kilomètres de la
métropole. Bien que licencié ès lettres, je suis devenu intendant de la
plantation de caféiers du père de ma ravissante Kanake. Après la faillite
de mon mensuel parisien, destiné aux immigrés en France, je suis
devenu écrivain public dans un village de quatre cents âmes, sur une île
mélanésienne. Infécond ou mari d'une femme stérile, en quinze ans, je
n’ai pu engendrer un seul métis, pour fuir enfin mon épouse ou plutôt
être chassé de ses terres. De retour dans la capitale, pauvre comme
Job dépouillé par les dieux de l'océan Pacifique, j'ai tiré le diable par la
queue pendant plus d’un an et demi, gardien de nuit dans un hôtel de
passe minable, jusqu'au jour où j’ai pris mon courage à deux mains et
suis allé frapper à la porte de la généreuse Mme d'Alembert.
_
Malgré tout, je suis un homme chanceux. Bien qu’athée depuis
l'âge de raison, je m'adresse en ces termes reconnaissants tous les
matins à la grande croix plantée sur le piton de Marcelly. Ne serais-je

pas devenu, dépouillé par Dieu, le païen sur les bords ? Tous les astres,
vus depuis ce monde d'entre-ciel-et-terre, me paraissent bienfaisants,
comme si la nature tout entière se métamorphosait en divinité.
Rester humble devant cette beauté, est-ce là la clef du bonheur ?
Je pense que oui. S’oublier complètement pour découvrir le
monde qui vous entoure et vivre ainsi les plus délicieux instants de votre
vie.
Après avoir passé des années dans la panade, heureux comme
un chien qui se noie, j'ai fini par gagner le gros lot, la confiance de M.
Canac, un emploi agréable, un revenu plus qu'honnête et un pied-à-
terre dans un magnifique chalet surplombant le versant est de la
montagne, sous les rayons du soleil levant.
« La maison est très bien orientée par rapport aux points
cardinaux, disait mon maître, l'œil rivé sur la chaîne du Mont- Blanc.
L’exposition est parfaite pour y laisser ses vieux os. »
C'est fort juste. Le plateau ondulé du Praz-de-Lys - la prairie des
lys en patois de Haute-Savoie -, situé à mille cinq cents mètres d'altitude
et ceint de toutes parts de montagnes, n'est ouvert qu'en direction de
l'est, face aux dents majestueuses du mont Blanc. Le chalet de mon
maître est bâti là, sur une sorte de balcon suspendu dans les airs, d'où
l'on embrasse le panorama, jusqu’aux arbres noirs accrochés aux
falaises. Le chalet se trouve à la lisière d'un bosquet de sapins dont
l’ombre scintillante est projetée par le soleil à son coucher sur les deux
fenêtres minuscules de ma loge. C'est à cause de cette clarté
crépusculaire, mélancolique, que je l'ai surnommé le Bosquet d'entre
chien et loup.
La brusque fonte des neiges, moment propice aux pensées
noires à la montagne, a découvert çà et là le sol sous les congères, une
terre misérable, carbonisée durant l’hiver, image même de la désolation.
Seule Byzance, à la truffe infaillible, a su déceler la sève endormie dans
les herbes et les plantes abattues. En raison de ce vague à l'âme causé
jour après jour par le printemps, je suis descendu la semaine dernière
avec Byzance jusqu’à Taninges pour rencontrer son vétérinaire et le
patron des pompes funèbres.
Mon affaire, contrairement à celle de Byzance, a été rondement
menée. Moyennant une coquette somme, au risque de tarir mon compte
en banque, j'ai obtenu les garanties de me faire incinérer, dans un
avenir plus ou moins proche, à Cluses, et de voir mes cendres

dispersées par les employés des pompes funèbres dans le bosquet,
derrière le chalet de M. Canac, au-dessus de La Savolière. Quant à
Byzance, son vétérinaire s'est engagé de bonne grâce à lui administrer
la « piqûre » le jour de ma disparition, mais il a dû téléphoner à trois
reprises, à Bonneville, à Annemasse et à Annecy, avant de trouver un «
créma-dog » : preuve indéniable que la mort d'un chien n'est guère plus
facile que sa vie. Les cendres de Byzance seront transférées dans mon
urne funéraire - j’en ai choisi une en terre cuite, la moins chère - et
seront dispersées avec les miennes au lieu dit Entre chien et loup.
Peu après mon retour au chalet, j'ai commencé à regretter cette
démarche inconsidérée, probablement dictée par les rêves affreux de
ces dernières nuits. Dépourvu de toute couverture sociale et médicale,
j'aurais dû assurer plutôt notre vie que notre mort. Et, pour couronner le
tout, j'ai de nouveau commis un acte honteux : je suis descendu à la
cave ouvrir le meilleur bourgogne de M. Canac et vider d'un trait un
verre entier.
Légèrement ivre, par suite d’une longue abstinence, j'ai failli me
casser le nez en remontant du sous-sol, ce qui ne m'a pas empêché pas
de boire un deuxième verre pour échapper, dans les vignes du
Seigneur, à ces cauchemars nocturnes, ces évocations de mon enfance
tourmentée, qui me mettent au supplice.
_
Je marche dans la neige entassée sur la route sinueuse qui mène
au col de la Ramaz, au nord-ouest du Praz-de-Lys, les pieds gelés,
enveloppés dans des chiffons et de vieux journaux. Lorsque je tourne la
tête, je vois le village en flammes. De nombreux chalets sont déjà
détruits ou en train de brûler, touchés par des bombardiers ou des
tireurs d’obus, embusqués sur la pointe de Marcelly, qui domine tout le
plateau.
Derrière nous, de fortes détonations retentissent. Je suis le
premier dans la colonne des réfugiés qui cherchent le salut sur le
versant opposé de la montagne. Nous sommes pris entre le marteau et
l'enclume, entre les balles tirées depuis le pic de Marcelly et le déluge
de bombes que la partie adverse largue sur notre village. Ces vieillards,
ces femmes et ces enfants avancent dans les congères, tirant des
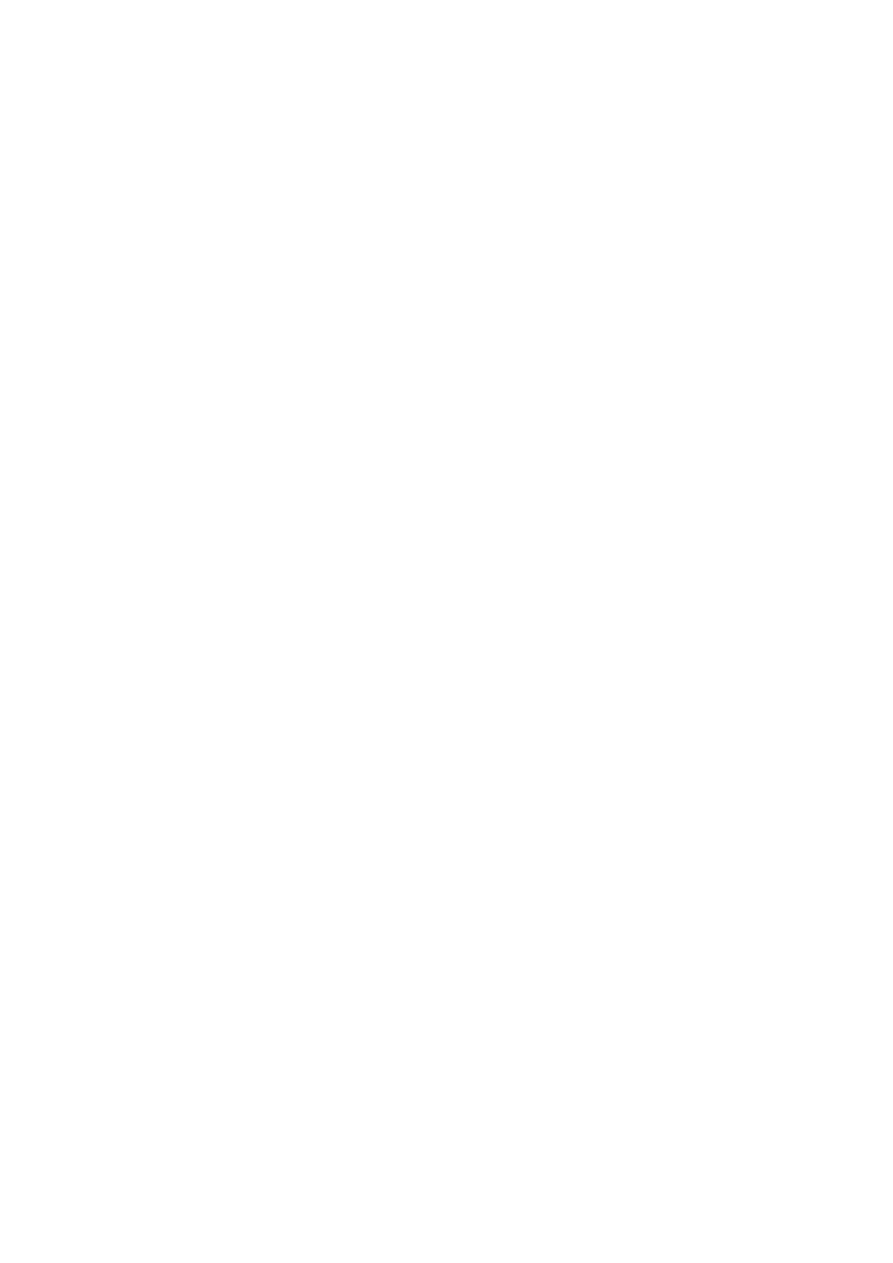
charrettes à bras et des traîneaux chargés des corps ensanglantés de
leurs proches. Transi de froid, pareil à tous ces pauvres hères en
haillons, je pousse une brouette surchargée. À l’intérieur gît une petite
vieille, entourée des têtes décapitées de plusieurs hommes de sa
famille, parmi lesquelles je distingue avec effroi celle d'un âne.
« C'est insensé, dis-je, à bout de souffle. Ils sont morts, madame.
Ils sont trop lourds. »
Tordant une bouche édentée, elle me répond dans une langue
étrangère dont, curieusement, je comprends chaque mot, tout en
devinant, Dieu sait comment, que c’est du patois savoyard.
« Ce sont mon mari et mes fils, dit-elle. Je les planterai à
Sommand, de l'autre côté de la montagne. Ils y repousseront. »
Je lui demande en gémissant :
« Et cet animal, madame, est-il indispensable ?
- C’est notre âne nourricier, m'explique-t-elle. Lui aussi
repoussera dans la terre fertile de Sommand.
- C'est absurde, dis-je, révolté. Rien ne repoussera à la fin de cette
guerre, la terre est pleine de plomb. »
À ma grande surprise, je me rends soudain compte que je connais
sa langue, que je parle son patois à la perfection, comme s’il s’agissait
de ma langue maternelle. De surcroît, je constate avec un certain
malaise que c'est la seule langue dans laquelle j'arrive à m'exprimer. Et
le comble, c’est qu’en essayant de me réciter une strophe de Rimbaud -
« Oisive jeunesse / à tout asservie, / par délicatesse / j'ai perdu ma vie »
- je m'aperçois que je la prononce en patois.
Je reprends la route, en poussant mon fardeau dans une neige de
plus en plus profonde. Nous approchons d'un drôle de poste-frontière,
gardé par des militaires barbus, tout de noir vêtus et armés jusqu'aux
dents. Ils nous arrêtent d'un geste menaçant, braquant leurs pistolets
mitrailleurs vers ma poitrine, et nous demandent nos papiers. Ils
s'expriment dans une langue que jadis, Dieu sait quand, je connaissais
par cœur, et dont je suis incapable d'articuler une seule parole.
« Patois ? me demande leur chef, furieux. On en a marre des gens
qui parlent patois ! Foutez le camp de chez nous ! »
Je m'efforce, en vain, de ne pas répondre en patois, la seule
langue que je maîtrise à présent et dans laquelle je me trouve
bizarrement enfermé.
« Non, dis-je, je ne parle pas patois.

- Menteur ! hurle-t-il. Toute parole contraire à notre vérité doit être
punie, poursuit-il en dégainant son couteau. Tu parles patois. On va
tous vous écraser comme des mouches. »
C'est un homme visiblement instruit, malgré ses manières
sanguinaires, à en juger d’après la suite de son réquisitoire :
« Bien qu'elle soit parfois libératrice, en temps de paix, la langue
en guerre se transforme en prison en moins de deux. »
Pétrifié de peur, je ne me défends pas quand il fait signe à ses
soldats de m’attraper les bras et de les plaquer contre mon dos, lorsqu'il
tranche mon oreille droite, qu’il jette à son doberman. Hargneux, le
chien la happe en plein vol et l'avale avidement.
« Une oreille coupée pour chaque mensonge, dit en ricanant mon
tortionnaire. Après les oreilles, les mains et les pieds. Alors, tu
appartiens à ceux qui parlent patois, oui ou non ? »
Mon sang gicle de partout. Je crie comme un forcené et je me
réveille en sursaut, trempé de sueur...
_
N'ayant plus le courage de me remettre au lit, où les oreillers
froissés sont tachés de salive, je décide de veiller jusqu'à l'aube aux
côtés de Byzance, troublée par mes cris. Je me jure de ne plus regarder
les journaux télévisés et leur horrible défilé d'atrocités. Je suis
incapable, terrifié par ce dernier rêve, de lire quoi que ce soit. Il n’est
surtout pas question de reprendre la correspondance de Stefan Zweig,
qui se donna la mort parce qu’il ne pouvait plus écrire ni respirer dans
une langue de folie meurtrière. Moi aussi, je commence à étouffer dans
ma langue d'autrefois, si belle soit-elle, comme toute langue maternelle,
aussi belle qu'une mère, la plus belle femme du monde.
Imprégné de cette avalanche d'horreurs, j’ai l’impression de
sombrer dans la démence. Des mots dérisoires s'emparent de mon
esprit, que je conjugue à mi-voix, tel un perroquet : « Je suis fou, ils sont
fous, nous sommes tous fous... » Quand je regarde la télévision, je lis la
folie sur les visages, sur celui du bourreau comme sur celui de ses
victimes, sur les faces défigurées des chefs de camp opposé et sur
celles de leurs commentateurs sur le petit écran. Nous sommes

sûrement en proie à un dérèglement de l'esprit, à une obsession
collective qui nous mène à la démence, à un déchaînement de
brutalités.
Peu à peu, mes murmures se changent en parole articulée, qui se
fait de plus en plus forte. J’arpente dans la pénombre le séjour, le salon
ouest, la salle à manger, je tourne en rond et me mets à scander un
discours destiné à la fois aux martyrs et aux assassins.
« Vous êtes en plein délire de persécution, vous cédez à la fureur
! disje en criant. Vous, les victimes d'autrefois, vous êtes devenus des
bourreaux titubant dans un cercle de férocités ! Vous nous chassez de
vos terres ! La Terre, notre mère commune, ne vous appartient pas,
enfants ingrats ; nous, corps et âme, nous lui appartenons ! »
En jetant un coup d'œil à l'extérieur, j’aperçois quelques flocons de
neige voltiger, les derniers de ce mois d'avril. Chose étrange, le simple
fait de les voir papillonner sous la lanterne à l'entrée du domaine - leur
blancheur couleur de sommeil sans fin - me remplit de sérénité.
Je m'apaise un peu et me mets au travail. En dépit de l'heure
tardive, je recouds un bouton de ma chemise et époussette un vieux
secrétaire. Tandis que je cherche mes bottes en caoutchouc dans la
gueule d’une cheminée condamnée qui me sert de débarras, je tombe
sur un objet que je n'ai pas vu depuis des mois - une malle, la mienne,
que je n'ai pas ouverte depuis belle lurette. Un trousseau, oublié au fond
du tiroir de mon chevet, contient des clefs appartenant à une bonne
douzaine de portes et de valises closes définitivement derrière moi, le
trousseau, pour ainsi dire, de toute une vie gâchée.
Je reconnais immédiatement la dernière que j'ai utilisée pour
cadenasser ma malle à mon retour de Nouvelle-Calédonie, une clef en
laiton à tige mince et à l'anneau en forme de fleur de lys. Les autres,
pour la plupart, ne me disent rien : un passe-partout, une clef de coffre-
fort, une troisième à tige forée, encore une de sûreté, une clef de
contact... Mon attention est attirée par la plus petite d’entre elles, une
sorte de jouet d'enfant, une clef argentée à laquelle mes souvenirs
embrouillés hésitent à attribuer une origine. Pourtant, quelque chose me
dit que c’est la plus importante de toutes au milieu de ce tas de ferraille,
qu’elle est maîtresse de l’unique serrure restée entrouverte et seule
capable de remuer les cendres.
Cette histoire me fait sourire. Elle commence à ressembler à un «
conte de grenier », bien qu'elle se déroule dans ma modeste loge, près

de la cave. Mais c’est aussi une histoire de « poupées russes ». Tout au
fond de la malle, sous un incroyable bric-à-brac, je découvre un fourre-
tout qui renferme une mallette, qui recèle une boîte en carton. Celle-ci
est scotchée et ficelée avec beaucoup de soin comme si on avait voulu
protéger son contenu. Tandis que je coupe le ruban de Scotch et que je
défais deux doubles nœuds, mes mains et mon menton se mettent à
trembler.
Les objets que j'en sors, ses reliques à lui, enfermés dans le noir
de cette misérable cache depuis un demi-siècle, ne portent aucune
trace des cinq décennies passées, à l'image de la Belle au bois
dormant. Il y a là un marron, si brillant qu’il semble astiqué, si frais qu’on
le dirait tombé la veille de son arbre paternel. Et puis un petit flacon de
parfum en porcelaine, en forme de poire aplatie. Je ne peux
m'empêcher, ôtant le capuchon, de le porter à mes narines. Cinquante
ans après qu’il a été ouvert pour la dernière fois, un soupçon de senteur
y est toujours présent, une odeur vaporeuse de fleurs des prés qui me
noue la gorge. Un demi-siècle, c'est à ne pas y croire ! Me pencher sur
cette fiole pour la humer me donne le vertige, j’ai l’impression de plonger
dans un abîme délicieux qui va m'engloutir.
Enfin, je trouve un cahier, relié en peau lissée brun-noir, avec des
marques de mains en sueur, un drôle de cahier, pourvu sur sa
couverture d'une minuscule serrure du même argent que la clef
accrochée à mon trousseau. Celle-ci s'y engage facilement et l’ouvre en
produisant un petit roucoulement d’oiseau ; magnifique clef des champs,
clef du mystère, elle fait sauter le verrou.
Je ne peux pas ne pas reconnaître son écriture, celle de mon
ancien compagnon d'infortune, celle du Gamin, qu'aujourd'hui je préfère
appeler Petit Dragon. Ses lettres, droites et anguleuses, imitant les
caractères d'imprimerie, s'arrondissent et penchent à gauche en bas
des pages, véritable miroir d'une âme qui voltige, contre vents et
marées, tantôt dédaigneuse, tantôt affligée.
Je suis bouleversé, saisi d'une violente émotion tandis que je
parcours ces lignes tracées d’une belle écriture, qui se transforme
souvent, tout à coup, en pattes de mouches à peine lisibles. Les
cinquante ans qui nous séparent, lui et moi, brouillent un peu plus les
sentiments que j'éprouve à son égard : bien que j’aie eu jadis son âge,
mais ne l’ayant pas vu vieillir, il est devenu pour moi une sorte de fils ou
de frère cadet, ce pauvre petit diable, enfermé à jamais dans la langue
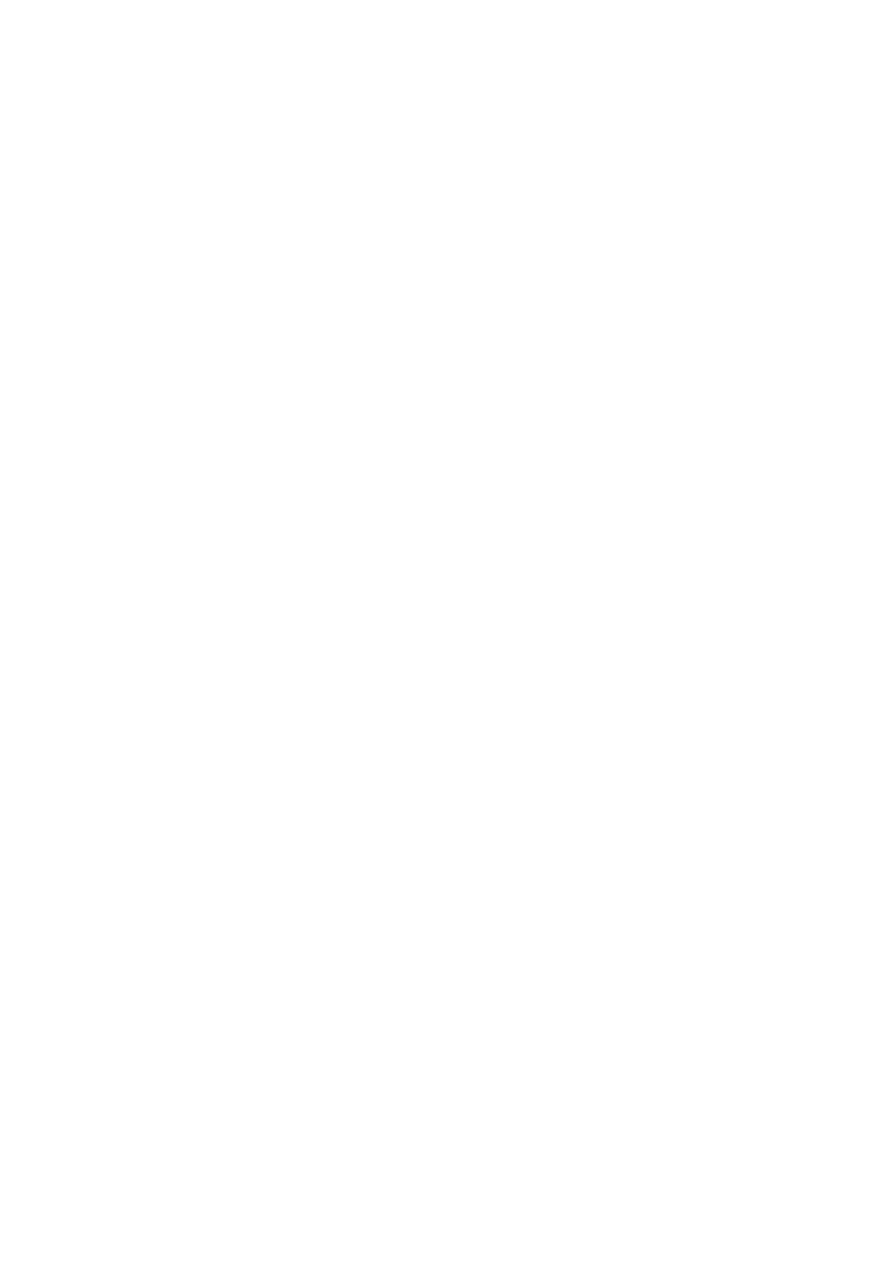
de notre enfance et de son journal, qu'il avait eu la folle audace
d’intituler : Le Livre de ma vie !
Sa langue est celle du tortionnaire de mon cauchemar, de ce
sadique qui me trancha l'oreille !
À l'aube, ma décision est prise. De nouveau je parle à voix haute,
avec fébrilité. Je sortirai le Gamin de la langue de la fureur, je le sortirai
de notre langue mère devenue fille à soldats, mangeuse de viande crue,
tombée dans l'abjection, usurpée et corrompue par les démons de la
guerre.
« Je te délivrerai, mon ami ! Je te libérerai ! Je te traduirai en
français ! C'est comme si je t'offrais une seconde vie !... »
Aussitôt dit, aussitôt entrepris. Muni d'un crayon à bille et de
feuilles de papier à musique - c’est tout ce que j'ai trouvé dans le chalet
-, je lève le store de ma seule fenêtre pour mieux éclairer mon
secrétaire. Je découvre avec satisfaction que le ciel a décidé de me
prêter main forte : une tempête de neige - à la mi-avril ! - étend son
rideau blanc tout autour de la maison, et le réel, notre monde assassin,
a soudain disparu.
Allons de l'avant, Petit Dragon ! En avant, l’ami !...

MON JOURNAL
Dire que pour mon anniversaire oncle Edouard m'a offert un
journal ! Il est très joli avec une couverture brune, et il est doré sur les
tranches. De plus, il est muni d'une toute petite serrure à clef argentée.
Aujourd'hui, oncle Edouard est venu avec tante Milena déjeuner chez
nous. Il a parlé du journal qu'il avait tenu, racontant sa vie et ses grands
voyages. Après le déjeuner, je lui ai demandé ce que c'était, un journal.
« Un cahier, m'a-t-il expliqué, où certaines gens écrivent tous les
jours ce qui leur arrive, car il y a parfois des choses dont on ne peut
parler à personne, et puis de précieux souvenirs que l'on finit par oublier
bêtement. La tête d'un homme âgé, m'a dit oncle Edouard, sa tête est
percée d'innombrables trous comme une passoire. L’oubli, pareil à une
mite sournoise, ronge de préférence les souvenirs de jeunesse, laissant
derrière lui des épaves. Et l'homme dépouillé de sa jeunesse est comme
un bateau sans pavillon, un bateau fantôme », a conclu oncle Edouard
en jetant un regard compatissant vers papa, son frère cadet.
Le soir même, j'ai décidé de tenir un journal sans plus tarder. Et
cela à partir d'aujourd'hui, lundi, 11 février, 1945. Je ne veux pas que
l'oubli réduise en poussière mes souvenirs. Je ne veux à aucun prix
devenir une épave, ni un bateau fantôme.
Mardi, 12 février
Quels sont mes souvenirs ? Ils sont plutôt minces. Je crains que
les méchantes mites de l'oubli n’aient déjà commencé à les dévorer. Il
est temps de leur barrer la route !
Mon premier souvenir ? Il est déjà effacé. Parfois, j'ai l’impression
d'être arrivé d’ailleurs, comme si j'avais vécu une autre vie avant celle-
ci. J’ai encore dû en rêver, comme d'habitude. L'autre jour, oncle
Edouard m'a dit que les Chinois croyaient que nos vies se succédaient,
l’une après l’autre, à la manière des perles d'un collier.

« Je préfère penser que ce n'est pas vrai, m'a-t-il dit. Pour un
modeste être humain, une seule vie est plus que suffisante. »
Oncle Edouard a parfaitement raison, comme toujours. Pour moi
aussi, une seule vie est suffisante. En une vie, un garçon a tout le
temps d’accomplir ses rêves, tout ce qu'il s'est promis de devenir.
Mon seul problème est que j'ignore toujours ce que je voudrais
devenir. Stomatologue, comme papa ? Jamais, au grand jamais ! En
quelque sorte, c'est le même métier que plombier : condamné à
boucher toute sa vie des trous dans la tête des patients. Ingénieur des
Ponts et Chaussées, comme oncle Edouard ? Ça me paraît plus
intéressant. Construire des ponts au-dessus des grands fleuves !...
Je me déciderai plus tard.
Comme dit oncle Edouard :
« Il n'y a pas le feu sur le lac.»
Ça y est, je me rappelle mon premier souvenir !
À vrai dire, j'en ai un peu honte, mais mon journal, fermé à clef et
glissé sous mon oreiller, ne dévoilera ce secret à personne. J'ai à peine
trois ans. L'air solennel, papa et Maminka me conduisent aux toilettes,
baissent mon pantalon et m'obligent à m'asseoir sur le bord de la
cuvette. J'ai le vertige au-dessus de ce gouffre béant. Je tremble comme
une feuille, pendant que la voix de papa résonne à mes oreilles.
« Ton pot de chambre, jeune homme, nous allons le jeter aux
orties ! À partir d'aujourd'hui et pour toujours, tu te serviras de toilettes
d'adultes ! »
La gorge sèche, je claque des dents, en me balançant sur le
siège. « Mon Dieu, me dis-je, passer toute une vie au-dessus d'un
abîme ! »
Il est très tard, huit heures et quart. Il faut que je me couche avant
que Maminka vienne éteindre la lumière dans ma chambre. Papa dit que
les enfants doivent se mettre au lit à l'heure de leur âge : les enfants de
huit ans à huit heures, ceux de neuf ans à neuf heures et ainsi de
suite... Je vais fermer mon journal à clef. La clef, je vais la suspendre à
mon cou comme hier soir. Je vais fermer les yeux, je ferai semblant de
dormir et j'attendrai que Maminka pose ses lèvres de velours sur mes
paupières, ces lèvres qui frémissent comme les ailes d'un papillon. En
feignant de dormir, je me laisserai aller au sommeil et je rêverai peut-

être de nouveau ces vies oubliées qui ont précédé la mienne, les perles
d'un collier qui s'égrènent...
Demain, c'est férié, jour de fête nationale. Maminka et tante
Milena vont à Paris remettre à Mme d'Alembert leurs superbes tricots de
soie et se faire une permanente. J'aurai tout le temps pour écrire mon
journal. Je décrirai tout ce qui me tient à cœur. J'arracherai de l'oubli tout
mon passé, pour que je ne devienne jamais un homme sans pavillon. Je
me ferai mon propre drapeau.
Mercredi, 13 février
Maminka et tante Milena sont parties pour Paris très tôt ce matin
avant que je me réveille. En rentrant de la gare, papa s'est enfermé
dans son cabinet pour boucher des trous dans la tête de pauvres gens.
Tous les mercredis, notre Loudmila lave le linge dans le garage-
buanderie, de l'autre côté de la maison. Je suis tout seul et serein,
attablé devant mon journal, auquel je vais raconter mes souvenirs,
pendant qu'à l'extérieur le vent siffle dans les persiennes et que de gros
flocons effleurent les vitres.
Cette neige me fait penser à Diana, qui était toute blanche elle
aussi. Maminka et papa m'ont offert Diana un mois avant le grand
bombardement. Diana avait de petites cornes recourbées vers l’arrière
et le menton garni d'une barbiche. Papa m'a dit que le lait de Diana nous
servirait à mieux traverser ces jours de « vaches maigres ». Notre
Loudmila, qui vient des Alpes et qui est petite-fille de bergers, s'est
proposée pour traire la chèvre et me préparer du lait caillé.
Le lendemain matin, tandis que je caressais Diana, sur son lit de
paille, dans le garage, tout en sirotant un verre de son lait tiède, un peu
sucré, comme les fleurs du robinier, tonton Pinter est arrivé à
l'improviste pour parfaire ce cadeau royal. Complice de Maminka et de
papa, tonton Pinter avait mis au point pour moi et Diana un carrosse
miniature, petite merveille en bois de hêtre composée de quatre roues à
rayons, de deux brancards, pour atteler Diana, d’une carrosserie
richement ornée et de deux sièges. Ce mini-carrosse reproduisait
fidèlement une ancienne voiture à cheval - comme nous le dit oncle
Edouard -, équipée de tous ses accessoires d'autrefois, en bois, en cuir
et en fer, et de magnifiques objets dont j'ignorais le nom et l'usage.

Tonton Pinter, menuisier en meubles, les yeux brillants et le bouc
roux, lui aussi originaire des Alpes slovènes, comme notre Loudmila, est
un vrai magicien. Sous ses mains rugueuses, le bois qu'il travaille se
transforme comme par enchantement en une matière vivante qui semble
respirer et chuchoter dans une langue inconnue. Au dire de papa et de
Maminka, tonton Pinter avait fabriqué bien avant ma naissance la
plupart des meubles de notre maison, la grande table en acajou de la
salle à manger, leur lit à colonnes et toute ma chambre bleu ciel.
Chose étrange, Diana a accepté de bon gré d'être attelée. Elle
semblait fière de son harnais flambant neuf. Par un heureux hasard,
Tchaslav est arrivé juste à ce moment-là. Tchaslav est mon meilleur ami
et aussi le plus ancien, nous nous connaissons depuis toujours. C’est
vrai qu’il est beaucoup plus âgé, il est mon aîné de dix mois, mais il me
traite comme si nous avions le même âge. Je lui en suis reconnaissant.
Voyant Diana attelée, Tchaslav est resté bouche bée, faisant
apparaître deux trous laissés par ses dents de lait perdues.
« Bon sang ! » a-t-il dit.
Nous montons en voiture. Tchaslav occupe la place du
conducteur. Je ne proteste pas. C'est tout à fait juste, il est plus âgé et
son grand-père a été cocher de fiacre.
« Hue, huhau ! » crie-t-il pour faire avancer Diana.
Tout à coup, elle se met au trot et, pendant que nous poussons
des hourras, elle contourne la maison, puis emprunte la petite allée
bordée de lilas qui mène vers l'arrière-cour.
« Hue, huhau ! » s'exclame Tchaslav pour tourner à droite.
Diana obéit comme un cheval.
« Dia, diaaa ! » crie encore Tchaslav pour tourner à gauche.
Diana obéit comme un vieux trotteur.
En passant devant les fenêtres grandes ouvertes de la salle à
manger, j'aperçois Maminka dans sa robe de chambre feuille-morte.
Tête nue, les cheveux lâchés et des larmes de joie dans ses yeux
noisette, elle nous salue en agitant son turban.
Une semaine plus tard, oncle Edouard a entrepris de mystérieux
travaux dans les cabinets de notre Loudmila, une pièce à peine plus
grande que la penderie de Maminka et située tout au bout de notre
petite villa, avec un toit indépendant de celui de la maison. Oncle

Edouard, qui est un fin bricoleur, a descendu du grenier un vieux
matelas d'enfant épousant parfaitement la forme et la taille des toilettes.
Après avoir planté quatre crochets en acier aux quatre coins du plafond,
il y a suspendu le matelas.
« C’est un abri antiaérien pour les enfants, a-t-il expliqué à notre
Loudmila, qui observait son travail d’un air soupçonneux. Je parie que
ces maudits fascistes vont nous bombarder. Si une bombe frappe la villa
et si elle s'écroule, il y a neuf chances sur dix pour que ces toilettes
restent intactes. »
Les sombres pressentiments d'oncle Edouard se sont révélés
fondés dès le dimanche suivant. Très tôt le matin, pendant que Tchaslav
et moi, accompagnés de ma voisine Marina, rangions nos billes pour le
tournoi dominical, le son plaintif d'une sirène nous a fait sursauter. Deux
minutes plus tard, pressés par papa et Maminka, nous nous sommes
retrouvés tous les trois dans les cabinets de notre Loudmila, accroupis
sur le carrelage, serrés les uns contre les autres sous le matelas d'oncle
Edouard.
Éclairés par une ampoule, essoufflés et trempés de sueur, nous
sommes écrasés contre la cuvette, qui exhale une odeur d'eau de Javel
suffocante. Les plaintes de la sirène cessent aussi subitement qu'elles
ont commencé. Dans ce silence qui s’installe, nous retenons notre
souffle, l'oreille tendue vers un vrombissement. Au loin, un petit bourdon
approche... deux bourdons, puis trois puis quatre... dix, quinze, trente...
tout un essaim d'insectes en rage, tout un nuage de grêle au-dessus
notre ville...
Soudain un hurlement déchire le ciel. De plus en plus fort, il se
rapproche, ce rugissement, ce cri féroce qui nous transperce comme la
toupie de tonton Pinter, comme le dard d’un insecte géant qui vise le
sommet de la tête, qui s'enfonce dans le crâne et dissout le cerveau...
Puis, c’est l'explosion, qui secoue les murs, souffle la lumière et
abasourdit. Suivie d’une deuxième, d’une troisième, avec à chaque fois
des sifflements aigus qui trouent le crâne, des détonations que l’on
n'arrive plus à dénombrer...
Dans la pénombre chargée de poussière, je distingue le visage
blême de Tchaslav. Il mord son poing plein de billes pour ne pas crier.
Marina, en vomissant sur sa belle blouse blanche, glapit comme un petit
chien. Les odeurs de la nourriture qu'elle a rejetée, de son urine, de ses

excréments me prennent à la gorge. Tchaslav pousse un gémissement,
se plie en deux, râle, tousse, s'étouffe et crache une bille. Il en a avalé
deux autres.
Je n'en peux plus, je sombre dans les ténèbres...
Je suis vivant, étendu sous notre abricotier. Au pied de ma chaise-
longue, dans l’herbe, Tchaslav hoquette. Papa examine, l'air inquiet, les
oreilles de Diana, qui est en train de savourer au bord du potager une
laitue de notre Loudmila. Papa a trouvé des traces de sang dans le
pavillon des oreilles de la pauvre chèvre.
« Ils lui ont crevé les tympans, marmonne-t-il.
- Diana ! Diana ! dis-je dans un cri.
- Hue ! Huhau ! » hurle Tchaslav.
Diana continue à mâcher sa laitue et ne réagit pas. Elle est
devenue complètement sourde, ou alors elle feint de l'être.
Le lendemain, notre Loudmila a eu toutes les peines du monde à
extraire trois gouttes de lait des mamelles de Diana, bien que celle-ci ait
ingurgité une plate-bande entière de laitues. Sourde comme un pot, elle
ruminait toujours paisiblement quand papa l'a attelée à mon carrosse,
chargé de nombreux sacs et paquets. Ma voisine Marina est venue
nous dire au revoir en même temps qu'oncle Edouard et tante Milena,
qui avaient traversé toute la ville à pied avec leur valise en lézard.
Quoiqu’elle soit fille de sourds-muets, Marina n'était privée ni
d'ouïe ni de parole. Pour elle, la surdité était loin d'être un malheur.
« Veinarde, dit-elle, en caressant la barbichette de Diana.
- Il n'est pire sourd que celui qui ne veut pas entendre », dit oncle
Edouard en posant sa valise sur nos bagages.
Tchaslav n'est pas venu me dire au revoir. J'espérais qu'il se
remettrait des deux billes avalées et que, lors du grand bombardement,
un malheur n'avait pas frappé son père et sa grand-mère russe.
En échangeant un sourire un peu triste avec oncle Edouard avant
de donner le signal du départ, papa s'est tourné vers moi :
« Marie-Loup, tu as le droit de prendre juste une chose, celle que
tu aimes le plus, ni trop lourde, ni trop encombrante. Compte jusqu'à dix
et décide-toi. »
J'ai compté jusqu'à cinq et j'ai dit :
« La chose que j’aime le plus n'est pas une chose. »
Impatienté, papa a haussé le ton :

« Alors qu’est-ce que c’est ?
-
Diana », ai-je répondu.
Une demi-heure plus tard, nous étions déjà au pied de notre
colline de Toptchider, sur le chemin qui mène vers le nord, vers la
campagne et le village de Duc, où nous sommes restés durant toute la
guerre. Vingt kilomètres de marche à pied ! J'étais le seul à avoir le
privilège de monter trois ou quatre fois dans la voiture de l'infortunée
Diana, qui, les yeux rouges, emplis de larmes, ruminait sa laitue à n’en
plus finir. Pendant le trajet, elle n’a jamais prêté la moindre attention au
bruit des camions militaires que nous croisions. J'ai finalement compris
le mot plein de sagesse de Marina : « veinarde ».
Il a fallu attendre un mois entier avant que papa et oncle Edouard
trouvent le moyen d’échanger leurs napoléons d'or contre de la
nourriture. Pendant ce temps, nous avions le ventre creux. D’autant plus
que les mamelles de Diana étaient définitivement taries. Heureusement,
les braves paysans chez lesquels nous habitions ont accepté de nous
prêter un sac de farine de maïs et un peu de poitrine fumée que nous
avons pu faire bouillir avec le chou et les pommes de terre du nouveau
petit potager de notre Loudmila.
J’avais complètement oublié le goût de la viande fraîche jusqu'au
jour où notre Loudmila nous a présenté un délicieux gigot d'agneau,
entouré de châtaignes. Le jour suivant, c'était de l'épaule d'agneau au
paprika. Le surlendemain, du ragoût hongrois. Puis de la selle d'agneau
aux carottes, puis de la poitrine aux oignons, et pour finir, le sixième
jour, des pieds de mouton au vinaigre de vin, accompagnés de pommes
de terre en robe des champs.
Ce sixième jour, après avoir enfin assouvi une faim dévorante, je
suis allé voir Diana dans la cabane qu'elle partageait avec les deux
moutons de nos hôtes. Je ne l'avais pas vue depuis une semaine. Son
petit lit de paille était vide, sec et froid. Mes oreilles se sont mises à
bourdonner. Je me suis agenouillé, le cœur gros, le cœur soulevé, et j’ai
vomi.
Vinaigre de vin et guerre !
Ce sixième jour, qu'il soit maudit ! Oncle Edouard dit que Dieu a
créé le monde en six jours. Il me semble que cela suffirait aussi pour
l'anéantir. Quoi qu’il en soit, c’est à partir de ce jour détestable que
l'oubli a commencé à ronger mes souvenirs. Pour les protéger, je les ai
enfermés à jamais dans ma tête, dans une petite boîte impossible à

rouvrir, des souvenirs dont je ne souffle mot à personne, pas même à
mon journal.
L’un d’eux pourtant persiste dans ma mémoire. Nous sommes au
plus chaud de l'été. Il est midi. Accroupis dans la cour, Maminka et moi
égrenons des épis de maïs. Elle me demande d'aller chercher dans
notre chambre son chapeau de paille. J'y entre et je fais deux pas vers
la grande armoire. Un sifflement m'arrête net au milieu de la pièce. Il est
aussitôt suivi de deux craquements brefs, l’un venant de la fenêtre et
l’autre d'une icône, accrochée sur le mur. Toutes deux sont
transpercées par une balle. Le saint, sur l'icône, a le front troué. Je
prends le chapeau et je sors. Je tais mon aventure.
Le soir, en écoutant les grandes personnes commenter cet
événement - « Quelle horreur que cette balle perdue ! Dieu merci, il n'y
avait personne dans la chambre ! » -, je reste bouche cousue.
Secrètement, j'en suis fier, j'ai compris le sens caché de la guerre.
La guerre est une balle perdue. Elle perce des trous, même dans
des saintes têtes.
Elle a duré quatre ans ; quatre années qui se sont écoulées entre
quelques rares souvenirs comme le sable entre les doigts. La vie me
paraissait être une nuit pleine de songes. On dort, on rêve, on dort et on
rêve encore. Quand on se réveille enfin, on se rend compte que la
plupart de nos rêves sont oubliés. Le peu que l’on se rappelle, ces
miettes qui nous restent, c'est notre vie dans la paix.
Dimanche, 17 février
Dire que ce matin Maminka m'a offert, rapporté de Paris, un vrai
stylo, muni d'un réservoir d'encre ! Fini le porte-plume ! Dorénavant,
pour rédiger mon journal, je me servirai de mon nouveau stylo parisien à
encre bleu-noir, à la pointe fine qui glisse sur le papier comme un patin
sur la glace. Avec ce stylo, mon journal s'écrit pour ainsi dire tout seul,
et je me sens capable de récrire tous les beaux livres que j'ai dévorés
depuis le jour où j'ai appris à lire.
Maminka n'a jamais senti aussi bon qu'aujourd'hui. Elle a acheté à
Paris un flacon de parfum dont l’odeur infiniment agréable monte à la
tête. Elle est assez difficile à décrire. Elle n'existe pas dans la nature,

mais elle rappelle au moins une douzaine de ces belles senteurs qui
voltigent dans un jardin. Si on la renifle en fermant les yeux, on a
l'impression de ne plus toucher le sol, de planer, léger comme un flocon.
Les yeux fermés, même en plein hiver, on sent l'automne avec toutes
ses fleurs et tous ses fruits odorants.
Le flacon est aussi joli que son contenu. C'est une petite poire
plate en porcelaine, au rebord doré, ornée des deux côtés de
cyclamens. À l’endroit où devrait se trouver le pédoncule, la poire est
bouchée par une capsule de liège enchâssée dans une minuscule
couronne d'argent.
Cette couronne ne me surprend guère. J'imagine que les rois et
les reines de France utilisaient le même parfum.
Tchaslav est venu voir mon stylo parisien, il est resté bouche bée
d'admiration.
« Bon sang ! » a-t-il dit..
Maminka l'a invité à déjeuner avec nous et il a accepté avec
plaisir. Tchaslav a toujours un trou à l'estomac. Ce n'est pas la première
fois qu'il mange chez nous. Maminka a de l’affection pour lui, pour ce «
pauvre petit », comme elle dit souvent, « orphelin de sa mère ». En
réalité, Tchaslav n'a jamais connu sa mère, elle est morte en couches.
Son père, garagiste notable dans notre quartier, a été arrêté, il y a
quatre mois : c’est un prisonnier politique, un ennemi du peuple. Depuis,
Tchaslav vit chez Mme Karpov, sa grand-mère maternelle, qui donne
des leçons de russe et de français aux enfants de notre colline de
Toptchider.
Tchaslav ronge ses ongles jusqu'au sang. Son prénom, en serbo-
croate, est censé signifier honneur slave ou honneur de lion.
Cependant, Tchaslav n'a rien d'un lion. Il ressemble plutôt à une souris
blanche. Oncle Edouard dit que chaque homme ressemble à un animal
et il a parfaitement raison, comme d'habitude. Les yeux de Tchaslav,
avec leurs paupières étirées vers le haut, son nez en forme de museau
pointu, ses grandes oreilles et ses trois ou quatre poils blancs au coin
des lèvres ne renvoient-ils pas l'image même d'une souris ?
Maminka nous a demandé de dresser notre petite table au fond de
la salle à manger. Quand j'ai un invité, comme aujourd'hui, nous ne
mangeons pas avec les grandes personnes, qui se mettent à la table de
tonton Pinter, autour de ce meuble magnifique fait de deux sortes de

bois, l’un clair, l’autre sombre, l’un tabac, l’autre marron, où se reflètent
leurs visages. Il faut que je les décrive, Maminka et papa, tante Milena
et oncle Edouard, avant que les mites de l'oubli ne les dévorent.
À vrai dire, ils ressemblent tous à des animaux, comme dirait
oncle Edouard. Ses cheveux châtain roux noués en chignon, de grands
yeux doux et des lèvres bien dessinées, épaisses et toujours un peu
humides, Maminka ressemble à une biche souriante. Elle est belle, c’est
la plus belle de toutes les femmes de notre rue. Oncle Edouard dit
qu'elle et moi nous ressemblons comme deux gouttes d'eau : les mêmes
yeux, le même visage aux pommettes un peu saillantes, le même petit
menton avec le même grain de beauté. En plus, sur le côté droit de
notre cou, nous avons tous deux une petite glande ouverte, d'où deux
fois par an, toujours à l'époque de la pleine lune, s’écoule une étrange
gouttelette d’un liquide transparent et inodore.
La
sœur aînée de Maminka, ma tante Milena, ressemble à une
brebis. Ses cheveux bouclés, teints en blond, ses grosses narines
pleines de poils, sa lèvre supérieure qui pend et sa façon de parler, la
voix tremblotante comme si elle bêlait, me font vraiment penser à une
brebis.
Papa est assis de l’autre côté de la table derrière un vase de
fleurs, on le voit à peine. Il est haut comme trois pommes, son crâne est
dénudé au-dessus de ses oreilles décollées, et ses yeux, toujours
grands ouverts, sont bleus ; il ressemble à s'y méprendre à une
chouette. J'ai hérité beaucoup de choses de lui, surtout sa taille et ses
oreilles en feuilles de chou. Voilà pourquoi on m'appelle Jumbo, comme
le petit éléphant volant des bandes dessinées. J’ai peur de devenir aussi
petit que papa quand je serai grand. Je suis déjà le plus petit garçon de
ma classe.
Enfin, mon oncle Edouard : un aigle tout craché ! Cheveux blancs,
hérissés en aigrette. L'œil vert argent sous un sourcil touffu pareil à celui
d’un oiseau de proie, nez busqué, lèvres en forme de bec et voix de
l’aigle qui trompette, surtout quand il parle de la Chine.
Toute occasion est bonne pour évoquer son voyage en Chine,
murailles chinoises, jardins chinois, ombres chinoises, peinture,
sculpture, architecture et cuisine chinoises. Selon lui, la Chine est un
des pays les plus civilisés du globe, celui qui a découvert le thé, le riz, la
soie, le papier, la poudre explosive et les dragons volants.

« Formidable, n'est-ce pas ! » trompette oncle Edouard quand il
parle de la Chine.
« Formidable, n'est-ce pas ! » est son expression favorite, comme
l’est « bon sang ! » pour Tchaslav. Quand il nous décrit la Chine, oncle
Edouard répète son « formidable » au moins une fois par minute. Moi
aussi, j'aimerais avoir mon mot préféré et ces mots pour rire qu'il redit
tous les dimanches, dès qu'on se met à table :
« C’est dimanche toute la journée ! » dit-il.
J'aime nos déjeuners du dimanche, où notre Loudmila nous sert
toujours les mêmes plats, bouillon de poulet jaune citron avec ses abats
- foie, cœur, gésier, pieds -, puis poulet pané accompagné de purée de
pommes de terre et de laitue, et, enfin, tarte aux pommes. De tous ces
bons mets, quel est celui que je préfère ? La réponse est simple :
gésier, gésier et encore gésier. Si j'étais roi, je ne mangerais que des
gésiers, trois fois par jour.
La semaine dernière, à l'école, j'ai fait un petit calcul. Si nous
continuons à manger du poulet tous les dimanches, à la fin de l'année
j'aurai ingurgité cinquante-deux gésiers et oncle Edouard cent quatre
pieds.
Aujourd'hui, un événement qui a eu lieu en Chine, mais que je n’ai
pas bien compris, a apporté de l'eau à son moulin ; cela lui a permis une
fois de plus de nous raconter son voyage dans cette glorieuse contrée.
« Nous devons tout à la Chine ! s'est-il exclamé. Sans la Chine, la
famille des Janvier n'aurait jamais existé ! Formidable, n'est-ce pas ! »
Tout le monde a reconnu que c'était vrai, ce qui n'a pas empêché
oncle Edouard d'évoquer son retour de Chine, entre les deux guerres,
sur le dos de plusieurs animaux, éléphant, chameau à deux bosses et
cheval, puis en Orient-Express, un train de rêve, d'Istanbul via Sofia
jusqu'à Belgrade, où le conducteur du train a succombé à une crise
cardiaque. En attendant son remplaçant, les voyageurs du wagon-lit ont
été logés pour la journée dans un hôtel, non loin de la gare. Au lieu de
s’associer à l’oisiveté d’une partie de belote, lui, Edouard Janvier,
toujours avide d’apprendre, a quitté son hôtel, loué un carrosse,
parcouru la ville d'un bout à l'autre, visité le cimetière militaire français et
le monument érigé à la gloire de la France - « Aimons la France comme
elle nous a aimés ! » - pour se rendre enfin au confluent du Danube et
de la Save afin d’y faire quelques photos. À cet endroit, la foudre,
tombant d'un ciel sans nuages, l’a frappé droit au cœur en la personne

d'une passante, une belle collégienne aux nattes paille qui, deux ans
plus tard, est devenue son épouse.
L’année suivante, déjà installé à Belgrade avec sa chère Milena,
devenu correspondant du ministère français des Ponts et Chaussées, il
a fait venir dans la capitale du Royaume yougoslave, pour les vacances,
Arnolphe, son frère cadet, stomatologue fraîchement diplômé, qui a eu
le même coup de foudre à la vue de la sœur cadette de Milena.
Epousant la future Maminka, Arnolphe s'est installé à son tour dans
cette ville, a ouvert un cabinet dentaire et, un an plus tard, a mis au
monde avec son épouse le marmot ici présent, qui porte le prénom de
ses grands-pères maternel et paternel, Miodrag et Marie-Loup.
« Formidable, n'est-ce pas ! a conclu oncle Edouard. Sans la
Chine et sans ce retour de mon voyage en Chine, la famille mixte des
Janvier n'aurait jamais existé ! »
Il a porté un toast à la gloire de la Chine, puis un autre au 17
février, jour de son coup de foudre pour une collégienne, au bord de la
Save. Il a précisé que cette rencontre s'était produite sous le signe du
Bœuf - encore une façon d'amener de l'eau chinoise à son moulin -,
comme s'il savait que je ne pourrais m'empêcher de lui demander :
« Le signe du Bœuf ? De quoi s'agit-il, mon oncle ? »
L'air radieux, il s'est mis à m’expliquer. Le Bœuf fait partie des
douze signes de l'horoscope chinois, qui sont douze animaux différents.
Personne ne sait pourquoi. Seule la légende nous en fournit une
explication. Un soir de nouvel an, Bouddha a invité tous les animaux de
son royaume à lui rendre visite. Pour une raison inconnue, douze
animaux seulement se sont présentés. Le premier était le rat, suivi par
le bœuf, le tigre, le lapin, le dragon, le serpent, le cheval, la chèvre, le
singe, le coq, le chien et le cochon.
En guise de reconnaissance, Bouddha a décidé d'instaurer une
année en l'honneur de chaque animal présent et décrété qu'à l'avenir les
nouveau-nés hériteraient des signes distinctifs de l'animal qui gouvernait
l'année de leur naissance. Ainsi, les natifs de l'année du Bœuf seraient
travailleurs, résolus et entêtés ; quant aux personnes nées pendant
l'année du Chien, elles seraient loyales et fidèles.
À la fin de cette histoire, oncle Edouard s'est tourné vers mon ami
Tchaslav et moi :

« Cependant, chers jeunes gens, a-t-il dit, malgré toutes les
promesses de vos signes respectifs, gardez à l'esprit que vous seuls
êtes maîtres de votre destinée. »
Pour parachever ce beau récit, après notre poulet du dimanche,
oncle Edouard m'a fait un cadeau qui m’a coupé le souffle, un petit livre
rose, intitulé Le Zodiaque chinois. Il contient un superbe tableau des
années chinoises, qui commence en 1901 et finit en 1997. Un siècle
entier ou presque ! En 1997 j'aurai exactement soixante ans, je serai
plus âgé que Maminka et papa aujourd'hui. Quel âge auront-ils en cette
fin de siècle ? Seront-ils encore vivants ? Comment vivrai-je sans eux ?
Ces questions me font peur. Est-il possible que le destin de tout enfant
soit de devenir orphelin ?...
J'ai décidé de me servir du calendrier chinois pour écrire mon
journal. En le parcourant à la fin de cette longue journée, je me suis
rendu compte que j’étais natif de l'année du Bœuf. Travailleur, résolu,
entêté et futur orphelin, j'ai aussi décidé d'être seul maître de ma
destinée.
Le calendrier chinois m'a appris que le grand bombardement
allemand avait eu lieu sous le signe du Serpent, et l'arrivée des
libérateurs russes sous le signe du Singe. Je me demande si c’est un
hasard ?
Sous le signe du Coq, 1945, début avril
Notre nouvelle institutrice s'appelle camarade Kovatch. Entrant ce
matin dans notre classe, accompagnée de la directrice de l'école, elle
s'est présentée à nous d'une voix éraillée :
« Je suis la cam'rade Kovatch. »
Nous en sommes restés baba.
Pour au moins trois bonnes raisons. La première : Mme Kovatch a
exigé que nous l'appelions « camarade ». Inouï ! La deuxième : elle
était en pantalon d’homme et bottes militaires. La troisième : elle
ressemblait à s’y méprendre à Tchaslav : petite comme lui, les mêmes
traits oblongs, la même bouche en forme de museau pointu avec des
poils au coin des lèvres. En plus, ses cils ainsi que ses cheveux
clairsemés sont jaunes. Une souris tout craché.

Elle a fait l'appel, martelant nos noms et prénoms. Elle nous a
ordonné de nous lever et de lui répondre rapidement : « Présent,
cam'rade institutrice ; présente, cam'rade institutrice ». Engoncé dans
mon blouson, sachant que mon nom de famille allait provoquer de
nouvelles railleries, je me suis mis à transpirer.
« Jan... Jan... vier ! a-t-elle bégayé.
- Présent, camarade institutrice ! ai-je répondu.
- Drôle de nom », a-t-elle fait.
Mes copains de classe riaient sous cape.
« De quelle origine es-tu ? » a demandé la camarade Kovatch.
Ç'a été à mon tour de bégayer :
« Fran... çaise. Papa est fran... çais...
- Que vient-il faire chez nous ? Que signifie ce nom ?
- C’est le premier mois de l'année », ai-je expliqué, rouge de
honte.
Déjà toute la classe ricanait.
« Miodrag, Marie, Loup ! a scandé la camarade Kovatch. Tu as
trois prénoms, comment ça se fait ?
- Ce sont les prénoms de mes grands-pères, maternel et paternel,
s'il-vous- plaît-madame.
- Hum... a dit l'institutrice. Ne m'appelle plus madame.
- Excusez-moi, ai-je répondu. Notre ancienne s'il-vous-plaît-
madame a demandé qu'on l'appelle madame.
- C'est une des raisons pour lesquelles elle n'est plus votre
institutrice », a tranché la camarade Kovatch.
La classe exultait.
« Silence ! a-t-elle ordonné d'une voix stridente, pareille au cri
d'une souris. Miodrag, Marie, Loup, a-t-elle poursuivi. Marie comme
Maria ?
- Marie comme la Vierge Marie, la mère de Jésus », ai-je expliqué.
La camarade Kovatch s’est hérissée :
« La religion n'est plus de mise dans nos écoles d'État. En plus,
c'est un prénom de femme.
- En France, c'est aussi un prénom d'homme, ai-je dit.
- Je t'appellerai Miodrag, un beau prénom serbe, qui veut dire
doux et tendrement aimé, a-t-elle dit sur un ton cassant, et elle a terminé
en employant une expression que mes camarades allaient rapidement
faire leur : Parle serbe, si tu veux que tout le monde te comprenne ! »
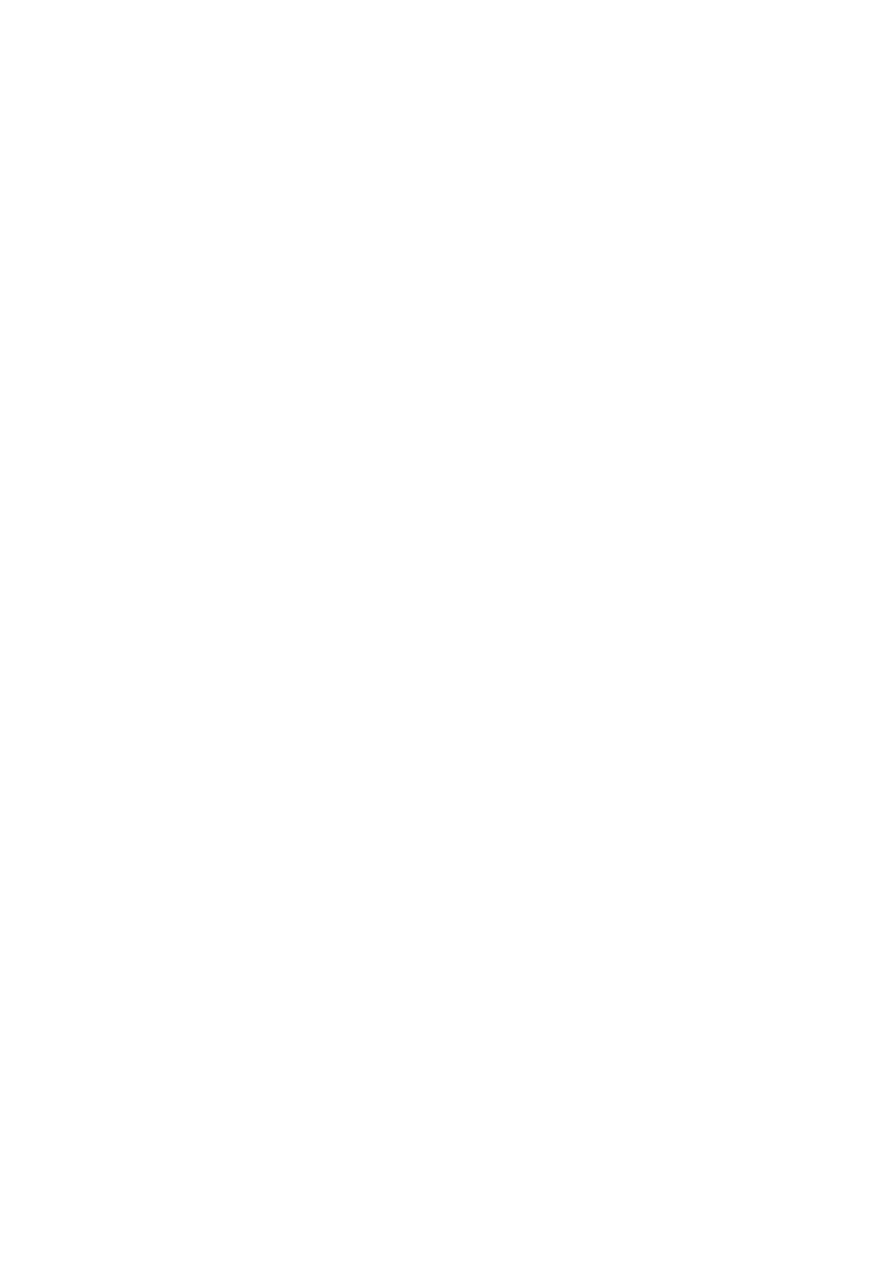
Les élèves se tordaient de rire, tous, excepté Tchaslav. Il était déjà
debout quand elle a prononcé son nom de famille, le nom de son père,
prisonnier, ennemi du peuple.
« Dima Tchaslav !
- Présent ! » a-t-il répliqué sans ajouter « camarade ».
Stupéfaite, devenue soudain rouge telle une écrevisse, la
camarade Kovatch l’a dévisagé comme si elle faisait un mauvais rêve
devant un miroir. Le garçon avait ses cheveux clairsemés, son museau,
ses yeux aux cils jaunes, sa moustache... l'image même d'une souris.
Les paroles de mon oncle Edouard se révèlent justes : « Tout
homme ressemble à un animal. » La seule chose qu'il a oublié de
préciser est qu'il y a sur cette terre de bons et de méchants animaux, de
bonnes et de méchantes souris. Notre nouvelle institutrice appartient
visiblement à cette seconde espèce animale, dont la laideur n'est pas
belle comme celle de Tchaslav, mais laide comme un pou.
« Tchaslav T. Dima, a dit Tchaslav d'un ton aigre.
- Le fils de Todor Dima ? Celui qui... ?
- Le fils de Todor Dima, ennemi du peuple yougoslave », a
répliqué Tchaslav en retenant ses larmes.
Sur le chemin du retour, alors qu’il lançait une pierre dans une
flaque, comme s'il voulait écraser le reflet de son visage, son menton
tremblait toujours.
« Bon sang, a-t-il marmonné entre ses dents. Ils ne supportent pas
qu’on soit différent. Tu es à moitié français, moi à moitié Russe blanc ;
pour eux, nous serons toujours des sang-mêlé, des demi-sang. “Parle
serbe, pense serbe, si tu veux que tout le monde te comprenne !” J'ai
envie de leur montrer de quel bois on se chauffe ! »
L'image mouvante de Tchaslav dans l'eau m'a donné le vertige. Il
avait l'air de ployer sous le poids des années, il faisait beaucoup plus
vieux que son âge. Il vieillit sept ans par an, comme les chiens. Parfois,
j'ai le sentiment de vieillir, moi aussi, sept ans par an depuis le grand
bombardement et cette balle perdue qui a troué une sainte tête.
J'aimerais bien avoir un chien pour que nous vieillissions ensemble.
Si tous les enfants de notre colline se mettaient à vieillir comme
Tchaslav et moi, un beau jour, il n'y aurait plus d'enfants. Nous serions
tous de vieux orphelins.
Avant de quitter notre classe bruyamment, dans ses bottes
militaires, la camarade Kovatch nous a donné, pour le lundi suivant, un

devoir écrit dont le sujet est : « Ma ville et ma rue ». J'ai décidé de le
rédiger d'abord dans mon journal et de le recopier ensuite pour notre
institutrice.
MA VILLE ET MA RUE
Ma ville, capitale de notre pays, s'appelle Belgrade. Cela veut dire
ville blanche. Ce nom m'étonne, car elle est plutôt toute grise. À vrai
dire, je n'ai vu le centre-ville qu'une seule fois, l'année dernière, le jour
de l'anniversaire de mon oncle Edouard Janvier, qui habite avec ma
tante place de la Balance, dans le quartier central. Pour nous y rendre,
ma mère, mon père et moi avons emprunté la ligne numéro six du
tramway, une vieille voiture caca d'oie qui cahote à vous briser les os.
Une fois arrivé dans le centre-ville, au pied de tristes immeubles
vétustes, je n'ai songé qu'à une chose, remonter sur notre belle colline
de Toptchider.
Notre station de tramway, en bas de la colline, s'appelle les Six
Peupliers. Elle est située non loin de la rivière, la Save, à deux pas de
l'endroit où la foudre aux nattes paille a frappé mon oncle Edouard. Le
nom de la station, les Six Peupliers, me paraît illogique. Durant les trois
quarts d’heure que nous avons attendu le tramway, j'ai eu l'occasion de
les compter plusieurs fois : il y en a dix. Exposés aux vents qu'au
printemps la Save souffle dans leur cime, ces géants peureux
murmurent, tremblent, secouent leur ramure et envoient dans l'air
d'innombrables flocons blancs, fleurs transformées en boules de coton.
Peu à peu, entassés par le zéphyr printanier, ces flocons forment
des congères le long des trottoirs. Quand on les regarde, les paupières
plissées, on se croirait en plein hiver, un hiver chaud et qui sent bon, qui
sent le lilas et le robinier. Les yeux toujours mi-clos, on grimpe la pente
qui mène au sommet de notre colline, on traverse des ruelles tortueuses
bordées d'arbres aux fleurs odorantes, qui surplombent des palissades
cachant de petites villas. On traverse un havre de paix, un monde où le
rêve et le réel se confondent : c'est pourquoi les enfants de notre colline
sont toujours un peu songe-creux, étourdis, tête en l'air.
Ma rue s'appelle rue de Septembre. Encadrée de lilas et de
cerisiers, elle est tout aussi tortueuse que les autres. Je ne sais
pourquoi elle porte ce nom. Peut-être parce qu’elle somnole toujours, à

longueur de l’année. En général, en septembre, la nature s'assoupit
sans l’attente du sommeil hivernal. Notre rue sommeille sans cesse, du
printemps à l'hiver.
La majorité de ses maisons sont couvertes de vigne vierge et
chacune d'entre elles peut se vanter d’avoir son propre essaim
d'abeilles qui, de juillet à septembre et tous les jours, se posent sur les
murs pour s'empiffrer de la poussière jaune des fleurs de vigne. On peut
presque dire que notre rue nourrit de miel tout le quartier. Ces abeilles,
arrivées de nulle part le matin, transforment notre rue, durant la journée,
en une véritable ruche bourdonnante. Au coucher du soleil, ivres de
pollen, elle s'en vont quelque part, laissant notre rue dans le silence de
la nuit.
La rue de Septembre jouit d'une grande renommée parmi les
enfants de toute notre colline, grâce à ses trois célébrités : un vrai
Chinois et deux Noirs. À ma connaissance, notre Chinois, ancien
jardinier de l'ambassadeur de Grèce, est le seul Chinois de toute la ville.
Quant aux deux Noirs, un seul est vivant pour de bon. Il s’agit de
l’ancien chauffeur du consul du Canada. Le second Noir, qui dodeline
de la tête d'avant en arrière, occupe la place d'honneur dans la vitrine
de notre épicier, M. Samar. Moulé dans du plâtre coloré, le visage
chocolat noir, il est chargé de faire de la publicité pour la fameuse
chicorée Franck, que nous buvions tous les matins avant la guerre. À
chaque coupure d'électricité, il s'immobilise dans la posture d'un soldat
de plomb.
En dépit de ces coupures très fréquentes et malgré sa chaussée
garnie de pavés turcs, vive la rue de Septembre !
Miodrag, Marie, Loup Janvier
élève de II/b
J'ai signé ma copie de mes trois prénoms pour faire un pied de
nez à notre institutrice, qui avait décidé de m'appeler uniquement
Miodrag, ce beau prénom serbe qui fait rire aux larmes mes camarades
serbes. Je me fiche de mes prénoms comme de ma première chemise.
Je me hâte de noter ici une pensée turque que Radoch a dénichée dans
un livre : « Appelle-moi comme tu veux, appelle-moi même la cruche,
mais ne me casse pas. » De toute manière, chacun de mes proches

m'appelle à sa façon. Tante Milena, comme la camarade Kovatch,
Miodrag. Maminka me dit mon très Mio, mon très doux. Papa m'appelle
Marie-Loup. Quant à oncle Edouard, il m'a surnommé cher Louveteau. À
l'école, on m'a baptisé Jumbo et Mio-feuilles de chou. Parmi tous ces
prénoms et surnoms, celui que je préfère, c’est celui qu’utilise Tchaslav :
vieux. Qu'ils m'appellent comme ils veulent, pourvu qu'ils ne me cassent
pas.
Par manque de temps libre, j'ai négligé mon journal depuis plus
d'une semaine. Comme prévu, lundi dernier nous avons remis notre
devoir à la camarade Kovatch. Trois jours plus tard, j'ai obtenu un, la
pire des notes, gribouillée à l’encre rouge en bas de ma copie.
Dès qu'elle est entrée dans la classe, la camarade Kovatch m’a
demandé d'aller au tableau pour y retranscrire à la craie quelques
extraits de mon devoir, qu’elle m’a dictés.
« “Notre ville blanche est toute grise”, a-t-elle scandé. “Caca d'oie
qui cahote... Mon oncle frappé par une foudre aux nattes paille... Les
peupliers peureux qui murmurent... Les abeilles, ivres de poussière
jaune...” »
Comme on pouvait s'y attendre, au mot « caca » toute la classe
gloussait déjà. Aux « peupliers apeurés qui murmurent », nul ne
réprimait plus ses rires. Enfin, aux « abeilles ivres », tous les élèves
riaient à gorge déployée.
« Silence ! leur a ordonné la camarade Kovatch de sa voix
stridente, tout en tapant le sol de sa botte. Voyons voir, a-t-elle
poursuivi. Pour ce qui est de la grammaire, de la syntaxe et de
l'orthographe, ton devoir est tout à fait correct. Pas une faute. Mais le
contenu, mon jeune cam'rade ! Pour qui te prends-tu ? Pour un futur
écrivain ?... »
Mes oreilles bourdonnent. Mes yeux, pleins de larmes, croisent
ceux de Tchaslav, assis au dernier rang, au fond de la salle. Il lève sa
main fermée à hauteur de sa tempe, son poing serré devient tout blanc.
Il m'envoie son message, celui de l'insurgé. Un instant plus tard,
stupéfait, j'entends ma propre voix, criarde, résonner dans mon crâne :
« Oui, s'il-vous-plaît-madame, je serai romancier !... »
Mi-avril

Depuis qu'elle est devenue membre du Front des femmes
antifascistes, Maminka s'absente souvent. La semaine dernière, elle a
fait vider notre grenier et a offert à ses amies militantes un tas d'objets
qui pourraient être utiles à nos soldats combattant encore sur le front
nord : des couvertures et des draps, de vieux vêtements et chaussures,
notre barbecue, plusieurs casseroles et même ma luge. Je l'ai regrettée,
mais je n'ai rien dit. Après tout, la neige a déjà fondu. Depuis qu'elle se
rend à ses réunions, presque tous les jours, Maminka est devenue
fébrile et agitée. Ses yeux, de plus en plus cernés, brûlent d’un tel feu
que parfois ils me font peur.
Hier, il s'est passé une chose horrible, qui me fait toujours froid
dans le dos quand j’y pense. Du côté opposé à la rivière, notre rue finit
dans un terrain vague couvert de broussailles. Le dimanche, nous y
jouons à cache-cache. Dissimulé dans un creux, sous un arbrisseau,
avec deux autres garçons et Marina, pendant que je les cherchais,
Tchaslav a découvert sous les feuilles mortes une sacoche remplie de
balles de fusil.
Il s'est aussitôt mis à vider quelques-unes de ces cartouches pour
en extraire une poignée de poudre gris argent, qu'il a répandue par
terre en la laissant couler entre ses doigts très adroitement. En moins de
deux, il a ainsi tracé dans le sable un long serpent argenté. L'un des
deux autres garçons, Zorko, a toujours un tas d'objets précieux dans ses
poches ; aussi, je n'ai pas été surpris de le voir sortir de son pull-over
une boîte d'allumettes.
« Ne faites pas ça ! s'écrie Marina, le visage soudain inondé de
larmes, et elle nous quitte en courant.
- Les filles, dit Tchaslav l'air méprisant. Des pisseuses ! »
D'une main un peu tremblante, il met le feu à une brindille et
l'approche de la queue du serpent. La poudre s’enflamme
instantanément. Les écailles de notre reptile poudreux commencent à
siffler et une traînée lumineuse parcourt rapidement l'animal jusqu'à la
tête, laissant derrière elle une peau noire et fumante.
Tchaslav prépare un nouveau feu d'artifice. Nous sommes
émerveillés, et un peu essoufflés, les narines pleines de fumée, pleines
de cette capiteuse odeur de la mort. Alors que Tchaslav est en train de
m'apprendre comment on arrache une balle de sa cartouche en
quelques coups de pierre, une main de fer m'attrape soudain par les

cheveux, me relève et me conduit sans ménagement vers la maison.
Maminka, silencieuse, les yeux brillants de colère, me chasse devant
elle, me talonne dans notre cour, m'inflige derrière mon dos plusieurs
claques et me pousse dans la cave.
La clef rouillée fait deux tours dans la serrure. C'est le bruit
effroyable produit pas le grincement des dents d'une bête, du rat géant
qui règne sur les ténèbres au fin fond de notre cave, du rat qui, l'année
dernière, a coupé de ses dents la patte du chat de nos voisins.
Depuis toujours, j’ai peur de l'obscurité. Comment dire ?
L'obscurité me terrifie et me glace, c’est comme si mes veines se
vidaient de leur sang. Pareil à une mouche décharnée, je pendille, pris
dans cette toile d'araignée noire.
L'interrupteur est à ma gauche. Je le tourne trois fois de suite :
l'ampoule est grillée. Affolé, épouvanté, je cogne contre la porte avec
mes poings, mes pieds, mon front. Je crie comme un damné, j'appelle
au secours, je hurle à tue-tête. La porte s'ouvre enfin et la lumière du
jour m'aveugle. Au milieu de ce halo lumineux, j'aperçois une ombre qui
exhale le parfum de Maminka.
Elle me prend dans ses bras et me serre sur sa poitrine.
« Jamais plus ! répète-t-elle en pleurant à chaudes larmes.
Promets-lemoi : jamais plus ! Au grand jamais ! »
J'avale mes larmes et je prête serment :
« Au grand jamais, maman ! »
Le jour même, après le départ de Maminka pour la réunion des
Femmes antifascistes, j'ai retrouvé Tchaslav, Zorko et Radoch au bord
du bassin de l'ancien jardin de l'ambassadeur grec. Le verger qui
entoure ce bassin et la maison abandonnée pendant la guerre sont
envahis par les plantes sauvages et les mauvaises herbes. La pièce
d'eau de l'ambassadeur n'a rien à voir avec le petit bassin en béton que
papa a construit chez nous juste avant la guerre, que d’ailleurs nous
n'avons jamais utilisé, et qu’il a récemment fait combler pour agrandir
notre potager et permettre à notre Loudmila d’y cultiver des tomates et
des choux-raves.
Bordé de marbre jaune, le bassin de l'ambassadeur est ovale,
comme un grand œuf. Il est assoupi à l'ombre du feuillage de plusieurs
saules pleureurs. Pour nous y rendre, nous avons fait un trou dans la
clôture d'épines qui protège le jardin. C'est un endroit qui m’emplit

toujours de crainte, probablement à cause de la présence de son
gardien en bronze. Nu, accoudé sur un bloc de pierre, au bord de l'eau,
couvert de taches vert-de-gris, l’homme veille sur son royaume
d'ombres vacillantes. Il brandit, l'air austère, une fourche à trois pointes.
« Ça s'appelle un trident », nous a expliqué Radoch.
En serbo-croate, Radoch signifie réjouissance. Radoch ressemble,
avec ses membres lourds et trapus, son visage empâté et les poches
verdâtres sous ses yeux globuleux, à un crapaud. Un crapaud qui ne
cesse de sourire. Malgré ses traits épais, Radoch a une bonne tête. Il
est de deux ans notre cadet et fils d'une bibliothécaire. Il affirme lire un
livre par jour, avoir lu tout le mur ouest de la bibliothèque de notre
quartier. Pourquoi le mur ouest ? Parce que toutes ses pensées sont
dirigées vers l'Occident, où vit son grand frère.
Radoch garde un souvenir intact de tous les livres qu'il a lus.
Grâce à ce don, nous avons pu identifier le gardien moisi du bassin de
l'ambassadeur. D'après le Dictionnaire de poche de la mythologie
grecque, il s’agirait de Neptune, dieu de la mer. Dans son palais, au
fond des eaux, armé de son trident, il conduit sur son char des chevaux
à crinière d'or parmi les vagues.
Aujourd'hui, Radoch est arrivé lui aussi armé. D'un long manche
pointu, muni d'un clou recourbé.
« Nous allons jouer à Neptune, nous a-t-il dit.
- Nous n'avons pas de chevaux, ai-je remarqué.
- Tant pis, m'a-t-il répondu. Nous avons des crapauds. »
Durant la guerre, le bassin a presque entièrement tari, sauf au
pied de Neptune, où une couche d'eau vert jade recouvre toujours la
vase, répandant une odeur de pourri. Des nénuphars à fleurs jaunes
cachent à la vue leurs habitants.
En écartant brutalement deux larges feuilles avec son manche,
Radoch provoque dans ce petit monde une véritable panique. Des
insectes à longues pattes se mettent à courir en tous sens sur la surface
de l'eau. De petites flèches, rapides comme l’éclair ! Elles font émerger
de sous les nénuphars des bosses pleines de verrues aux gros yeux
saillants. Radoch choisit sa proie, le plus grand des crapauds, qui
essaie de replonger. En vain, la pointe crochue du garçon est plus
rapide. Elle frappe le sommet de sa tête, fait jaillir le sang, transperce,
embroche, tire l’animal de la fange et l'empale sur l'une des trois dents

du sceptre de Neptune. Ses entrailles coulent sur le visage du dieu
marin comme des larmes de sang.
Radoch remet son manche entre les mains de Zorko.
« C'est à ton tour », lui dit-il en haletant.
Zorko, qui est un as en gymnastique, qui court et saute à la
manière d’un lévrier, est deux fois plus rapide que Radoch. En cinq sec,
il prend d'assaut un deuxième crapaud. Il enfile son ventre sur sa pointe,
l'embroche et l'empale sur le trident du dieu sanglant. Le sang gicle
partout, les fleurs jaunes des nénuphars sont devenues toutes rouges.
« C'est à ton tour », dit Zorko à Tchaslav.
Celui-ci en fait autant, transperce, enferre, embroche, empale un
nouveau crapaud. Neptune est de nouveau souillé de sang.
« C'est à ton tour », me dit-il d'une voix enrouée.
Le cœur soulevé, je suis l’exemple de mes camarades. Nous
sommes hors d’haleine, pris d'une étrange ivresse ; nous transperçons,
enfilons et empalons tour à tour. À la place des crinières d'or des
chevaux de Neptune, nos crapauds ont des crinières écarlates...
Subitement, un cri déchirant poussé dans notre dos nous fait
tomber de notre haut. Cheveux roux en broussaille et petits yeux
humides d'écureuil, Marina hurle :
« Arrêtez ! Arrêtez ! »
Sa belle blouse blanche est tachée de sang.
Bien qu'elle ne soit pas sourde-muette comme ses parents, elle a
une voix de muette ; on dirait qu’elle souffle dans un entonnoir en
remuant les lèvres exagérément.
« La mère de celui qui tue un crapaud mourra », crie-elle.
Le silence de mort qui s'installe est comme une grande cloche de
verre qui nous recouvre et nous étouffe.
« Qui t'a dit ça ? balbutie Radoch, assombri.
- Ma grand-mère », répond Marina.
Et, de cette même voix qui semble émaner d’un entonnoir
invisible, elle répète son horrible prédiction :
« La mère de celui qui tue un crapaud mourra.
- Je m'en fiche, dit Tchaslav en ricanant. Je ne risque rien. Ma
mère est morte depuis toujours. »
Le sifflement triste d'un crapaud m'étourdit. Mon menton tremble
comme chaque fois que je suis sur le point de pleurer. Je bredouille
quelques mots et je m'enfuis par le trou ménagé dans la haie sans

prendre garde aux épines. Les paroles de Marina me poursuivent : « La
mère de celui qui tue... mourra. »
Je m'arrête devant la vitrine de M. Samar pour examiner quelques
égratignures provoquées par les épines. Le Noir de plâtre me dit bonjour
en branlant la tête d'avant en arrière. Je ne lui réponds pas comme
d'habitude, je n'ai aucune envie de plaisanter. La prédiction de Marina
résonne encore à mes oreilles, et mon menton tremble
dangereusement.
C’est Radoch qui a commencé, il a tué le premier. Pourtant, il n'est
pas méchant, il n'a aucune propension au mal. C'est un garçon aimable,
bon comme du bon pain. Son seul défaut est de ressembler à un
crapaud. « Chaque homme ressemble à un animal », dit oncle Edouard.
J'ajouterais : chaque homme hait l'animal auquel il ressemble. C'est
pour cette raison que Radoch a commencé, c'est pour cela que les
hommes tuent les animaux. En effet, c’est en eux qu’ils tuent les
animaux, pour oublier que tous, jadis, nous avons été des bêtes.
De retour à la maison, j'ai trouvé Maminka dans la cuisine en
compagnie de Mlle Lecco, une lointaine parente, étudiante en
médecine. Malgré son jeune âge, c’est la meilleure amie de maman. Par
chance, toutes deux étaient très agitées et n'ont prêté aucune attention
à mes égratignures. Sur la table m'attendait ma tartine de graisse de
porc, saupoudrée de paprika.
« Mange, moustique », m'a dit Maminka.
Quand elle est distraite, elle m'appelle moustique. Un surnom de
plus et que je n'aime pas. Je ne ressemble pas à un moustique, à part
mes jambes, minces comme des allumettes. Je grignote mon goûter au
fond de la cuisine et j’observe Maminka du coin de l'œil. Je n'aime pas
sa fébrilité de tous ces derniers jours, son regard anxieux, ses lèvres
pâles, qui pincent une cigarette.
Mlle Lecco est venue faire un gâteau dans notre four. Leur cuisine
a été détruite lors du deuxième grand bombardement, celui que nous
ont infligé nos alliés anglais. « Des impérialistes, complices des
communistes, dit Mlle Lecco. Envoyés exprès chez nous pour semer la
terreur, pour travestir les communistes en libérateurs. »
Je n'y comprends rien, mais je trouve notre parente Lecco, qui est
myope comme une taupe, fort sympathique.

Depuis quelques instants, Maminka et elle parlent à mi-voix. Je
dresse l’oreille en les regardant à la dérobée. Je les trouve très grandes,
si grandes que leur tête touche presque le plafond. Je les observe
comme les crapauds nous observaient au bord du bassin de
l'ambassadeur. Moi, le tueur de crapauds, dont la mère mourra pour
payer mon crime.
Soudain, un mot de Mlle Lecco me parvient :
« Vous fumez beaucoup trop, chère », dit-elle.
La réponse de Maminka me coupe le souffle.
« Parfois, et de plus en plus souvent, murmure-t-elle, je prie le
Seigneur pour qu'une tuberculose galopante m'emporte. »
La nuit suivante, j'ai fait un rêve pénible. Je rêve qu’un clapotis me
réveille. Je rêve que je me redresse dans mon lit. Je tends l’oreille à un
bruit qui me parvient dans l'obscurité : celui des pattes d'un animal qui
patauge lourdement sur le sol détrempé de ma chambre. Un instant plus
tard, je distingue au milieu de la pièce un énorme crapaud qui se dirige
clopin-clopant vers la chambre à coucher de mes parents. Ses pattes,
couvertes d'affreuses verrues, laissent derrière elles des traces
visqueuses et scintillantes. Moi, le tueur de crapauds, je vais enfin être
puni. Je sais de façon certaine qu'il va s'attaquer à Maminka, qu'il va lui
cracher droit dans les yeux, gluante, sa tuberculose galopante. Horrifié,
j'essaie d'avertir ma mère, de pousser un cri, en vain ; je me réveille,
cette fois pour de bon.
Le reste de la nuit, je n'ai dormi que d'un œil, ressassant dans ma
tête cette maudite tuberculose, un mot dont je ne connais pas vraiment
le sens mais qui m’emplit d'effroi. Au lever du jour, quand j’ai bougé les
jambes, j'ai senti que sous mes hanches c’était froid et l'humide. Si
Maminka, papa et oncle Edouard apprenaient quelle chose honteuse il
vient de m’arriver, je me tuerais. Je me tuerais aussi s'ils apprenaient
que je suce toujours mon pouce. Seul mon journal peut le savoir.
Serviteur fidèle et complice muet, il gardera mes secrets les plus
humiliants, il me suivra dans la vie et nous vieillirons ensemble, sept ans
par an. Il m'aidera à devenir écrivain, à surmonter tous les obstacles et à
atteindre la force de l'âge. Pour couronner cette vie de rêve, à soixante
ans, je redeviendrai un enfant.

Le 17 avril
Aujourd'hui, je note la date précise pour plusieurs raisons. Je ne
voudrais pas que les mites de l'oubli rongent les souvenirs de ce jour.
Très tôt ce matin, pendant que Maminka préparait mon petit déjeuner, je
me suis enfermé dans les toilettes de notre Loudmila avec un vieux livre
de papa, Le Petit Larousse illustré, sans demander à personne la
permission de le lire. Mon objectif était d'y dénicher ce maudit mot :
tuberculose galopante. Malgré mon ignorance de l'alphabet français, j'ai
réussi à le trouver à la page mille vingt-deux, grâce à la ressemblance
étonnante de quelques caractères latins et cyrilliques.
Malheureusement, je n’ai pas compris un seul mot de la définition.
Une demi-heure plus tard, je me suis embusqué au coin de notre
rue et de celle qu'habite Radoch, à l'endroit même où il doit passer pour
aller à l'école.
Par chance, il se trouve que la tuberculose figure bel et bien sur le
mur ouest de la bibliothèque de sa mère, dans un livre intitulé Les
Maladies infectieuses de nos jours, que le cerveau de Radoch avait
photographié parfaitement.
« Maladie souvent mortelle, produite par un bacille qui attaque les
poumons », a-t-il dit.
La gorge serrée, les oreilles bourdonnantes, j'ai à peine entendu la
suite de son explication. Une horrible pensée a envahi tout mon
cerveau, une pensée qui a failli me faire éclater le crâne. Maminka ne
m'aime pas, ni moi ni papa, vu qu'elle songe à être emportée... Maminka
ne nous aime plus...
À l'école, ces mots roulant dans ma tête, sourd et aveugle à tout
mon entourage, je n'ai pas entendu notre institutrice me demander
d'aller écrire quelque chose au tableau. Tchaslav, assis à côté de moi,
m’a secoué par l’épaule. Ce geste brusque et inattendu m'a fait vomir
sous le banc tout mon petit déjeuner, une gorgée de lait, une tranche de
pain mal mâché et un peu de confiture d'abricots de l’abricotier que
Maminka a planté de ses propres mains.
Le front toujours posé sur la table, j'ai entendu la camarade
Kovatch, qui s'efforçait de surmonter son dégoût, demander d’une voix
aigre :
« Peux-tu rentrer seul à la maison ? »

J'ai acquiescé en hochant la tête et je me suis doucement esquivé,
avec mon cartable, sous les regards compatissants des élèves.
Compatissants et méprisants. Je n'ai pu m'empêcher de boiter un peu
en sortant, ma chaussure orthopédique était chez le cordonnier.
Dix minutes plus tard, en me faufilant dans le jardin de
l'ambassadeur, je me suis retrouvé devant le bassin, face à face avec
Neptune. La forte pluie de la nuit précédente avait rempli un quart du
bassin. Les ombres des saules pleureurs frissonnaient sur l'eau et se
reflétaient sur le visage du dieu marin. Jamais ce lieu n'avait été aussi
sinistre, ni aussi inquiétant.
Me voilà en tête à tête avec cet homme de bronze, dont le visage
sombre est toujours taché de sang séché. Il fronce les sourcils, me
transperce du regard, comme lorsque j'ai transpercé ses crapauds. Mon
menton tremble de plus en plus, je vais fondre en larmes. Je pose mon
cartable juste au bord de l'eau, moi, le tueur d’animaux innocents,
l’assassin de ma propre mère. Je m'agenouille et je colle mes paumes
l'une contre l'autre comme pour une prière, moi qui n'ai jamais imploré.
« Pardonne-moi, Neptune, dis-je. Plus jamais. Au grand jamais. »
Un jeu d'ombres sur son visage maussade donne l'impression qu'il
remue la bouche. Suspendu à ses lèvres, j’y lis avec difficulté :
« Ne pas pardonner !... »
En même temps, un gros crapaud que je n'avais pas encore
remarqué, perché sur une feuille de nénuphar, gonfle terriblement la
gorge et laisse échapper un sifflement plaintif, une sorte de
gémissement. Il approuve les paroles de Neptune :
« Ta mère mourra !... »
Je lance un cri sourd et je prends mes jambes à mon cou.
Plus tard dans l'après-midi, toujours troublé par l'idée qu’un
danger plane sur Maminka, j'attends la venue de Mme Karpov, la grand-
mère de Tchaslav, qui donne des leçons de langues étrangères aux
enfants de notre colline. Elle m'enseigne le russe. Maminka a un faible
pour tout ce qui est russe, et l'année prochaine nous commencerons
l'apprentissage de cette langue à l'école. Les Russes sont nos frères
libérateurs, répète la camarade Kovatch, monténégrine et admiratrice de
nos « grands frères slaves ».
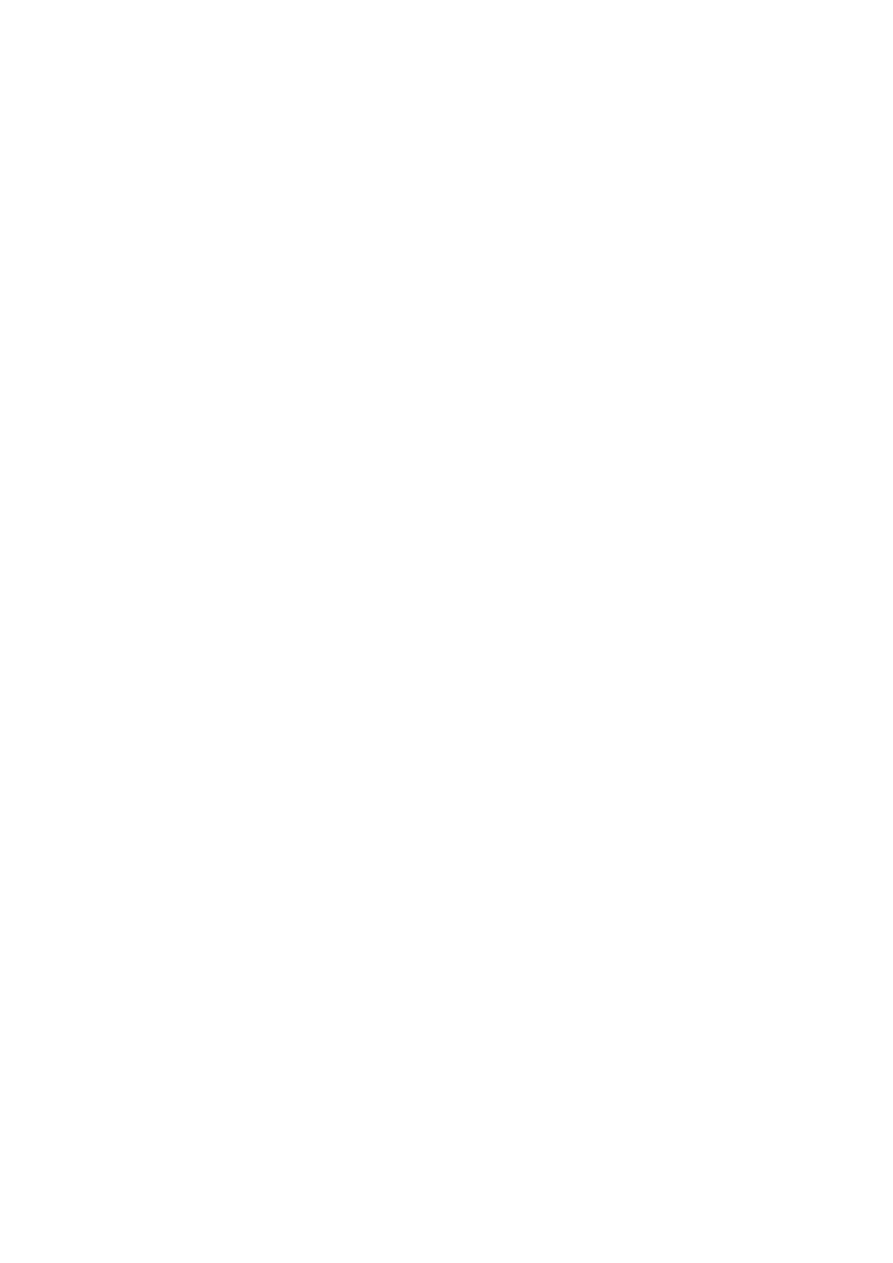
Quand je monte sur le coffre de la véranda, je domine la moitié de
notre rue et je peux aisément guetter l'arrivée de Mme Karpov. Vêtue
d'une fourrure huit mois par an et traînant à grand peine un corps trapu
planté sur des jambes courtes, elle ressemble à un hamster, le petit
rongeur qui entrepose des aliments dans les poches de ses joues. À
l'égal d'un hamster, Mme Karpov est sans cesse en train de grignoter
quelque chose. Tel un hamster, elle a de grands yeux pétillants, une
moustache hérissée, des lèvres charnues qui font la moue et des
oreilles toujours dressées.
Veuve d'un marchand de diamants d'Odessa, elle a fui la Russie à
la vieille de la révolution d'Octobre, avec sa fille unique et ses trois
chattes. Sa fille, après avoir épousé le père de Tchaslav, est morte en
couches. Bien entendu, cette suite de malheurs, cette « boule de neige
noire » - comme Mme Karpov appelle sa vie de famille -, ne pouvait
s'arrêter là : son gendre a été emprisonné il y a plusieurs mois, et
maintenant elle se voit obligée, à l'âge de quatre-vingt-deux ans,
d'enseigner le russe et le français pour joindre les deux bouts.
Dès qu'elle arrive chez nous, deux fois par semaine, notre
Loudmila lui sert ses « joliettes », des gâteaux aux noix faits d'après une
recette de la grand-mère de papa, de petits cubes sucrés qui fondent
dans la bouche. Les noix, notre Loudmila se les procure grâce au grand
noyer de nos voisins, dont une branche surplombe notre arrière-cour.
Notre Loudmila dit qu'elle ne se les approprie pas indûment : elle attend
simplement qu'elles tombent toutes seules à l’automne dans son
potager.
« Joli-joli », dit Mme Karpov en avalant deux joliettes et en
entreposant deux autres dans les poches de ses joues.
Notre Loudmila s'en va et nous restons seuls à la grande table de
tonton Pinter. Mme Karpov rumine les gâteaux et sort de son sac un
livret de contes de fées russes.
Je l’écoute lire d'une voix nasillarde - puisqu'elle mâche ses
joliettes en même temps - et il me faut une bonne demi-heure pour
m'enhardir à exposer la requête que je retourne dans ma tête depuis le
matin, depuis le moment humiliant vécu dans les toilettes de notre
Loudmila, Le Petit Larousse illustré dans les mains.
« Madame Karpov, dis-je. J'adore les contes russes. Je suis fou
des contes russes.
- Moi aussi », fait-elle. »

Et elle glisse avec adresse les deux derniers gâteaux dans les
poches de ses joues.
Je m'entends bégayer :
« Cependant, madame, si vous n'avez rien contre, j'aimerais
apprendre aussi quelques contes français.
- Tiens, fait-elle sur un ton badin. Tu voudrais apprendre le
français. »
Je m'entends encore balbutier :
« Oui, madame.
- Pourquoi ?
- Pour faire une surprise à papa et à maman.
- Hum, fait-elle. Un garçon sage ne devrait rien cacher à ses
parents.
- Je ne cache rien. Je voudrais leur faire une surprise, le jour de
l'anniversaire de papa.
- C'est gentil, dit Mme Karpov. Kharacho. À partir d'aujourd'hui
nous consacrerons une heure par semaine à cette belle langue, qui
embaume les fleurs et les fruits.
- Comme le parfum parisien de maman », dis-je.
Très étonnée, Mme Karpov fronce les sourcils, et je me hâte de lui
poser une question flatteuse :
« Pourquoi, madame, avez-vous appris toutes ces belles langues
parfumées ? »
Elle sourit et dit :
« Le russe pour parler à mon âme, le français pour bavarder avec
mon cœur.
- Et le serbe ?
- Pour parler à mon ventre. »
Elle remet les contes russes dans son sac, d’où elle sort un autre
petit livre. Ses yeux de hamster pétillent plus que jamais tandis qu'elle lit
le titre d'un ton solennel.
«
Le Petit Prince, d'Antoine de Saint-Exupéry. »
À ma grande surprise, au lieu d'ouvrir le livre à la première page,
elle l'ouvre à la dernière et lit l'ultime phrase en détachant bien les
syllabes :
« Et au-cune, au-cune grande per-sonne ne com-pren-dra ja-
mais...
- Mais, c'est la fin, madame », dis-je, désenchanté.

Mme Karpov me dévisage, un sourire tendre et moqueur accroché
à ses lèvres.
« La fin se cache dans tout début comme le ver dans la pomme. Et
tout recommence à la fin. Nous allons nous mettre en train par la
“grande personne” qui ne comprendra jamais la “petite personne”.
Répète après moi : Je suis petit, je suis petit... »
Je répète :
« Je suis petit... »
Après le départ de Mme Karpov, je ne bouge pas de la table
marron et tabac. L'après-midi touche à sa fin et la salle à manger se
remplit d'ombres qui, sans raisons, m’envahissent d’une crainte
grandissante. Telle Mme Karpov ruminant ses joliettes, je remâche les
mots français que je viens d'apprendre : petit et grand, petit comme petit
jardin, petit comme petit enfant, petit comme petit déjeuner. Puis, grand
comme une personne adulte, grand comme un grand arbre, grand
comme un homme important, grand comme un enfant très grand pour
son âge...
Malgré la présence des ombres inquiétantes qui sourdent de
derrière les meubles, je contemple mon reflet dans la table de tonton
Pinter, je suis fier comme un pou, je brave l'obscurité qui me fait peur.
Je joue avec mes mots français comme avec des dominos, je les roule
dans ma tête comme des billes, je les croise, les entrechoque, et ce jeu
aboutit à des phrases étonnantes :
Je suis un petit enfant.
Je ne comprends pas les grandes personnes.
Les grands ne me comprennent pas.
Je serai un grand enfant.
Je ne me comprendrai jamais...
Contrairement à Mme Karpov, je décide de parler français et à
mon âme et à mon cœur.
Puisque mon âme et mon cœur parlent la même langue.
La porte grince et je sursaute. C'est notre Loudmila, la larme à
l’œil. Quand elle pleure, ce n’est que d'un seul œil.
« Mon Drag-Mio », chuchote-t-elle.
Elle m’appelle depuis toujours, mon cher-doux, depuis que je suis
né, depuis qu’elle est venue à la maison s'occuper de moi et m'offrir le
lait que Maminka n’avait pas. Je remarque à présent, pour la première

fois, qu'elle ressemble à notre regrettée Diana, avec ses grands yeux
rougeâtres et larmoyants, son haut col blanc, qui rappelle dans la
pénombre la barbe d'une chèvre. Il ne lui manque que les cornes.
« Mon Drag-Mio, dit-elle dans un soupir. J'ai un mot que Maminka
a laissé pour toi. »
Elle déroule un bout de papier et ma gorge se serre.
« “Mon très Mio”, lit-elle en avalant ses larmes. “Je t'écris cette
petite lettre pendant que tu es à l'école. Tu passeras la nuit prochaine
sans papa ni moi. Notre Loudmila veillera sur toi. Nous sommes partis
nous incliner devant la dépouille de tonton Pinter. Il est mort la nuit
dernière, dans son sommeil. Nous serons de retour de la campagne
demain, dans l'après-midi. Mille bisous, Maminka.” »
Sa lecture achevée, notre Loudmila éclate en sanglots et se
précipite dehors. Je reste tout seul, cloué sur place. Mon menton se met
à trembler dangereusement pendant que j'effleure du bout des doigts la
surface de la grande table. Polie comme un miroir, d'un brun couleur de
marrons lustrés, elle me renvoie l'image du visage rayonnant de tonton
Pinter, de ses yeux étincelants et de sa bouche édentée. Quand il
travaille son bois et le caresse, rêveur, il lui fredonne un air.
Tonton Pinter est le premier mort de ma vie. La mort dans l'âme, je
me pose de pénibles questions sans réponse. Être mort ? Disparaître ?
Qu'est-ce que la mort ? Où s'en vont tous ces morts qui quittent notre
terre ? Où est parti le bon tonton Pinter ? Y a-t-il une terre des morts,
couleur de marrons lustrés comme sa table magique ? Ces questions, je
devrais les poser à Radoch : peut-être son mur ouest recèle-t-il une
réponse ?
Il me faut apprendre le français le plus rapidement possible, pour
pouvoir lire Le Petit Larousse illustré, qui me fournira toutes les
réponses. Je n'ai jamais vu un être mort, hormis les crapauds empalés
sur le trident de Neptune.
« La mère de celui qui tue un crapaud mourra ! »
Quelle horreur !
Moi, l’assassin des animaux, verrai-je un jour prochain le visage
lustré de Maminka au fond de la table sombre de tonton Pinter ?...
Un dimanche d'avril
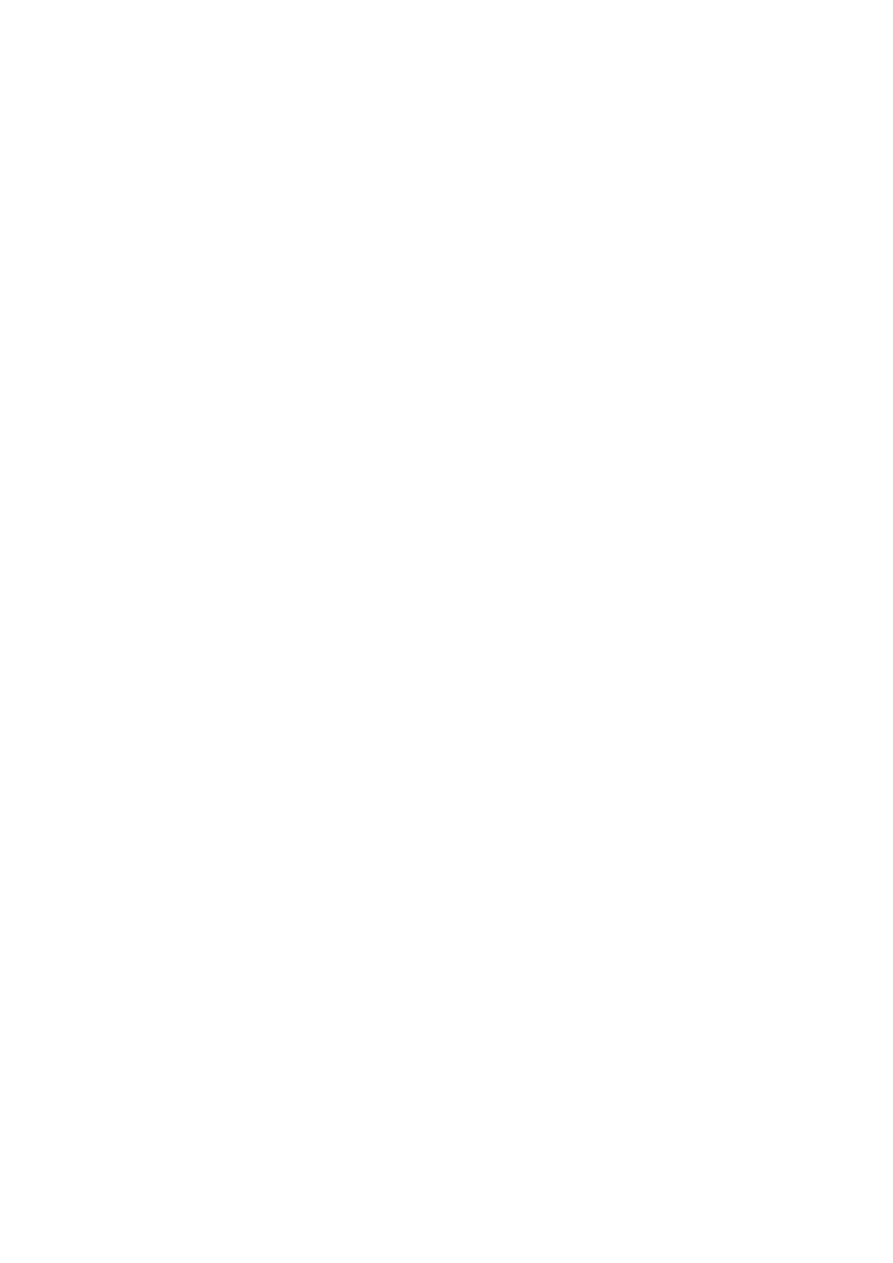
Ce matin, un premier essaim d'abeilles s’est posé sur notre vigne
vierge, y restant très peu de temps. Mais suffisamment pour que ces
petites gloutonnes se rendent compte que leur poussière jaune n'était
pas encore à point. Le bourdonnement de leurs ailes m'a tiré de mon
sommeil et un parfum frais venu du jardin m'a chassé de mon lit.
Pieds nus, vêtu de ma seule chemise de nuit, je sors dans
l'arrière-cour par la porte de service. Le soleil bas m'éblouit. Pendant la
nuit, l'abricotier de Maminka a fleuri : un vrai éventail de fleurs rose clair.
Je m'empresse de rejoindre le potager pour saluer ma plante préférée,
que notre Loudmila a installée dans le sable, au bord du bassin.
Ma favorite, que l'on appelle prkoss, a de drôles de branches fines
et charnues qui rampent entre les cailloux, pareilles à des vers de terre,
au lieu de grimper comme celles de la vigne vierge. Prkoss veut dire défi
et ce nom n'est pas le fruit du hasard. Nos défis obstinés luttent avec
acharnement pour leur survie. Privés de toute goutte d'eau dans leur
minuscule désert de sable, ils offrent chaque matin à notre vue un petit
miracle : leurs fleurs multicolores, blanches, rouges, roses et bleu-
mauve, naissent à l’aube et meurent au coucher du soleil.
Elles me font penser aux éphémères, ces joyeux insectes qui ne
vivent qu'un jour et se jouent de la mort.
Fragiles et coriaces à la fois, on dirait qu'elles sont de cire. On ne
sait jamais quelle couleur naîtra le lendemain, et cette incertitude est
devenue un jeu quotidien entre Maminka et moi : deviner la couleur du
gant que nos défis iront jeter à la face du monde. Je suis heureux quand
je gagne ce pari et je suis tout aussi heureux si c’est Maminka qui
gagne. Quand je serai grand, je ferai tout mon possible pour me
comporter comme nos vaillantes fleurs, qui ne craignent pas les
obstacles.
Je les compte tous les matins, alors qu’elles ressemblent à de
petites bougies de Noël. Aujourd'hui : quatre blanches, trois rouges,
quatre roses et une seule bleu-mauve. Je suis à égalité avec Maminka !
Après une nuit sans rêves, je me sens aussi léger qu'une fleur de
peuplier. Comme par miracle, les ombres d'hier soir se sont volatilisées,
ainsi que cette douleur sourde, sous la poitrine, qui me poursuit depuis
des jours. Mon corps vibre comme la corde d'un arc tendu. J'ai soudain
envie de m'étendre, de me rouler dans l'herbe, j'ai envie de chanter avec
les couleurs de nos fleurs, moi qui ne chante que sur une seule note.

Pour embellir davantage cet instant, notre Loudmila rentre du
marché. Elle est de mauvaise humeur à cause de notre poulet
dominical. La volaille est devenue introuvable, nous allons de nouveau
manger des nouilles aux lardons et à la sauce tomate. Je m'en fiche,
des nouilles : notre Loudmila est passée chez le cordonnier et elle
m'apporte ma chaussure orthopédique. Pour être plus précis, elle
m'apporte mes deux chaussures, raccommodées et transformées en
sandales. Ces dernières semaines, j'ai beaucoup souffert dans ces
chaussures, devenues trop petites pour moi.
Cela tombe magnifiquement bien, le jour de l'ouverture du tournoi
de billes durant lequel notre équipe, les enfants de la pente ouest de la
Colline, affronte les joueurs de la pente nord. Même si je ne suis que
remplaçant, au moins je ne boiterai plus autour du terrain de jeu.
Pendant que je me chausse en toute hâte, devant la fenêtre
entrouverte de ma chambre, j'entends la voix de Maminka dans la cour.
Elle parle à son amie, Mlle Lecco, qui est venue une fois de plus faire
cuire sa tarte aux pommes dans notre four. Je ne l’espionnais pas :
plutôt mourir ! Ses paroles ont frappé d’elles-mêmes mon oreille.
« Il vivait seul avec son chat. Quand les pompes funèbres sont
arrivées, le pauvre animal a sauté sur son cercueil. Imaginez- vous, ma
chère, parfaire sa propre bière avant de se suicider ! Un suicide, nul
doute. Il a surpassé là tout ce qu'il avait fait de son vivant, un vrai chef
d'œuvre. Ses ornements sont aussi sobres que l’était sa vie, mais la
couleur du bois est inoubliable, noble, une couleur marron foncé... »
Ma gorge se serre de nouveau. Lorsque Maminka décrit la mort
de tonton Pinter et la beauté de son cercueil, sa voix exprime la même
sombre délectation que le jour où elle a parlé de la tuberculose
galopante.
« Noble, inoubliable », vient-elle de dire pour un cercueil. «
Couleur marron foncé. » Ses paroles m'ouvrent les yeux. Je ne sais ce
qu’est la mort, mais je connais bien dorénavant sa couleur : un brun de
marrons lustrés, comme celui de la table de notre salle à manger.
Toutefois, un mot tres étrange de Maminka jette le trouble dans
mon esprit : suicide. Il faudra que j’en demande la signification à
Radoch, il figure peut-être sur son mur ouest.
De même que l'année dernière, notre tournoi de billes a lieu près
de l'épicerie de M. Samar, au coin de notre rue et de celle où habitent

Tchaslav et Radoch. La gorge toujours un peu serrée, je les rejoins juste
au moment où les deux équipes se mettent en place sous le regard mi-
moqueur, mi-tendre de notre épicier. En effet, ce tournoi se déroule
sous le haut patronage de M. Samar, qui décernera un prix à l'équipe
gagnante, un sac de bonbons fourrés pour la demi-finale et une boîte de
marrons glacés à l'issue de la finale, la semaine prochaine. Les
gagnants recevront ce trophée tant convoité des mains de Maya, la très
belle fille de l'épicier, devant qui nos genoux jouent des castagnettes.
Les règles du tournoi sont très simples. Chaque équipe est
composée de trois joueurs, que Radoch a surnommés billeleurs, et d'un
remplaçant. Chaque joueur dispose de cinq billes faites de n'importe
quelle matière, mais dont la taille ne doit pas excéder deux centimètres.
Le terrain de jeu entoure un trou, à peine plus grand que mes deux
paumes, où il faut faire tomber les cinq billes après une lutte acharnée
contre des adversaires qui se servent de mille ruses pour vous éloigner
du trou.
On tire à tour de rôle : l'un des nôtres, puis l'un des leurs. Nos
billeleurs sont Tchaslav, Radoch, Zorko, et moi, le remplaçant. Les
leurs : un garçon couvert de taches de rousseur et deux redoutables
jumeaux aux cheveux gris et raides tels des piquants de hérissons.
Signe de leur mépris : il sont venus sans remplaçant.
Les deux équipes sont déjà en passe de disposer leurs billes au
moment où je m'installe parmi les spectateurs : ma voisine Marina, M.
Samar, lunettes et moustaches couvertes de farine, et sa fille, Maya,
un ange de beauté, qui pour l’occasion a orné ses longues nattes de
deux rubans blancs. Chaque fois que je lui lance un regard à la
dérobée, je ressens un drôle de picotement dans ma poitrine, pareil à
celui que j'ai éprouvé lors ma bronchite.
Mon attention est pourtant vite attirée par les cris de surprise que
provoquent des billes que Radoch vient de sortir de sa poche, le cadeau
de son grand frère, qui vit au Canada. Du jamais vu : des boules de
verre, transparentes et multicolores, avec à l’intérieur des spirales
magiques qui, quand elles roulent, vous font tourner la tête.
« Bon sang ! dit Tchaslav, ébahi. Des billes américaines, des billes
atomiques ! »
Généreux et débonnaire, Radoch lui en offre trois en échange de
trois boules en terre que Tchaslav a fabriquées lui-même, colorées et
cuites dans le four de sa grand-mère.

« Un champion comme toi, dit Radoch, mérite des armes dignes
de son savoir-faire. »
Le visage empourpré et très digne, Tchaslav répond à l'attaque
des deux jumeaux : d'un coup de maître il pulvérise l'une de leurs billes.
Au lieu de faire rouler sa bille par terre avec l'index et le majeur, à la
manière de tous les autres joueurs, il la lève jusqu’à ses genoux et la
projette avec son pouce comme une bombe allemande. À son deuxième
tir, il met hors de combat deux nouvelles billes en pierre de nos rivaux et
une demi-heure plus tard nos adversaires se voient obligés de jeter
l'éponge au grand regret de leurs supporters.
En observant Maya en train de remettre à Tchaslav un petit sac de
bonbons fourrés, je ressens de nouveau des picotements dans ma
poitrine. Maya est belle comme le jour et elle ressemble à une biche,
tout comme Maminka, une biche blonde aux yeux bleu ciel, aux yeux
souriants et empreints de douceur qui vous parlent avant même qu'elle
n'ouvre la bouche.
C’est alors que Radoch crée une nouvelle surprise, bien plus
grande que la précédente.
La coutume veut qu’à la fin d'un match les membres des deux
équipes apposent leur signature au bas d’un document que Maya a
rédigé de sa plus belle écriture, aux lettres anguleuses :
« Nous, heureux gagnants... et Nous, malheureux perdants,
certifions aujourd’hui que... »
Elle présente le papier à Radoch, notre capitaine, le plus âgé des
concurrents. Il sourit avec malice et sort de sa poche un stylo qui nous
éblouit - encore un cadeau de son grand frère, un crayon à bille en
plastique rouge cerise qui nous coupe littéralement le souffle.
« Bon sang ! dit Tchaslav. Un stylo atomique ! »
Même le Noir, dans la vitrine de M. Samar, cesse de branler sa
lourde tête, probablement à cause d’une coupure de courant, mais ses
yeux écarquillés expriment la stupeur.
Un peu embarrassé, je trouve pourtant le moment opportun pour
me servir de l'expression préférée d'oncle Edouard, puisque personne
ne la connaît, et je m'exclame :
« Formidable, n'est-ce pas ! »
Radoch signe le papier de Maya, et nous suivons son exemple,
les mains tremblantes. L'encre, sur la pointe de son crayon, bave un
peu, mais cela n'empêche pas Tchaslav de répéter fiévreusement :

« Bon sang ! Pas de plume ! Un vrai stylo atomique ! »
Encouragé, moi aussi je redis :
« Formidable, n'est-ce pas !... »
Avant de nous séparer, je saisis l'occasion pour attirer Radoch à
part, afin de lui poser une question qui me brûle les lèvres depuis le
matin :
« Qu'est-ce que c’est qu'un suicide ?
- C’est quand on travaille trop, me répond-il du tac au tac.
- Comment est-ce possible ?
- L'autre fois, m'explique Radoch, j'ai entendu maman dire à ma
tante Germaine : “Tu travailles trop, ma chère, c'est du suicide.” »
Oncle Edouard, qui suit avec beaucoup d'intérêt les résultats de
mes tournois, nous a appris que les Chinois avaient, semble-t-il, inventé
les billes, comme du reste la plupart des choses indispensables à
l'humanité. C’était un beau prétexte pour amener de l'eau à son moulin
chinois et pour évoquer une fois de plus son voyage en Chine.
Après le déjeuner, me trouvant un moment seul avec lui dans la
véranda, je lui ai posé la même question qu’à Radoch.
« Qu'est-ce que c’est qu'un suicide, mon oncle ? Est-ce qu'on peut
mourir d'un suicide ?
- Parfois, me répond-il. S'il est bien fait. »
Il me contemple longuement, une étincelle un peu triste dans son
œil vert argent, avant d’appuyer son index sur le bout de mon nez.
« Ce genre de question, cher Louveteau, se pose plutôt à la fin
d'une vie, me dit-il. Et toi, tu n'es qu'à l’aube de la tienne. »
Puis, son index toujours sur mon nez, il cite un sage chinois qu'il
appelle Confucius, Maître Kong :
« “Toi, qui ne comprends pas la vie, comment comprendrais-tu la
mort.” »
Le vague à l'âme, je sors dans le jardin voir mes défis, dont
l'épanouissement est achevé et qui, au déclin du jour, commencent à
dépérir, devenus flasques, chétifs et pâles, telles de petites flammes qui
s'éteignent.
Leur mort ne me cause guère de chagrin. Je sais que la vie
triomphe toujours et que leurs sosies naîtront dès le lendemain. Vivre
pour mourir, comme des éphémères. Et mourir pour renaître. Est-ce le

secret de la vie ? Bien que je ne sois qu'à l’aube de la mienne, je me
lance un dur défi, celui de le comprendre.
Pour pouvoir ensuite...
Le dimanche suivant
Notre triomphe de la semaine dernière a été suivi aujourd'hui d’un
échec cuisant. Nos adversaires finalistes sont arrivés devant l'épicerie
de M. Samar armés jusqu'aux dents d’une boîte pleine de billes en acier
inoxydable, extraites de la roue d'une motocyclette allemande. Vaniteux
comme des paons, ils ont cassé en mille morceaux les boules en terre
cuite de Tchaslav et même les billes « atomiques » de Radoch.
Heureusement, Maya était absente, en visite chez sa grand-mère à la
campagne ; elle n’a pas assisté à notre déroute.
« Bon sang ! a fait Tchaslav. C'est la fin des haricots ! »
J’ai eu le malheur, cette fois, de vouloir puiser de nouveau dans le
vocabulaire de mon oncle Edouard.
« C'est formidable, n'est-ce pas ! ai-je dit.
-
Mon
œil, dit Tchaslav, hérissé. Notre fiasco, toi, tu le trouves
formidable, bon sang ! »
Rouge de honte pour avoir parlé comme un perroquet, j'ai rentré
ma tête dans mes épaules et décidé de ne plus me parer des plumes
d'autrui.
« Les échecs précoces sont une chance dans la vie », a dit
Radoch pour rassurer tout le monde.
Il s’agit sans doute d’une sagesse sortie de son fameux mur ouest,
des mots que je retourne dans mon cerveau tandis que j’entre dans la
cour de notre maison. Il est à peine dix heures ; notre malheureuse
finale n'a duré qu'une demi-heure. Un tumulte me parvient de l'arrière-
cour, surtout la voix de papa, que je n'avais jamais entendu crier.
« Vous allez essayer, Loudmila ! clame-t-il.
- Jamais de la vie ! répond-elle dans un sanglot.
- Dans ce cas, je le ferai moi-même ! peste papa.
- Arnolphe ! s'écrie Maminka. Tu vas te blesser !... »
Au bout de la petite allée qui mène au jardin, je m'immobilise à la
vue d'une scène qui ressemble à un rêve, drôle et terrifiant à la fois :
brandissant un coutelas dans sa main gauche - il est gaucher -, papa
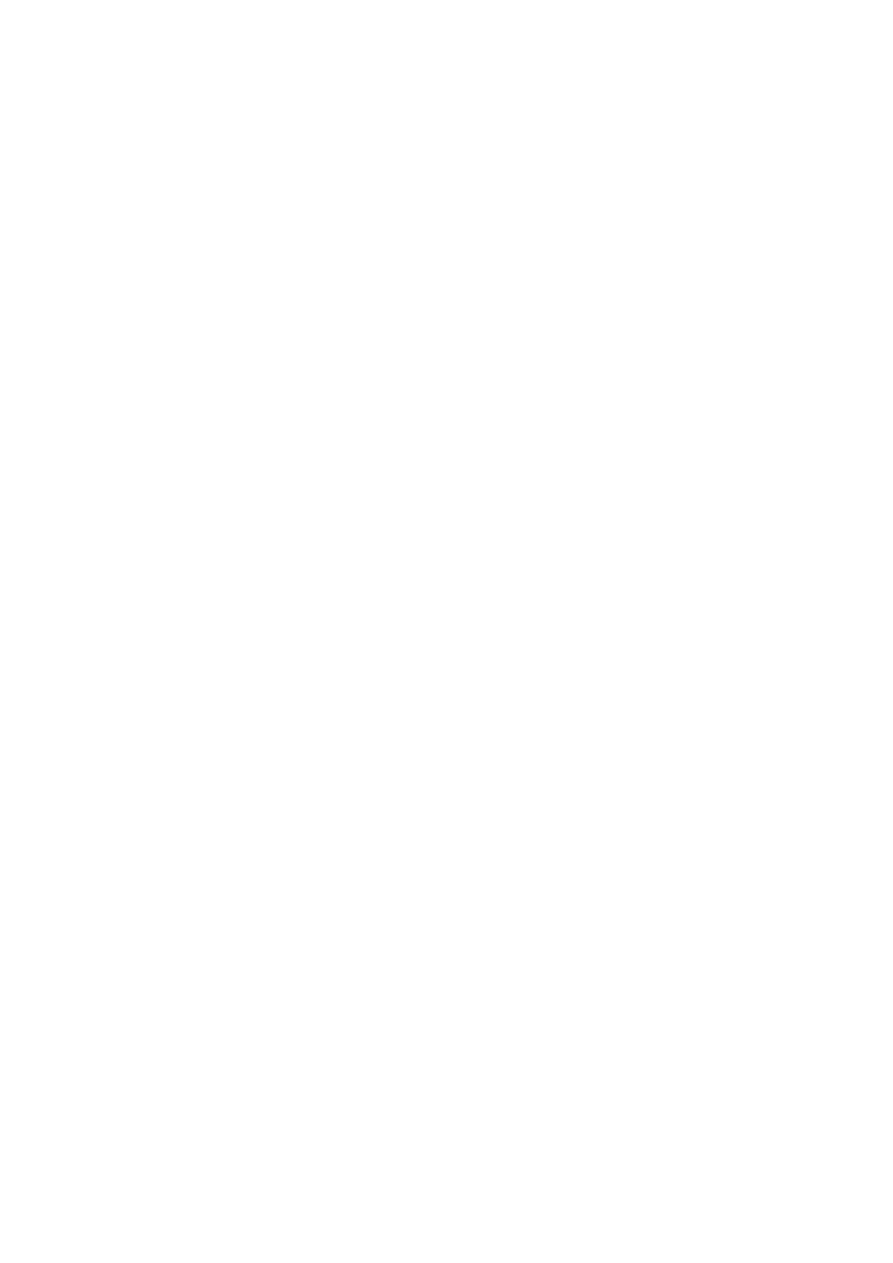
empoigne de sa main droite les ailes d'un poulet qui s'agite et frétille
désespérément, en répandant tout autour de lui ses plumes blanches.
Papa presse sa tête contre la souche d'un arbre, lève le coutelas
et lui assène un coup maladroit, si maladroit que la pauvre volaille
décapitée lui échappe des mains et se met à courir à toutes jambes çà
et là, arrosant tout sur son passage de sang cramoisi.
Épouvantées, Maminka et notre Loudmila poussent des cris aigus.
Papa court après le poulet sans tête, surgi d'un rêve terrible, ce poulet
blanc comme la neige qui se dirige droit vers moi et asperge mon
visage de son sang...
Après être revenu de mon évanouissement sur un sofa de la salle
de séjour, j'échange un sourire avec Maminka et je referme les yeux
pour qu'elle puisse les effleurer de ses lèvres tremblantes, pendant que
je hume son parfum aux dix odeurs de fruits et de fleurs. Mes paupières
laissent passer juste ce qu’il faut de lumière pour que je me sente
vivant et à l'abri de tous les dangers.
Les yeux fermés, je vois ce qu'on ne peut percevoir par la vue, je
vois les voix, celle de tante Milena et d'oncle Edouard qui pénètrent
dans la salle à manger comme une vraie brebis et un vrai aigle. Les
yeux fermés, on voit la vérité du monde, on se déplace où l’on veut sans
bouger, on traverse les murs et on talonne même sans crainte oncle
Edouard, qui descend dans la cave pour faire mordre la poussière à
notre rat géant, lequel, une fois de plus, a fait de gros dégâts, rongeant
un sac de haricots blancs. Puis, triomphant, bravant l’obscurité maudite,
on remonte l'escalier derrière son oncle courageux, qui ramène à la
lumière du jour le méchant rat mort, empalé sur les dents d'une fourche.
Finalement, on ouvre les yeux, et que voit-on ? Un monde sans
grâce où l'homme impitoyable est roi, assassin et grand mangeur
d’animaux. Quoique nous leur ressemblions beaucoup, bien que nous
vivions sous le même toit, nous les tuons, les mangeons, les torturons -
des chèvres, des crapauds, des rats, des poulets !... Nous sommes tous
des assassins, moi, papa, oncle Edouard et même Maminka ainsi que
notre Loudmila, qui vont plumer et frire un cadavre. Le cœur soulevé, je
décide de ne plus manger de viande. C'en est fini du bouillon de poulet
avec son cœur, son foie et son gésier, jamais plus de poulet pané !...
En observant oncle Edouard sortir le pauvre rat dans la cour pour
jeter sa dépouille dans un trou que papa vient de creuser, j'ai le cœur

gros, j'ai mal au cœur, je me plie en deux au bord du sofa et je vomis sur
l'unique tapis de Maminka - le seul qui n'ait pas été volé pendant la
guerre - tout ce qui se trouve dans mon estomac, une demi-brioche
tartinée de miel et une douzaine de cerises vertes que Tchaslav et moi
avons volées chez les voisins.
Tandis que notre Loudmila nettoie le tapis, feignant de n'avoir pas
vu les cerises vertes, les adultes se mettent à parler à mi-voix et en
français. Ils s'expriment en français chaque fois qu'ils parlent de moi. Je
dresse l’oreille et je parviens à saisir quelques mots que j'ai déjà appris,
« pauvre enfant » et « voir médecin », puis d'autres mots que je ne connais
pas, que je dois garder en mémoire pour les apprendre une fois resté
seul.
« Émotif » et « hypersensible ».
Après avoir mangé leur bouillon de poulet blanc et leur cadavre de
poulet blanc pané, ils sont partis tous rendre visite à une amie, me
laissant aux soins de notre Loudmila. Je n'ai rien mangé pendant le
déjeuner, je ne mangerai plus d'animaux, nos frères et sœurs sur cette
Terre. Comme si elle avait deviné mes pensées, notre Loudmila m'a
fermement demandé de ne plus avaler de fruits verts.
« Croix de bois, croix de fer, ai-je dit.
- Il ne faut jurer de rien », a répliqué notre Loudmila, avant d'aller
faire une sieste dans sa petite chambre, au fin fond de la maison, qui
sent les coings et l'herbe fraîchement fauchée, même en plein hiver, le
parfum des hauts pâturages de son pays.
Enfin seul, je me retire dans ma chambre aux meubles bleu ciel
façonnés par la main de tonton Pinter, qui repose dans une contrée d'un
brun de marrons lustrés. J'aime bien ma chambre, mais pour lire et
travailler le français je préfère la pièce voisine, que l'on appelle la
dernière chambre. Je ne resterai dans la mienne que quelques instants,
le temps d'être sûr que notre Loudmila s'est bien endormie.
La dernière chambre, toujours fermée à clef, dispose de deux
portes, l’une qui la sépare de ma propre chambre et l’autre qui donne
sur la salle à manger. Pour ouvrir ma porte, il suffit simplement de se
servir de la clef du grenier. Ce fut une découverte tout à fait fortuite, je
n'ai jamais désobéi à papa ni à Maminka, mais personne ne m'a interdit
d'entrer dans la dernière chambre ou de monter dans le grenier.
Depuis que Mme Karpov m'a appris l'alphabet français, je
m’enferme dans ces deux lieux pour étudier cette langue, puisque je me

suis lancé le défi d'apprendre par cœur dix mots de français par jour.
Hier, j'ai fait mes comptes. En deux semaines, j'en ai appris cent
cinquante, dans un an j'en connaîtrai trois mille six cents, et dans dix
ans environ trente-six mille. Lorsque j’ai déclamé les deux premiers
chapitres du Petit Prince à la fin de notre dernière leçon, mes progrès
ont stupéfié la grand-mère de Tchaslav.
« Bon sang, Miodrag ! » m’a-t-elle dit en cessant de ruminer ses
deux joliettes.
J'ai ainsi enfin compris d'où sortait l'expression favorite de
Tchaslav. Il se pare lui aussi de plumes de paon.
« Bon courage, petit, m'a dit Mme Karpov.. Tu vaudras autant
d’hommes que tu parleras de langues.” »
En égrenant, tous les jours, mes dix nouveaux mots de français, je
me répète sans relâche ce beau proverbe. Lorsque j'aurai appris mes
trente-six mille mots français, je me mettrai à étudier une autre langue,
j'en apprendrai trois ou quatre, et je vaudrai trois ou quatre hommes.
Chaque langue étrangère délivre en toi un esprit endormi, chaque
nouveau mot libère en toi une parcelle de ton être emprisonné dont tu
ne soupçonnais même pas l'existence.
Une langue étrangère me rappelle la forêt vierge que j'ai vue au
cinéma. Elle est pleine de mots inconnus, de mots-fleurs, de mots-
plantes carnivores, de mots-papillons, serpents ou mantes religieuses,
de mots-sables mouvants, de mots qui caressent, chatouillent, câlinent
ou bercent, mais aussi de mots qui fouettent, frappent et transpercent,
de mots qui donnent la vie ou la mort. En traversant cette forêt pas à
pas, je me jure de devenir écrivain ou, mieux encore, traducteur, une
sorte de facteur, un homme qui n'écrit pas les lettres, mais qui les remet
à leur destinataire. J'aimerais vivre toute ma vie parmi les mots et ne
jamais sortir de ma forêt vierge.
Mme Karpov dit qu’apprendre à écrire est beaucoup plus difficile
qu’apprendre à lire. Tant pis, pour le moment, je me contente de la
lecture. Comme dit mon oncle Edouard : « Petit à petit, l'oiseau fait son
nid. »
Muni de deux livres que j'ai dénichés dans le grenier et du Petit
Larousse illustré de papa, je me trouve assez bien équipé pour cette
aventure. Si une nouvelle guerre éclatait, si l’on nous bombardait
encore, si nous devions de nouveau fuir au village de Duc et si papa me
demandait d’emporter mon objet préféré, je prendrais mon journal, mon
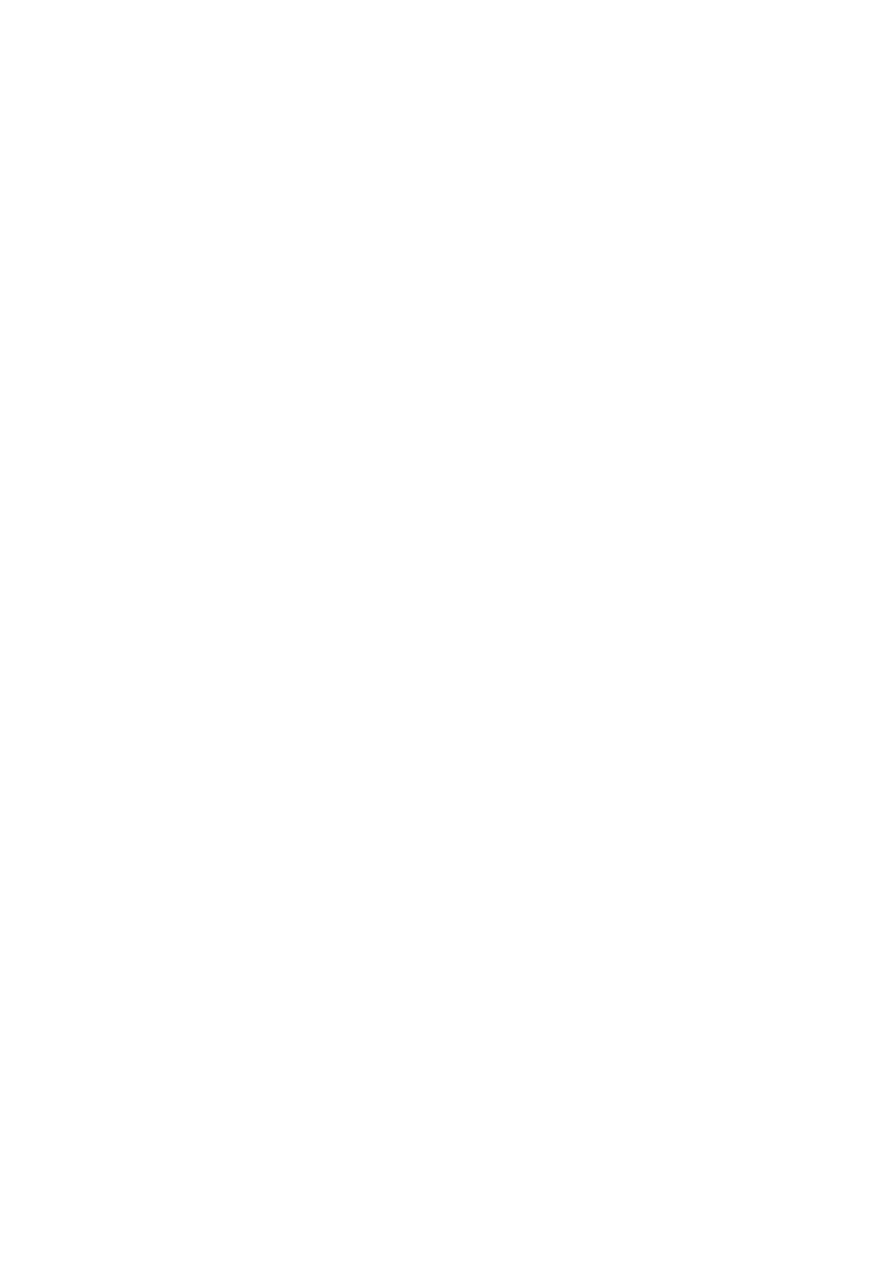
stylo parisien et mes trois livres français, Le Petit Larousse, le
Dictionnaire et la Grammaire. Cette dernière m'ennuie un peu, bien que
Mme Karpov dise que la grammaire est le système sanguin d'une
langue. Cela me paraît juste, car j'ai déjà remarqué que souvent les
mots coulaient, bavaient et ruisselaient, à l'égal du sang.
Grâce à mes livres, j'ai déjà découvert le sens des deux mots
bizarres , émotif et hypersensible , qui veulent dire prompt à s'émouvoir
et très facile à émouvoir, comme un cœur sensible. Bien entendu, il
s'agit de mon cœur, puisque c’est de moi qu’on parlait, de mon cœur qui
se serre au moindre souci. Le mot suicide est tout aussi lugubre, «
action de se donner la mort », un mot qui exhale une odeur de poudre,
l'odeur de notre serpent mis à feu.
Le Dictionnaire et la Grammaire française appartenaient à
Maminka du temps qu’elle était encore écolière. Ils portent toujours
l'inscription Jelena J., son vrai prénom et l'initiale de son nom de jeune
fille. Jelena veut dire biche. Maminka, petite maman, n'est que le
surnom que papa lui a trouvé à Prague, lors de leur lune de miel. Chose
étrange, son écriture d'enfant, tremblante, penchée et mal assurée,
ressemble aux traits de son visage d'aujourd'hui et à ses paupières mi-
closes, qui frissonnent comme deux papillons apeurés. Ces jours
derniers, Maminka a souvent l'air de quelqu'un qui a peur, comme si une
menace invisible la guettait.
Son envie d'être emportée par une tuberculose galopante n'est-
elle pas le désir de l'« action de se donner la mort », de nous
abandonner, papa et moi. Je crains qu'elle ne nous aime plus et qu'elle
nous quitte un jour.
La dernière chambre dissipe souvent mon inquiétude. Plongée
dans la pénombre, derrière ses persiennes toujours fermées, elle n'est
éclairée que par deux ou trois rais de lumière qui s'y faufilent. En fin
d’après-midi, d'avril à septembre, les rayons du soleil couchant tombent
précisément sur les Coureurs, le tableau que je préfère dans la
collection de papa.
Quelle merveille que ces athlètes, alignés sur leur cale de départ
juste avant une course de vitesse. Leurs épaules arborent, au lieu de
têtes, des pleines lunes multicolores, jaunes, orange et rouges. Le
starter, avec son pistolet brandi, est invisible, mais j'entends bien sa voix
tonner : « À vos marques. Prêts ! Partez ! » Alors retentit son coup de

pistolet et les coureurs s’élancent comme des boulets de canon, mais ils
ne partent pas pour de bon. Leur peintre les a immobilisés à jamais et
rendus immortels dans cette course sans fin.
C'est exactement comme ça que j'imagine ma vie future, une
course de vitesse qui finit en marathon !
Papa a commencé sa « modeste collection » - selon son
expression - en France, au sortir de ses études, après la Première
Guerre mondiale, au moment où tous ces peintres, futures célébrités,
étaient encore méconnus et vendaient leurs tableaux pour une bouchée
de pain. Cela ne m'étonne pas. À l'exception de mes beaux coureurs à
la tête en forme de lune, la plupart des personnes peintes ou dessinées
dans la collection de papa sont drôles et laides, les membres déformés
et le visage défiguré. Cela n'empêche - au dire d'oncle Edouard - que
ces tableaux coûtent à présent les yeux de la tête.
Durant la guerre et notre séjour à la campagne, toutes ces toiles
ont dormi dans notre cave, à l’abri d’une alcôve dissimulée derrière un
faux mur, et papa les a retrouvées indemnes, bien que notre maison ait
été réquisitionnée et occupée pendant toute notre absence par un major
allemand. Celui-ci, fort courtois, n'a pas touché aux tapis de Maminka,
nous a laissé un mot de remerciement et fait cadeau d’une demi-tonne
de charbon moulé. Grâce à ce charbon, nous avons pu affronter le froid
de canard du premier hiver après la libération.
Oncle Edouard, qui s'était rendu chez nous le jour même du
départ du major Schultz, avait pu dire bonjour et au revoir à cet officier
poli, fermer la villa à clef et constater que tous les tapis de Maminka
étaient bien à leur place et en parfait état. Leur disparition n’a donc pu
se produire qu'après le départ de M. Schultz et avant notre retour de la
campagne, un vol commis sans nul doute par quelqu'un de notre
voisinage.
Seul héritage de ses parents, ces tapis persans volatilisés ont
provoqué la colère et le chagrin de Maminka, qui depuis lors ne cesse
de les pleurer. J'ai entendu sa jeune amie, Mlle Lecco, parler de ce
méfait et accuser une famille de miséreux demeurant dans une baraque
délabrée au bout de la rue voisine. Maminka a protesté et déclaré que
ces pauvres hères besogneux étaient au-dessus de tout soupçon, étant
donné que leur fille aînée faisait partie du comité des Femmes
antifascistes.
« Cela ne sent pas bon, ma chère », a répondu Mlle Lecco.

Fin avril
Hier, jour férié, Radoch, Zorko et moi avons prêté main-forte à
Tchaslav depuis le matin jusqu’à midi pour descendre les outils de son
père de son atelier à la cave. Craignant que l’on confisque les biens de
son papa, Tchaslav a décidé de vider les lieux. Après que nous avons
descendu toutes les perceuses, fraiseuses, raboteuses et autres
machines-outils dont j'ignore le nom et l’usage, Tchaslav nous a offert
un casse-croûte, d'épaisses crêpes russes, en nous suggérant de les
tartiner avec de la graisse de porc.
J'ai fermement refusé.
« Je ne mange pas la graisse des cadavres », ai-je dit.
Mes amis ont écarquillé les yeux.
« Bon sang ! a fait Tchaslav. C'est du porc.
- Les porcs sont nos frères, ai-je dit.
- Peut-être les tiens, mais pas les nôtres », a dit Radoch en
fronçant les sourcils.
J'ai aussitôt regretté mes paroles irréfléchies. Heureusement,
Tchaslav a coupé court à cette bisbille.
« Nous avons d'autres chats à fouetter, a-t-il dit. Nous n’avons
accompli que la moitié de notre besogne. »
Stupéfaits, nous le regardons pousser une énorme armoire pleine
de quincaillerie, avant de nous rendre compte qu'elle glisse sur des
roulettes. Une fois déplacée, l'armoire nous dévoile son secret : une
ouverture, un grand trou noir d’où se répandent des odeurs fort
désagréables. Tchaslav se sert d'une torche électrique de forte
puissance pour éclairer l'intérieur de cette grotte pourvue de deux lits et
de plusieurs étagères vides.
« À la veille de la guerre, papa a participé aux travaux
d'aménagement de l'abri antiaérien, nous explique-t-il. En examinant les
plans de construction, il a découvert qu'un bras de ce refuge finissait à
deux pas de notre cave. Pour lui, armé de ses outils, le reste n’a plus
été qu’un jeu d'enfant. Un détail de première importance : cette galerie
est bouchée à une cinquantaine de mètres d'ici par un effondrement de
terre. »

La voix grave et solennelle, Tchaslav nous demande de prêter
serment, de garder ce secret, de ne révéler à personne cette cache où
nous allons établir notre quartier général.
Nous jurons, chacun à sa manière.
Radoch cite un serment de son mur ouest :
« “On prend les bêtes par les cornes et les hommes par la parole.”
Prenez-moi par ma parole. »
Zorko fait un signe de croix orthodoxe.
Moi, le plus jeune, je jure fidélité le dernier :
« Croix de bois croix de fer, si je trahis je vais en enfer. »
Zorko se racle la gorge et pose une question qui me brûle
également les lèvres :
« Notre quartier général... de quoi s'occupera-t-il ? »
Tchaslav se racle la gorge lui aussi et répond d'une voix mal
assurée :
« Bon sang, il faut y réfléchir... Si, par exemple, les Allemands ou
les Anglais nous bombardaient de nouveau, nous pourrions nous
retrancher ici.
- C'est formidable, n'est-ce pas ! » dis-je.
Encouragé, Tchaslav renchérit :
« Avec tous les outils de papa, nous pourrions y construire un
canon antiaérien.
- Et pourquoi pas un engin volant ou un sous-marin, pour fuir à
l'étranger ? » s'enflamme Radoch, qui n'a qu'un seul rêve : rejoindre son
grand frère au Canada.
Suivant les instructions de Tchaslav, nous nous empressons de
vider la cave et de ranger sur les étagères de notre quartier général tous
les outils de son père, que notre ami désigne sans jamais faillir par leur
nom, parfois très drôle comme lime queue-de-rat, mortaiseuse, lime à
métaux et autres meules. Ce travail terminé, nous remettons l'armoire
en place comme si rien ne s’était passé.
Zorko est le plus pressé de tous : pour rien au monde il ne voudrait
rater sa troisième baignade autour des radeaux, sur les bords de la
Save. Au printemps, les garçons de notre Colline se mesurent entre
eux au nombre de baignades. Excellent nageur, l’année dernière Zorko
a battu tous ses adversaires avec un score de vingt-quatre baignades à
la fin mai.

Je ne me baigne pas. Outre que je suce parfois mon pouce le
soir, j'ai un autre grand secret que je ne m'enhardis à confier qu’à mon
journal. Je n'ai jamais nagé, je ne sais pas nager. Je cache cette chose
honteuse à mes camarades. Maminka et papa m'ont promis que nous
irions ensemble à la mer cet été. J'y apprendrai à nager, je reviendrai
sur notre Colline excellent nageur et l'année prochaine je participerai au
tournoi des baignades.
Comme d'habitude, nous marchons en file indienne, Radoch,
Zorko, Tchaslav et moi, en queue. Nous dirigeant vers les Six Peupliers
nous passons devant l'épicerie de M. Samar, et à la seule pensée de
Maya mes genoux se mettent à jouer des castagnettes. Elle est là, en
train d’épousseter la vitrine autour du Noir qui hoche la tête. Nous nous
arrêtons un moment afin de saluer Maya en branlant notre tête d'avant
en arrière. Elle nous sourit avec ses yeux de biche blonde, elle agite en
l'air sa balayette et je sens une fois de plus des picotements dans ma
poitrine.
Les yeux dans le vague, nous repartons tous les quatre et de
nouveau nous nous arrêtons devant l'ancienne propriété du roi Pierre
Ier, roi de Serbie, le bon roi Pierre, comme l'appelle oncle Edouard. Vue
à travers les grilles de la haute clôture, sa belle demeure de deux
étages, entourée d'une pelouse, me paraît bien modeste pour un
souverain qui, au dire de mon oncle, a réuni les Slaves du Sud, sortant
vainqueur des deux guerres balkaniques.
Notre chemin nous oblige à contourner la propriété pour
descendre vers la Save par des ruelles envahies de grappes de lilas.
Une fois arrivés à hauteur de la porte principale de l'ancienne maison
royale, une image inattendue nous cloue sur place. Se balançant au
sommet d'une grande échelle, un marteau à la main, notre Noir, le seul
Noir vivant de notre ville, est en train de cogner sur la couronne du bon
roi. Ce n'est pas une vraie couronne que l'on pourrait porter sur sa tête
qui orne le haut de la porte, c'est plutôt le bonnet de fer d'un prince
paysan.
Mon
cœur se serre. Les visages de mes camarades pâlissent, tout
comme le mien. Guidés par nos anciennes « s'il-vous-plaît-madame »,
nous avons tous visité la maison du roi Pierre Ier et vu sa chambre à
coucher, une petite pièce aux murs nus, comme celle d'un moine, avec
son lit de camp en fer.

Notre Noir, ruisselant de sueur, cesse un moment de frapper pour
reprendre son souffle. Il nous aperçoit au pied de l'échelle, remarque
notre stupeur et grimace dans un rire forcé.
« On me l'a... ordonné », bégaye-t-il en roulant des yeux.
Puis il nous tourne le dos et continue à marteler.
Nous savons qu'il dit la vérité. Après la guerre, devenu l’homme-à-
toutfaire de la Colline, notre Noir travailleur effectue toutes les tâches
que les gens lui demandent, il fend du bois pour les uns, transporte du
charbon pour les autres. Il a même fait deux enfants à deux veuves
esseulées, deux bambins café au lait. C'est pourquoi nous ne sommes
nullement étonnés de le voir casser la couronne paysanne de notre bon
roi, qui doit se retourner dans sa tombe.
Ce symbole de la dignité et du courage d'antan du peuple de
Maminka cède finalement sous les coups du marteau sauvage. Son
cercle massif, censé tourner, se brise et répand à terre deux douzaines
de boulettes d'acier, deux douzaines de billes scintillantes qui nous
émerveillent. Nous poussons des cris de joie et les ramassons à quatre
pattes. Elles sont plus grandes encore que les billes de nos heureux
adversaires, elles nous assureront la victoire lors d'un nouveau tournoi.
La troisième baignade de Zorko est oubliée.
Seul Radoch fronce les sourcils, murmurant un mot qui provient à
coup sûr de son sage mur ouest :
« Le roi est mort, vive le roi !... »
Dernier jour d'avril
Ces temps derniers, Maminka et papa sont souvent absents.
Maminka se rend presque quotidiennement au Front des femmes
antifascistes, afin de s'occuper de la collecte de vivres et de vêtements
pour nos jeunes combattants du front nord, qu'oncle Edouard appelle «
cette lamentable chair à canon ». Papa s'absente aussi de la maison,
deux fois par semaine, contraint de soigner des blessés en province. De
surcroît, il passe un jour et, souvent, une nuit par semaine dans la
demeure d'un haut dirigeant politique qui a décidé - comme avait dit
oncle Edouard - de se refaire la façade et un beau sourire. Ce politicien,
joueur de cartes passionné - selon notre Loudmila, s’adressant à une

voisine -, oblige papa contre son gré à jouer au poker avec lui et ses
amis quelquefois des nuits entières.
« Vieux, tu es né avec une cuillère en argent dans la bouche, m'a
dit Tchaslav hier. J'ai entendu dire que ton père était le meilleur
chirurgien- dentiste de la ville. »
Je n'ai rien répondu. À quoi bon être le fils du meilleur dentiste de
la ville, de l'homme qui a les plus belles mains du monde, si ce père
tendre et trop occupé n'a jamais le temps de prendre son fils dans ses
bras.
Je tousse beaucoup et depuis trois jours je ne vais pas à l'école.
C'est très agréable, puisque je peux lire et écrire dans mon journal à ma
guise. Le côté négatif de ma toux : on me force à boire du lait au sucre
caramélisé, ce qui est fort désagréable. Dès que notre Loudmila me
tourne le dos, je vide ma tasse dans le lavabo.
Mais elle est très gentille avec moi. Elle m'invite tous les après-
midi dans sa petite chambre, après la sieste, pour me lire à haute voix
les contes de fées de son pays natal. Je hume les parfums de chez elle,
ceux des coings et de l’herbe des Alpes fraîchement fauchée, ainsi que
son odeur à elle, celle du lait cru de chèvre.
Notre Loudmila lit en slovène, une langue dont je ne comprends
pas un mot, mais j'apprécie beaucoup sa lecture. Les yeux fermés,
j'écoute les fines vibrations de sa voix et des images surgissent devant
moi, de belles images d’animaux à cinq pattes et de nains de la forêt.
Hier, pour rendre la pareille à notre Loudmila, je lui ai récité en français
les deux premiers chapitres du Petit Prince. Quoiqu'elle ne connaisse
pas un seul mot de français, elle a trouvé le récit très beau et touchant.
Petit à petit, l'oiseau fait son nid ! En apprenant tous les jours dix
mots français par cœur, je fais d’énormes bonds en avant et libère ainsi
des parcelles emprisonnées de mon esprit.
Parfois, je m'amuse à comparer certaines expressions de ma langue
maternelle avec celles de la langue de papa. Les Serbes disent : bête
comme la nuit. Pourtant les Français disent que la nuit porte conseil. Je
me demande comment c'est possible : pour un peuple, la nuit est bête ;
pour un autre, elle est douée de raison ! Le peuple de Maminka dit : la
nuit tous les chats sont noirs. Les Français disent : la nuit tous les chats
sont gris. Je me demande comment c’est possible ? La nuit est noire
dans la plupart des cas, sauf chez nous, sur la colline de Toptchider, où

elle prend au printemps une couleur lilas, mauve rosé, mauve foncé ou,
parfois, noir bleuté, comme les ailes du corbeau.
Le mauve foncé est la couleur du turban de Maminka, dont elle est
ces temps-ci toujours coiffée. Je l'ai entendue se plaindre à Mlle Lecco
de perdre ses cheveux. J'espère qu'elle ne deviendra pas chauve
comme papa ou comme la grand-mère de Tchaslav. Elle ne prend plus
soin d'elle comme avant, elle ne touche même plus à son flacon de
parfum parisien, dont l'odeur est si séduisante.
Quoi qu'il en soit, mon apprentissage du français avance et me
sert parfois à comprendre certaines paroles que les grandes personnes
échangent entre elles dans cette langue. Je ne suis pas à les écouter, à
les épier, je voudrais tout simplement comprendre le monde qui
m'entoure, ce monde sur lequel est soudain tombée une ombre pesante.
Pour la chasser et faire revivre les jours sereins de naguère, je me suis
permis d'ouvrir le flacon de Maminka, oublié dans la salle de bains, et
d'en faire sortir une gouttelette un peu grasse dont j’ai enduit mes
paupières. Gardant les yeux longuement fermés, j'ai eu l'impression
qu'elle se penchait sur moi pour m'embrasser.
Le 1er mai, qu'il soit maudit
Tout a commencé vers cinq heures du matin. Il faisait encore nuit
quand je me suis réveillé brusquement comme après un cauchemar,
bien que je n'aie rêvé de rien. Il m'a semblé entendre dans mon sommeil
la voix de papa répétant au téléphone dans un cri étouffé : « Vite, je
vous en supplie ! Vite, vite, vite !... »
Je suis dans un état étrange comme si je planais au-dessus de
mon corps pendant quelques instants. En redescendant dans ma cage
molle, je sens sur mon cou une chose froide et humide pareille au pied
d'un escargot. Effrayé, écœuré, je la touche et je pousse un soupir de
soulagement : ce n'est que ma glande ouverte, héritée de Maminka, qui
sécrète une fois de plus sa goutte gluante insipide et inodore. Je suis un
peu étonné, car d'ordinaire cela se passe les nuits de pleine lune, et
nous n'y sommes pas encore, nous n’en sommes qu’au premier
quartier.
Ma fenêtre est ouverte, les persiennes fermées. À travers leurs
lames, la brise du petit matin m'apporte l'odeur des lilas. Elle n'a jamais

été si lourde, si capiteuse. S’il n’y avait pas ce coq en train de chanter,
le silence serait absolu dans les cours du voisinage. Je tends l'oreille
pour saisir un autre son dans le lointain, la sirène d'une ambulance qui
s'approche de notre rue. Elle devient de plus en plus aiguë, s'arrête et
se tait juste devant chez nous.
Un moment de silence, puis le grincement de notre porte cochère,
qui n'est plus fermée à clef depuis la guerre. Le bruit des pieds d'au
moins deux personnes dans la petite allée qui mène à l'arrière-cour.
Elles passent sous ma fenêtre. Piétinements. Voix étouffées. Un objet
heurte la vigne vierge. Les bruits se déplacent vers le jardin et se
dirigent vers la porte de service. Est-ce notre Loudmila ? Impossible,
elle est partie hier soir chez tante Milena pour l’aider... Pourtant,
j'entends ses pas et ses sanglots... Silence. Puis les pas de plusieurs
personnes, des chuchotements et le bruit d'un objet qui heurte de
nouveau la vigne vierge. La sirène retentit et s'éloigne. Elle stridule
tristement, comme une cigale. Elle stridule, stridule et finit par
m'endormir.
Je me réveille une ou deux heures plus tard, cette fois pour de
bon. Je me demande si j’ai rêvé ces visiteurs, fantômes nocturnes, et
leur passage sous ma fenêtre, si je me suis laissé emporter par mon
imagination ? J'entrouvre une des persiennes et remarque au bord de la
petite allée quelques feuilles de vigne vierge tout récemment arrachées.
J'ai des frissons dans le dos : ce n'était pas un rêve !
À l'aide de la clef du grenier, j'ouvre la porte de la dernière
chambre pour aller chercher mon journal que j'ai caché la veille dans le
tiroir du bas d'une commode. Au moment où je m'apprête à ressortir,
une voix me donne de nouveau des frissons dans le dos, c’est celle de
notre Loudmila, entrecoupée de sanglots. Je m'approche des
persiennes de la fenêtre grande ouverte et je l'aperçois, entre les lames,
devant la clôture qui sépare notre jardin de celui des voisins. Elle est en
train de parler à la grande sœur de Marina, qui n'est pas sourde-muette.
« J'ai passé la nuit chez madame Janvier, la tante, dit-elle,
suffoquant sous les pleurs. Heureusement, Monsieur s'est réveillé...
Madame s'était enfermée dans ma chambre... Une bassine pleine de
sang... Elle s'était ouvert les veines... À l'hôpital, ils ont recousu ses
poignets à la dernière minute... Ils ont dit : “Pas de transfusion pour des

femmes hystériques, à l'heure où il faut soigner nos combattants” ! Ils
l'ont transportée chez sa sœur... »
Le 5 juillet
Deux mois. Deux mois révolus. C’est à ne pas y croire, comme si,
pendant ces deux mois, je n'avais fait que sommeiller. Papa et notre
Loudmila me disent que je suis malade et que je ne dois pas bouger de
mon lit tant que persiste ma petite fièvre quotidienne. Je n'ai mal nulle
part. Rien de grave, 37° le matin et 37,5° en fin d'après-midi.
Néanmoins, des choses infiniment plus graves se passent dans
ma tête. Elle se vide de plus en plus. Mes souvenirs fondent comme
neige au soleil. Ils vont finir par être réduits à néant et je deviendrai un
homme sans mémoire, sans pavillon, une véritable épave humaine.
J’ai décidé de me battre en écrivant. Oncle Edouard dit que la
parole orale s'adresse au présent ; quant à la parole écrite, elle se
consacre au futur. Tout ce que j'écris est destiné à mon avenir. Tout à
l'heure, j'ai pris mon courage à deux mains et je me suis introduit dans la
dernière chambre afin de sortir mon cher journal de sa cache. J'ai
parcouru les dernières lignes, écrites il y a plus de deux mois, et
soudain des images de ce passé récent ont surgi devant moi.
Inimaginable ! La parole écrite a vraiment le pouvoir d'une
baguette magique !
Je me suis levé tard ce matin. Je suis seul dans la maison.
Vraisemblablement retenu par son notable patient, joueur de poker,
papa n'est pas rentré cette nuit. Notre Loudmila est partie chez tante
Milena rendre visite à Maminka, qui est toujours souffrante. Notre
Loudmila a refusé de m'emmener avec elle, m'expliquant que Maminka
avait besoin d'un calme absolu. Chose étrange, avant de partir, un pli de
douleur à la commissure des lèvres, elle s'est habillée en noir et a glissé
une cravate noire de papa dans son sac.
J'avale en hâte un beignet aux abricots, je sors dans la rue et me
dirige vers la maison de Tchaslav. Près de notre porte cochère, à
l'endroit où les mauvaises herbes ont envahi le trottoir, j'aperçois notre
laitière, qui nous fournit du lait et du fromage, une paysanne qui s'arrête
là tous les jours avec sa palanche et ses seaux de lait pour faire pipi.

Tchaslav est moi l'avons déjà vue plusieurs fois écarter les jambes et
uriner debout, les yeux dans les nuages, tout comme notre chèvre
Diana.
Je souris et je poursuis mon chemin. J'aperçois la belle blouse
blanche de Marina en bas de la rue. Elle vient à ma rencontre. Je
change de trottoir, je n'ai aucune envie de lui parler après ses sombres
prédictions qui ont suivi l'assassinat des crapauds. Elle fait de même,
elle change de trottoir et se dirige droit sur moi. Ses cheveux roux en
broussaille et ses petits yeux humides, elle ressemble plus que jamais à
un écureuil.
Elle s'arrête devant moi, me barrant le passage. Elle remue les
lèvres exagérément, prête à souffler dans son entonnoir invisible, et je
frémis avant même d'entendre sa voix, sachant qu'elle va encore me
dire des horreurs.
Et elle le fait.
« Pourquoi ta maaaman s'est-elle tuuuée ? » dit-elle.
Les jambes flageolantes, l'estomac en chute libre, muet et pâle de
terreur, je sens mon sang se figer.
« Pourquoi taaa mère s'est-elle tuuuée ? » répète-t-elle.
Je me détache du monde. Je pousse un horrible cri inaudible, un
cri que nul ne peut entendre, bien qu’il me déchire les tympans. La
bouche fermée, je crie à tue-tête, éperdu, je crie comme tous les
animaux du monde dont la mère est morte, je brame comme le petit de
la biche, je jappe tel le petit de la chienne, je hennis comme le petit
d'une jument, je hurle comme le petit de la louve. Personne ne
m'entend.
Les sangs retournés, plus du tout maître de moi, je cours à toutes
jambes vers la maison. Tandis que je cherche la clef du grenier, mon
cœur bat la chamade. Je la trouve enfin et je me précipite dans la
dernière chambre pour me blottir dans un grand fauteuil, me pelotonner
comme le fœtus que j'ai vu dans le Petit Larousse illustré. Si j'étais resté
dans les entrailles de Maminka, j'aurais peut-être pu l'empêcher de
mourir, ou mourir avec elle.
L’instant d’après, j'entends un bruit de pas, le pas lent et lourd de
notre Loudmila, qui n'a jamais été si pesant. Elle s'approche du jardin et
s'arrête devant la clôture, à l'endroit même où elle cause souvent avec
la grande sœur de Marina.

Je saute de mon fauteuil et je me colle contre les persiennes. Je
les entrevois toutes les deux pleurer à chaudes larmes et j'entends la
voix de notre Loudmila entrecoupée de sanglots.
« Cette fois, Madame a réussie, gémit-elle. Elle s'est servi de son
propre turban... pour se pendre agenouillée... Elle a l'air de dormir... elle
n'a jamais été si belle... Monsieur est rentré de chez son patient, où il a
passé la nuit... Dès qu'il l'a vue... il s'est écroulé par terre, les jambes
rompues... »
La funeste prédiction de Marina résonne de nouveau dans mon
esprit : La mère de celui qui tue un crapaud mourra ! C'est ma faute, à
moi, tueur de crapauds, assassin de ma propre mère ! Je pousse un
nouveau cri muet et j'enfonce ma tête entre mes genoux pour ne pas
l'entendre. Impossible de l'étouffer. Il me déchire les oreilles, ce cri
intérieur, il me secoue les os, il ébranle mon corps tout entier, mais
personne ne peut m'entendre.
Mes yeux errent sur les murs, ils survolent les tableaux de papa,
qui dépeignent une grande misère humaine, cette cohorte de visages
défigurés par le malheur. Mon regard s’arrête sur les beaux Coureurs,
ma toile préférée, mon seul espoir. Je dévore des yeux leurs têtes en
forme de pleines lunes, jaunes, orange et rouges sur la cale de départ.
J'entends la voix du starter, tonitruante, comme celle du Seigneur : « À
vos marques ! Prêts ! Partez ! » Ils s’élancent comme des boulets de
canon, mais - je suis subitement confronté à une horrible vérité -, malgré
leur beauté, leur gaieté et leur force, cette course ne les conduit pas
vers la vie. Ces athlètes se jettent dans la mort.
Fin août
Quel jour sommes-nous ? Ces temps-ci, détaché du monde, je
commence à sombrer dans le vide des jours qui se succèdent et se
ressemblent comme de lentes gouttes d'eau. Je suis toujours un peu
souffrant. Rien de grave, une petite fièvre, 37° le matin, et 37,5° en
début de soirée. De longues semaines se sont écoulées depuis ce jour
morne où Mme Karpov est venue me tenir compagnie en l'absence de
papa et de notre Loudmila, partis ensemble quelque part tout de noir
vêtus. Je me suis douté qu'ils allaient à l'enterrement de Maminka et
qu'ils ne voulaient pas m'y emmener, mais je n’ai rien dit, je n'ai rien

osé dire. Maminka m'a abandonné, Maminka m'a ôté sa vie et,
maintenant, ils me ravissent sa mort !
Ils disent qu'elle est partie en voyage, un long voyage. Je sais
pourtant que c'est un voyage sans fin et sans retour, mais je n'ose pas
le dire. Depuis des semaines, je n'ai vu ni Tchaslav ni mes autres
camarades. J’ai refusé de les voir lorsqu'ils sont venus me rendre visite.
Je n'ose pas les voir, ni les regarder en face, de crainte qu'ils ne me
posent la même question odieuse que Marina : « Pourquoi ta mère
s'est-elle tuée ? »
Je n'ose même pas penser au fait que l'école recommence dans
moins de deux semaines. Je sais à coup sûr que toute ma classe aura
dans ses yeux compatissants et méprisants cette insupportable
interrogation : « Pourquoi ta maman... ? »
À l'image du Petit Prince, j'aimerais avoir ma propre planète, même
minuscule, pour y vivre tout seul avec une chèvre qui me nourrirait de
son lait et un chien qui me défendrait de tout le monde en vieillissant
avec moi sept ans par an.
Je n'entends plus ce cri qui me déchirait les oreilles. Au fil des
semaines, il s'est estompé et maintenant une douleur sourde m'habite,
que seuls mes livres et mon cher journal m'aident à oublier. Comme
avant, j'apprends tous les jours mes dix mots français. Chose bizarre et
presque drôle : dans la langue de Maminka et dans celle de papa, les
mots qui se rapportent à la tristesse, à la souffrance ou au malheur sont
trois fois plus nombreux que les mots qui désignent le bonheur. À en
juger d'après le nombre important de mots noirs, les hommes qui les ont
inventés ont dû être des créatures très malheureuses.
Hier, j'ai appris par cœur quelques mots liés à la douleur, ce
sentiment pénible que nous éprouvons, et je me suis reconnu dans
presque tous : souffrance, supplice, tourment, torture, déchirement,
amertume, désespoir... « Souffrance de se savoir perdu... Déchirement
de cette séparation... L'amertume de son absence... Un enfant qui
meurt, désespoir de sa mère... » Je dirais plutôt : Une mère qui meurt,
désespoir de son enfant !
En les ressassant, je sens le goût de ces paroles sombres dans
ma bouche, le goût amer, âpre, âcre de l'angoisse qui vous brûle la
gorge.

Il est trois heures du matin. Je dors beaucoup pendant la journée
et je veille la nuit, parfois durant des heures. J'allume sur ma table de
chevet une petite lampe en forme de champignon. Je lis et j'écris mon
journal. La journée, entre deux sommes, j'écoute l'essaim d'abeilles qui
bourdonnent infatigablement sous les feuilles de notre vigne vierge. Au
déclin du jour, elles s'envolent et c’est seulement à ce moment-là que
j'entends la fraise dans le cabinet de papa, un bourdonnement un peu
plus aigu que celui d'une abeille qui me plonge dans une étrange
torpeur.
Pauvre papa, il travaille comme un forçat douze heures par jour.
Au début de la soirée, quand il entrouvre la porte de ma chambre pour
me dire bonne nuit, il n'a pas le courage de me regarder dans les yeux,
comme s'il savait que je suis au courant, comme s'il avait quelque chose
sur la conscience et qu'il redoute un danger. La commissure de ses
lèvres porte la même ride d'amertume que celle de notre Loudmila. Au
lieu de se trouver au chevet de Maminka après sa première tentative de
se donner la mort, il a passé la nuit fatale dans sa clinique ou chez son
notable patient, joueur de cartes. En dépit de tout, je ne lui en tiens pas
rancune, car je sais très bien que c'est Maminka qui a décidé de nous
abandonner.
Je vois que papa souffre autant que moi. Hier, lorsque le Noir,
l’homme-à-tout-faire, a coupé l'abricotier de Maminka, le plus bel arbre
de notre jardin, qui s’est soudain desséché après sa mort, papa a eu de
la peine à retenir ses larmes. Je me demande comment cet arbre a pu
deviner sa disparition, comment notre vigne vierge s'est habillée des
couleurs rouille de l'automne en plein été. Ces créatures végétales me
paraissent pleines de mystère et de bonté.
Déjeuner du dimanche ! Je cherche à l'éviter à tout prix, car il
m'est insupportable de voir toutes ces grandes personnes maussades
autour de la table de tonton Pinter, leurs visages qui broient du noir se
refléter dans le bois marron, leurs lèvres pincées et les larmes de ma
tante tomber goutte à goutte dans son bouillon de poulet.
Pendant que leurs yeux délavés me caressent à la dérobée, ils
parlent de la pluie et du beau temps.
« Formidable, n'est pas... », murmure oncle Edouard, le regard
vague, sans plus aucune envie d'évoquer son mémorable voyage en
Chine.

Le pire, c'est quand ils se mettent à parler français devant moi, ce
qui a été le cas hier. Si je n'étais pas si malheureux de les comprendre,
je rirais. Cela me faisait penser à l'anecdote piquante que Radoch nous
a racontée sur le mariage de la fille de l'inventeur américain du Nylon.
La jeune mariée s’était présentée à la cérémonie vêtue du célèbre tissu
de son père sans savoir qu'à la lumière des flashes le Nylon devenait
transparent. De même que cette jeune femme s’est montrée nue à ses
invités, mon père, ma tante et oncle Edouard me semblent nus quand ils
habillent leurs paroles de français, langue qui est devenue pour moi
transparente. Si ces paroles n'étaient pas si cruelles, je rirais.
Hier, ils m'ont obligé à m'attabler avec eux devant ma grande
assiette de légumes cuits et ils ont commencé à parler en français de «
cette affreuse affaire de tapis volés, qui a poussé la regrettée au suicide
». Honteux, je suis devenu cramoisi et j’ai baissé la tête. Je me suis
senti pareil à cet homme invisible dont j'avais lu les aventures dans une
bande dessinée. J'imagine que cet homme tout-puissant a dû être très
malheureux.
Un goût de terreur dans la bouche, j'ai tout compris, j'ai tout appris
sans le vouloir.
L'« affaire des tapis volés » que Maminka regrettait tant s'est
transformée en accusation contre elle et papa. Quelques Femmes
antifascistes les ont accusés d'avoir hébergé le major Schultz et d’avoir
été approvisionnés en vivres par des camions allemands pendant toute
la guerre.
Au lieu de leur démontrer que nous avions été absents et que
notre maison avait été réquisitionnée, cruellement blessée par cette
atteinte à son honneur et affaiblie par son anémie, Maminka a préféré
refuser cet affront par un geste désespéré. Papa a prouvé que cette
accusation était parfaitement injuste deux jours après sa mort, mais trop
tard pour faire revenir Maminka à la vie.
La nuit suivante, la nuit dernière, j'ai vécu un événement plus
atroce encore que sa mort : son retour à la vie. Il a eu lieu en rêve. Il y a
des rêves pénibles dont on perd le souvenir dès que l'on se réveille,
mais il est des rêves dont on se souvient sa vie durant. Je crois que je
mourrai avec ce rêve devant mes yeux.
Comme tous les dimanches à treize heures sonnantes, nous
sommes attablés. Oncle Edouard, le plus âgé, occupe le haut bout de la

table, papa et tante Milena sont assis à sa gauche et à sa droite. Notre
Loudmila, qui déjeune pour la première fois avec nous, se trouve à côté
de moi, à l'autre bout. Toutes les grandes personnes mangent leur
bouillon de cadavre de poulet, que tante Milena arrose copieusement de
larmes.
J'entends sonner à la porte de service, celle qui donne sur le
jardin, derrière la maison. Il me semble que je suis le seul à avoir
entendu. Un peu étonné que personne ne réagisse, je quitte ma grande
assiette de légumes cuits, me lève et me dirige vers le carillon qui
retentit déjà pour la troisième fois. La porte de service est au bout d'un
couloir. Elle est vitrée et protégée de l'extérieur par des barreaux en fer
forgé. Arrivé devant elle, abasourdi, je sens mon sang se glacer.
En bas des trois marches, je vois Maminka, vêtue de sa robe de
chambre feuille-morte et coiffée de son turban, sur le fond des feuilles
mortes de la vigne vierge. Elle tend un visage blafard et lève vers moi
ses yeux de biche larmoyants avec une expression d’infinie humilité.
Des frissons dans le dos, je l'entends articuler des mots inaudibles pour
tous, sauf pour moi, des paroles prononcées à la manière exagérée des
sourds-muets.
« Laisse-moi entrer, me dit-elle d’un ton humble en baissant le
front. Ils ne veulent pas de moi, gémit-elle. Je t'en supplie, laisse-moi
entrer. »
Pétrifié de terreur, le cœur serré de pitié, je n'ose pas saisir la clef.
Je fais un pas en arrière, je recule, recule et je finis par m'enfuir comme
le dernier des lâches, un fils bas, vil, cruel et méprisable. Hors d'haleine,
je retourne dans la salle à manger en craignant que la sonnerie ne
retentisse de nouveau.
Silence de plomb, interrompu seulement par les craquements des
os de poulet. Personne ne me prête attention, comme si j'étais vraiment
invisible. Ils savent bien que Maminka se trouve devant la porte, mais ils
font semblant de rien. Ils lui interdisent d'entrer dans la maison. Indigné
et décidé à les tirer de leur torpeur, je pousse un cri désespéré et je me
réveille trempé de sueur.
Pendant mon cauchemar, la petite glande de mon cou a de
nouveau sécrété son étrange goutte transparente, bien que nous ne
soyons pas à l'époque de la pleine lune. Peut-être Maminka s'en sert-
elle pour me faire signe, pour m’indiquer sa présence. Dans un autre
monde ou sous une autre forme d'existence ?

Ce rêve pénible m'a laissé sans forces. Une très grande fatigue
s'est installée en moi, comme si je me trouvais au milieu d'un nuage de
grêle. Toujours avec cette petite fièvre, je me sentais partir, me détacher
en douceur du monde des vivants. Silencieux, monotones, les derniers
jours de l'été s'envolaient comme des fleurs de peupliers et seuls des
rires d'enfants dans les cours voisines parvenaient parfois à mes
oreilles. Notre essaim d'abeilles ne venait plus, la vigne vierge ne
donnant plus de poussière jaune. Je ne regrettais rien, je me laissais
couler, à l'égal d'un bateau de papier se désagrégeant dans l'eau
dormante.
Jusqu'au jour où surgit Hercule !
Ce surnom que je lui ai donné, il le doit à ma lecture récente des
légendes grecques, réécrites pour les enfants par un ami d'oncle
Edouard. Hercule, que sa mère cruelle n’a pas voulu allaiter et qu’elle a
rejeté, Hercule, le plus fort et le plus célèbre des héros grecs.
Capable d'avaler une bonne douzaine de mouches en dépit de sa
petite taille, mon Hercule est une force de la nature. Un beau matin, il
est apparu sur ma fenêtre grande ouverte, avec le premier rayon de
soleil, et il ne m'a plus quitté. Depuis son arrivée, je reprends des forces
et tous les matins, lorsque notre Loudmila est au marché, je chasse sa
nourriture dans l'arrière-cour, où j'ai caché, au pied de la clôture, un os
de poulet qui attire les insectes.
Une tête en forme de triangle, des yeux vifs sous des paupières
mobiles, rapide comme l'éclair, Hercule, mon lézard, attrape avec sa
langue fourchue toutes les mouches que je lui offre et les ingurgite en
moins de deux. Une fois rassasié, étendu sur le rebord de la fenêtre, il
me fait quelques clins d'œil joyeux puis descend sur ma table de nuit
pour y passer de long moments paisibles à se chauffer au soleil. Il me
redonne courage, me revigore, me remet sur pied. Je déploie de
nouveau mon pavillon : je ne me laisserai pas couler comme une barque
de papier imbibée d'eau.
Hier, j'ai vécu un moment d'angoisse. Hercule est arrivé à notre
rendez-vous avec la queue coupée. Chose étonnante, son accident n'a
eu aucun effet sur son appétit prodigieux. Il a gobé sept mouches
d'affilée et s'est installé au soleil comme si de rien n'était. J'ai entendu
dire que la queue coupée des lézards repoussait tout simplement

comme une plante fauchée. Je les envie, j'aimerais que ma jambe
pousse un peu aussi, rien que d'un petit centimètre, pour que je ne boite
plus, pour que je puisse courir parfois, comme Zorko, comme les
Coureurs de la dernière chambre.
Une fois mon pavillon déployé, je décide de guérir définitivement.
Mon plus grand supplice, c'est le thermomètre de notre Loudmila, qui
me cloue au lit depuis des semaines. Deux fois par jour, elle me le
glisse sous l'aisselle et m'oblige à le garder ainsi pendant dix minutes
interminables. Tous les matins, elle répète : « Remercions le Seigneur
d'être vivants », tous les soirs, elle répète inlassablement : « Le
marchand de sable va passer ». Je dirais plutôt le « marchand des
sables mouvants » dans lesquels je sombre.
Le haut de ce vieux thermomètre a été cassé pendant la guerre ;
notre brave Loudmila l'a réparé à l'aide d'un bout de chiffon et de
sparadrap. Au fil des ans, le sparadrap a séché et, le jour de la première
apparition d'Hercule, j'ai découvert tout à fait par hasard que l’on pouvait
sans peine ôter ce capuchon et le remettre en place. Je me suis
immédiatement rendu compte que son petit réservoir et son tube de
verre, partiellement remplis de mercure, pouvaient coulisser vers le bas.
Aussitôt découvert, aussitôt fait. Un jeu d'enfant. Si on les poussait
de cinq millimètres vers le bas, le vif-argent descendait au-dessous des
fameux 37°, annonçant à notre Loudmila que mes bronches
enflammées avaient miraculeusement guéri toutes seules. Mon ami
Hercule a salué cette trouvaille par de joyeux clins d'œil.
J'ai poursuivi mes ruses durant toute une semaine et enfin obtenu
de papa l'autorisation de sortir. Je sais bien que mentir est un péché,
mais oncle Edouard dit que la santé a plus de prix que la plus grande
des fortunes. Le plus extraordinaire dans cette histoire, c’est que j'ai
vraiment recouvré la santé en mentant pour la bonne cause.
Le jour où je suis sorti pour la première fois, Hercule a disparu à
jamais.
En automne
Dans ma langue maternelle, celle de Maminka, le mot qui désigne
l'automne est composé de deux syllabes. Si on les sépare, elles ont une
autre signification, l'automne veut alors dire : « c'est l'ombre. » C'est

étonnant et drôle comme certains mots cachent le sens secret de la
nature ! En effet, en automne, notre colline de Toptchider se couvre
d’ombre, elle est enveloppée d’une épaisse couche de feuilles mortes,
surtout aux environs du monastère des religieuses.
C'est là que nous sommes allés, Tchaslav, Radoch, Zorko et moi,
le jour de nos retrouvailles. Peu avant, le cœur serré, je m’étais rendu
seul chez Tchaslav, que je n'avais pas revu depuis le grand voyage de
Maminka.
Il a été le seul à me regarder droit dans les yeux.
« Je regrette, vieux, m'a-t-il dit.
- Ils ne savent pas que je suis au courant, lui ai-je avoué.
- Les grandes personnes résonnent comme ma pantoufle », a-t-il
tranché avant de m'emmener dans sa cave pour me montrer un vélo à
quatre places qu'il avait construit avec différentes pièces provenant de
deux vieilles bicyclettes.
Je suis resté bouche bée. J'avais déjà eu l'occasion de voir un ou
deux tandems sur la Colline, mais je n’avais jamais rencontré un engin
si singulier, un véhicule à trois roues, alignées, équipé de quatre
guidons, de quatre pignons et d'un système très compliqué de chaînes
et de pédales.
Tchaslav était fier comme un pou sur un chignon.
« C'est pour notre compagnie, m'a-t-il dit, pour nous, les quatre
mousquetaires. Il ne nous manque que deux selles, une petite pour toi
et une grande pour Radoch.
- Je ne sais pas faire de bicyclette, ai-je avoué.
- C'est pas grave, a-t-il fait. Zorko sera aux commandes, il pédale
comme un roi. Tu n'auras qu'à t'accrocher à ton guidon fixe. Pour toi, j'ai
prévu un pédalier un peu plus haut que les autres.
- Tu penses à tout », ai-je répondu.
Radoch et Zorko arrivent à l'heure dite. Tchaslav nous propose
d'essayer sans plus tarder son engin dans la cave, bien qu’il manque
encore deux selles. Nous allons les remplacer par deux coussins de sa
grand-mère. Nous n'allons pas conduire pour de vrai, les pignons et les
chaînes ne sont pas encore terminés. Nous allons tout simplement nous
asseoir, fermer les yeux et imaginer une course folle vers la Save, le
long des ruelles abruptes et tortueuses.

Enthousiasmés, nous acceptons. J'enfourche mon coussin en
queue de véhicule, je ferme les yeux et tombe aussitôt à la renverse
dans un fracas de métal. Le bel engin de Tchaslav s’est brisé et
effondré sous le poids de Radoch, qui s’est assis au milieu.
« Tant pis ! dit Tchaslav, inébranlable. Bientôt, nous construirons
deux tandems. Deux fois deux font quatre mousquetaires. »
Le monastère orthodoxe est situé au fond d'un vaste parc laissé à
l'abandon, transformé en un bois touffu, véritable forêt vierge
d'arbrisseaux et de broussailles. Saisis d'une crainte inexplicable, nous
nous arrêtons à l’entrée d'une allée ombragée, coincée entre deux
rangées de marronniers. Depuis des mois, le bruit court que les
libérateurs de notre ville ont fusillé ici deux douzaines de notables de
notre Colline et qu’ils les ont enterrés sur place, au pied des
marronniers. Radoch affirme que deux de ses oncles, des banquiers,
ont été tués là, mais que personne dans sa famille n'ose chercher leurs
corps par crainte de nouvelles représailles.
Nous cessons de parler et nous engageons dans l'allée et ses
ombres menaçantes. Les troncs d'arbres centenaires semblent
couverts d'écailles brun sombre tels des reptiles géants. Leur feuillage
très épais laisse à peine passer quelques rayons de soleil qui, des deux
côtés du chemin, éclairent de petits monticules tapis sous les feuilles
mortes.
Apeurés, nous avançons à contrecœur, sans mot dire. Le cimetière
que j'avais vu sur la pente nord de notre Colline ne m’avait pas du tout
fait peur. Cette foule de morts enfermés dans leur maison éternelle
m’avait paru sans danger. Ils semblaient appartenir à la nature, tout
comme les êtres vivants. Ici, pourtant, j'ai peur des cadavres de ces
pauvres hommes bannis de la nature. De plus, le sol est jonché de
bogues éclatées couleur de marrons lustrés.
Je ramasse deux marrons et je les caresse.
« La couleur de la mort », dis-je.
Tout pâles, mes amis me regardent, interloqués.
« Brun-noir de marrons lustrés, dis-je. C'est la couleur de la mort. »
Un sourire crispé aux lèvres, mes amis dodelinent de la tête, l’air
de penser : il est complètement toqué, celui-là. Mais ils n'ont pas le
temps de le dire, car notre attention est attirée par une étrange créature
que nous voyons agenouillée devant une tombe, à une cinquantaine de

mètres de nous. Elle se lève et vient à notre rencontre, une femme
sèche comme un échalas, vêtue d'une longue robe marron foncé. Les
yeux vides et décolorés, comme ceux des malvoyants, elle passe à côté
de nous sans nous regarder, en emportant avec elle l'odeur de moisi de
sa soutane.
« Bon sang ! murmure Tchaslav. C'est comme ça que j'imagine les
vampires. »
En silence, Radoch nous fait signe de nous arrêter, puis de le
suivre. Il quitte l'allée et s'engage dans un sentier étroit, envahi par les
mauvaises herbes. Il nous conduit, une dizaine de mètres plus loin, vers
une petite clairière, pas plus grande que notre salle à manger. C'est le
moment pour moi de rester une fois de plus bouche bée : Radoch sort
de sa veste un paquet doré et en tire une longue cigarette avec un filtre,
lui aussi orné d'un anneau d'or.
« Bulgares, dit-il. D'avant la guerre. »
Zorko, qui a toujours les poches pleines d’objets utiles, s'empresse
d'y fouiller pour en sortir une boîte d'allumettes. Les mains un peu
tremblantes, il allume la cigarette bulgare de Radoch. Celui-ci en tire
une bouffée, l'avale et la rejette en l'air. Un rond de fumée flotte au-
dessus de sa tête comme une auréole de saint. Il passe la cigarette à
Tchaslav. Les yeux écarquillés, je le regarde faire la même chose avant
qu’il tende la cigarette à Zorko. Moi, je refuse en secouant la tête, et la
cigarette se retrouve accrochée aux lèvres charnues de Radoch.
Il tire une nouvelle bouffée, l'avale et, avant de la rejeter, déclame
d’un ton pompeux :
« Une souris verte, qui courait dans l'herbe... »
Un accès de toux coupe court à sa comptine. Après avoir vomi
dans les broussailles, il nous rejoint, l'air grave.
« Nous allons les déterrer ! dit-il d'un ton impérieux.
- Qui ? demandons-nous à l'unisson.
- Mes deux oncles. Nous allons revenir ici de nuit, équipés du
nécessaire pour creuser : bêches, pioches, pelles. Mes oncles doivent
être enterrés comme de bons chrétiens.
- Tu es fou ou quoi ? proteste Zorko. On ne connaît pas leur
tombe, on ne peut pas en creuser deux douzaines !
- Dans ce cas-là, décide Radoch, nous fabriquerons deux
douzaines de croix pour les poser sur toutes les tombes.
- Je mets ma grotte à ta disposition, dit Tchaslav. »

Nous nous asseyons, les jambes croisées à la turque. Radoch
nous distribue ses cigarettes, une longue cigarette bulgare pour chacun.
« Ce n'est pas un cadeau, nous prévient-il. C'est un prêt qui va
nous permettre de parler de choses sérieuses. »
Des choses sérieuses, nous allons en parler en collant chacun
une cigarette bulgare au coin de notre bouche et en faisant semblant de
fumer.
« Je n'ai pas peur des morts, mais ceux d’ici me donnent froid
dans le dos », dis-je en me mordant les lèvres.
Radoch
s'esclaffe.
« Mes oncles ne vont pas te mordre ! dit-il en se moquant de moi.
Que sais-tu de la mort ? me demande-t-il. Rien de rien, répond-il à ma
place. Pour comprendre la mort, il te faudrait d'abord comprendre la vie,
comme disait le sage. Que sais-tu de la vie ? martèle-t-il. Quel est ton
but dans la vie ?
- Moi, je n'ai pas de but, dis-je en bégayant. Le but de la vie est la
vie même... La vie nous prend beaucoup de temps... Pour la vie,
l'important, c’est d'être vivant...
- La vie est la plus grande faiseuse de cancres, dit Radoch, c’est
une école où personne n'apprend ses leçons. »
Je sors à la hâte de ma veste mon petit crayon et un bout de
papier pour noter ces paroles.
« Ce serait génial si la vie commençait par la vieillesse et finissait
par la jeunesse, dit Tchaslav.
- La vie est une course d'obstacles, dit Zorko. Le vainqueur est
celui qui atteint le but le dernier. »
Mes camarades me regardent avec suspicion prendre mes notes.
« Qu’est-ce que tu gribouilles ? me demande Radoch, l'air méfiant.
- Je note vos paroles pour la postérité., dis-je. Dans la vie, je serai
écrivain. »
Incrédules, mes amis me dévisagent. C'est à leur tour de rester
bouche bée.
« Bon sang ! » dit Tchaslav.
Et je réplique :
« Formidable, n'est-ce pas ! »
Trois jours plus tard, avant notre déjeuner du dimanche, je profite
de ce que mon oncle Edouard sort dans le jardin pour le suivre jusqu'au

potager, où il observe avec attention les choux de notre Loudmila,
comme s'il cherchait à résoudre un très grave problème.
« Mon oncle, j'ai une question sans réponse, fais-je.
- Tu n'es pas le seul, mon chou, me dit-il, l'air absent, les yeux
fixés sur une tête de chou. Quand j'étais petit, on me disait que maman
m'avait trouvé dans un chou. »
Depuis quelque temps, tous les dimanches, oncle Edouard
évoque son enfance, alors qu'il oublie même ce qui s’est passé la veille.
« Que savons-nous de la vie, mon oncle ? »
Il lève ses yeux d'aigle vers une tourterelle solitaire qui plane dans
le ciel azuré.
« La vie est grande, plus grande que tous les océans de la Terre,
répond-il en souriant. Personne ne peut l'embrasser de son regard. Les
enfants de ton âge tentent fiévreusement de s'expliquer le monde qui
les entoure et de donner des noms aux choses qu’ils découvrent. Hélas
! ils ne cherchent guère la vérité de leur être. Nombre de ces enfants
resteront enfant toute leur vie et quitteront cette Terre ignorants. La vie
est un labyrinthe dans lequel nous errons et errons jusqu’à ce que nous
en sortions pour rejoindre la mort. »
J’ai décidé de chercher la vérité de mon être. Je n'ai aucune envie
de m'égarer dans la vie. Maminka a trouvé la sortie de son labyrinthe,
mais ce n'est pas l'issue à laquelle je songe. Je n'arrive pas à
comprendre comment elle a pu renoncer à la vie. J'espère qu'elle ne
réapparaîtra plus dans mes rêves.
Elle est de moins en moins présente dans la maison. Ses photos
ont disparu les premières, de jolies photos sépia de sa jeunesse dans
des cadres argentés : jeune fille, un chat blanc sur les genoux, jeune
femme coiffée d'un turban et assise dans un fauteuil de rotin.
Récemment et tout à fait par hasard, en cherchant un parapluie dans
son armoire, j'ai découvert que la moitié de sa garde-robe s'était
volatilisée. Je n’en ai pas cru mes yeux. Une semaine plus tard, je l'ai
retrouvée entièrement vide. Il s’est produit la même chose avec de
nombreux objets qui lui ont appartenu, sa trousse de toilette dans la
salle de bains, ses chaussures et ses bottes, son manteau de pluie et
ses deux chapeaux.
J'ai eu la chance inouïe de retrouver son flacon de parfum parisien,
oublié au fond d'un tiroir de la grande commode de tonton Pinter. Vidée
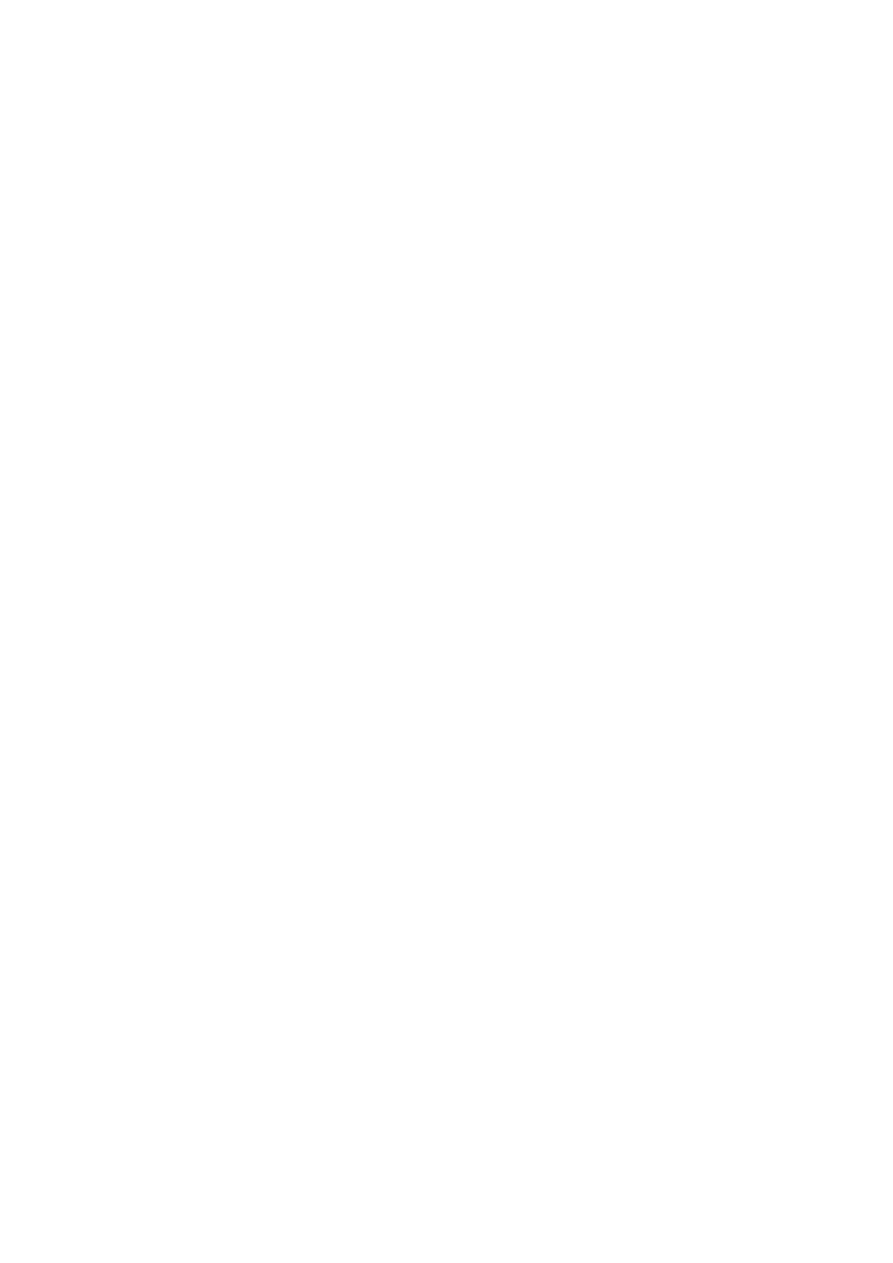
de son contenu, la poire de porcelaine exhalait toujours ses senteurs,
aussi fraîches et vivantes qu'avant la disparition de Maminka. Ces
parfums tenaces de plusieurs fruits et fleurs ont provoqué une forte
douleur au-dessous de ma poitrine, comme si quelqu'un remuait un
couteau dans ma plaie.
Quelquefois, j'ai l'impression que papa et notre Loudmila causent la
mort de Maminka pour la deuxième fois. C'est pourquoi j'ai décidé de
sauver son flacon car, tant que son parfum sera vivant, elle restera
présente à mes côtés.
Pour moi, une belle odeur est toujours plus importante que son
image. L'image d'une fleur qui s'épanouit ne dure que peu de temps,
comme c'est le cas pour nos prkoss. Ils naissent le matin et meurent
déjà le soir. Pourtant, si on enveloppe une seule de leurs fleurs
odorantes dans un mouchoir, son parfum continuera de vivre encore
plusieurs jours après sa mort. Il suffit de la humer, les yeux fermés, pour
que l'image de la fleur vivante apparaisse comme par miracle. C'est
comme ça que la vie brave la mort, cette vie qui est plus grande que
tous les océans du monde.
Somme toute, les yeux voient parfois davantage fermés que
grands ouverts. En serrant les paupières, on sent la confiture de cerises
et on voit Maminka sur son escabeau les cueillir dans le jardin. En
fermant les yeux, on flaire le gros sel un peu humide dans le garde-
manger et on voit la mer, car la mer - comme le prétend oncle Edouard -
est remplie d'eau salée.
Le grand frère de Radoch a traversé l'Océan sur un
transatlantique pour se rendre au Canada. J'aimerais voir un océan pour
de vrai, ou au moins la mer, où nous ne sommes pas allés cet été. Privé
de cette mer, je n'ai pas appris à nager. Et ne sachant pas nager, je ne
suis pas allé avec notre classe à la piscine. Je ne le regrette point,
j’évite mes camarades de classe autant que je le peux depuis qu'ils me
poursuivent de leur regard compatissant. Blême, bégayant, les doigts
crispés, les joues pivoine et les jambes flageolantes, je les fuis surtout
quand ils vont à la piscine, où ils se déchaînent en moqueries.
« Miodrag, Marie, Loup Janvier ! crient-ils. Tu ne sais pas nager ! Tu
as peur de l'eau froide, toi qui portes le nom du mois le plus glacial de
l'année ! Miodrag Janvier ! Et pourquoi pas Mars, Avril ou Miodrag
Décembre !... »

Le 1er octobre
Au moment où j'ai reçu le message codé de Tchaslav, j'étais en
train de finir mes devoirs. C’était clair et sans réplique : « Viens tout de
suite ! » Comme c’était convenu, Tchaslav a utilisé le téléphone : trois
appels successifs. Il a raccroché juste après la première sonnerie, et
ce trois fois de suite. Attendant un coup de fil de sa cousine de
Slovénie, notre Loudmila s'est précipitée trois fois sur le téléphone pour
ne trouver qu’une communication coupée.
Elle a parcouru mes devoirs d'un œil distrait et m'a autorisé à
sortir. Quand je suis arrivé à notre quartier général, la grotte était déjà
ouverte et je me suis joint à Radoch et à Zorko, qui étaient en train
d’admirer l’œuvre de Tchaslav. Depuis une semaine, nous amassons
partout toutes sortes de choses pour que Tchaslav puisse construire les
vingt-quatre croix destinées aux pauvres fusillés. Chacun de nous a
apporté sa contribution : moi, deux perches de notre clôture et les pieds
de trois chaises trouvées dans notre grenier ; Radoch, des lattes du
poulailler de son grand-père ; Zorko, plusieurs échalas du vignoble de
sa grand-tante. Le choix de Tchaslav s'est porté sur des objets en fer,
barres et pieux métalliques, dénichés dans l'atelier de son prisonnier de
papa.
En se servant de tout ce fatras de vieilleries et aidé de ses limes,
vrilles et autres fraiseuses, il a réussi à fabriquer vingt-quatre croix de
diverses tailles, formes et couleurs, des croix grecques, latines et
tréflées, des croix de Malte et de Lorraine, que Radoch connaît par
cœur.
Ce dernier nous a donné le mot d'ordre et le mot de passe.
Rassemblement à minuit dans le verger, derrière l'épicerie du père
de Maya. Mot de passe : « Une souris verte. »
Rentré à la maison avant le dîner, je me suis empressé de monter
dans le grenier où j'avais découvert un vieux réveil. Pour étouffer ses tic-
tac étourdissants, je l'ai glissé dans une pantoufle de papa et placé sous
mon oreiller. Malgré toutes mes précautions, les tic-tac de ses roues
rouillées m’ont longtemps empêché de m'endormir.
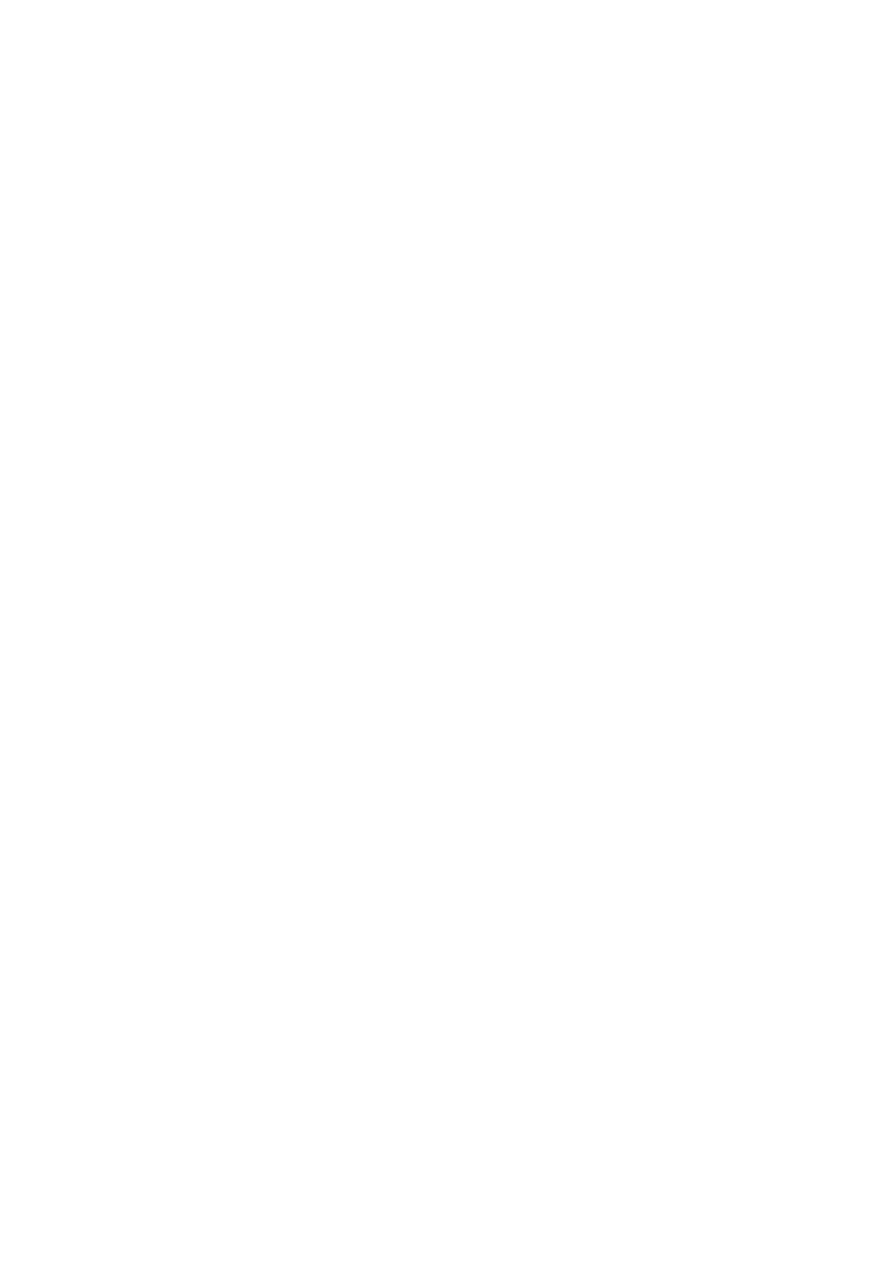
À minuit moins vingt, j'ouvre mes persiennes et je me faufile
dehors en m’aidant des branches robustes de notre vigne vierge.
J'atterris sur la petite allée sain et sauf. Je ne suis jamais sorti si tard. Si
papa l'apprenait, il m'administrerait une de ces claques qui vous font
sonner la tête comme une casserole tombée par terre.
La lune n'est pas encore apparue et la nuit est aussi noire qu’un
corbeau. Ce noir argenté sur la couronne des arbres, comme celui des
ailes de corbeaux, annonce la proche apparition de la pleine lune. Mes
nouvelles chaussures orthopédiques aux semelles de caoutchouc ne
font aucun bruit. J'en suis fier et j'arrive le premier sur le lieu du rendez-
vous. J'en profite pour ramasser par terre un coing à moitié pourri. Je ne
le mange pas. Les paupières serrées très fort, je le hume et - comme
par miracle - je me retrouve dans la petite chambre de notre Loudmila,
qui m'embrasse de son doux sourire, les yeux larmoyants comme ceux
de notre chèvre Diana.
Elle me gazouille en allemand une des berceuses de ses voisins
autrichiens et me la traduit aussitôt.
«
Träume, du mein süsses Leben,
«
Von dem Himmel, der die Blumen bringt... »
«
Rêve, toi, douceur de ma vie,
«
Rêve du ciel qui fait éclore les fleurs... »
Un bruit de pas me tire de ma rêverie. C'est Tchaslav.
Je reconnais son toussotement, signe d’inquiétude.
Je demande d'une voix sourde :
« Qui est-ce ?
- Une souris verte », me répond-il.
Comme il a plus d'un tour dans son sac, il a construit, en se
servant des roues de notre bicyclette cassée, une sorte de charrette
parfaitement silencieuse pour transporter en douce nos vingt-quatre
croix.
Troisième arrivé, Radoch réplique sans faillir :
« Une souris verte ! »
Seul Zorko, arrivé dernier, nous met dans l'embarras.
« Une souris rouge, dit-il et il s’excuse aussitôt en nous expliquant
qu'il était en train de penser à son tee-shirt de cette couleur, qu'il doit
laver pour la course d'obstacles de mercredi.

- Dans une vraie guerre, cette étourderie te coûterait la peau des
fesses, le réprimande Radoch. Autant que je sache, ton tee-shirt est
vert.
- Il est rouge, proteste Zorko.
- Il est vert », gronde Radoch.
Tchaslav se hâte d'apporter son soutien à l'infortuné :
« Zorko est daltonien », dit-il.
Je m'empresse de demander :
« C'est quoi, un daltonien ?
- C’est quelqu’un qui ne distingue pas le feu rouge du feu vert
dans une gare, m'explique Radoch.
- Assez bavardé, intervient Tchaslav. Je dois être de retour chez
moi avant une heure et demie. C’est à cette heure que ma grand-mère
se lève pour prendre ses cachets, et elle ne manque jamais de faire un
tour dans ma chambre.
- Action ! » ordonne Radoch.
Lorsque nous atteignons l'allée, la cime des marronniers est déjà
ourlée du clair de lune, mais le chemin entre les deux rangées de troncs
reste ténébreux, entourée d'ombres menaçantes qui nous font
frissonner. D'étranges étincelles volantes saluent notre arrivée, une
multitude de lucioles que Radoch attrape au passage avec sa
casquette, glissant ensuite leurs flammèches froides dans une poche,
sur sa poitrine.
Munis de trois marteaux, nous nous dépêchons de planter nos
croix au bout des monticules. Ce travail macabre achevé, nous
constatons que Tchaslav a pensé à tout : il a apporté un balai à dents
métalliques, dont il se sert pour effacer nos traces.
Radoch nous met en rang et sort de sa poche quelques lucioles
pour égoutter leur ventre lumineux dans la paume de sa main. Il trempe
son index dans cette grosse tache onctueuse et dessine un signe froid
sur le front de chacun de nous, en finissant par son propre front : c'est
une croix de lumière frémissante vert or.
Puis il se range à côté de nous et ordonne :
« Garde à vous ! »
Nous ôtons nos casquettes et nous honorons ces morts innocents
par une minute de silence, un silence sournois, habité par des bruits
inquiétants provenant des buissons touffus autour de nous.

« Il faudrait faire un feu de peloton, murmure Radoch, une salve
d'honneur, c’est l’usage... »
Zorko, aux poches toujours pleines d’objets utiles, sort de son
blouson un sac de papier plié en quatre. Il le déplie avec soin, souffle
dedans, le gonfle d'air comme un ballon et d'un seul geste l'écrase
contre sa tête.
La détonation nous laisse pantois et provoque dans les
broussailles un véritable tumulte parmi les écureuils et les oiseaux. Les
cheveux dressés sur la tête, nous voyons un grand hibou nous survoler
à tire-d'aile, huant comme dans le film d'épouvante qu'oncle Edouard
avait vu à Paris, au cinéma.
Radoch se hâte de lancer un nouvel ordre :
« Levons le camp ! »
Pas besoin de nous le dire deux fois : nous prenons tous nos
jambes à notre cou.
Quand je rentre à la maison dix minutes plus tard, en me faufilant
dans la cour par la porte cochère entrouverte, je tombe sur une ombre,
celle de papa. Malgré sa petite taille, il a la main lourde, une main qui a
arraché des centaines de dents et dont la gifle vous fait sonner la tête
comme une casserole tombée par terre. C'est la deuxième fois de ma
vie qu'il me gifle ; la première fois, c'était quand je m’étais servi de ma
fronde pour lancer des pierres sur le chat de Marina. Sans un mot, il me
tire par l'oreille jusqu’à la maison. J'étouffe mes larmes, je me retiens :
c'est mon petit papa Arnolphe qui pleure à ma place.
Le lendemain, à la sortie de l'école, Radoch, Tchaslav, Zorko et
moi convenons de faire un détour et de passer par l'allée des
marronniers pour voir dans quel état se trouvent nos croix. À l'entrée du
bois, un soldat moustachu et armé d'un fusil nous barre la route.
« Passage interdit ! nous dit-il.
- Pourquoi, mon caporal-chef ? » demande Radoch.
Flatté, le soldat se penche vers nous :
« Des ennemis du peuple », chuchote-t-il.
Mine de rien, nous lui tournons le dos et descendons vers un autre
chemin que Radoch connaît aussi comme sa poche, un sentier
serpentant entre les arbrisseaux, lieu de passage avant la guerre de la
ligne dix du tramway. Là, à la lisière du parc sauvage, il n’y a personne
pour nous empêcher de nous introduire dans les buissons.

Silencieux comme des guerriers indiens, nous arpentons la piste
qui porte encore les traces des rails d'autrefois. Arrivés, essoufflés, à
proximité de l'allée interdite, un tumulte de voix nous oblige à nous
coucher dans l'herbe. Radoch, qui guide notre file indienne, nous fait
signe de le suivre en rampant. Nous appuyant sur nos coudes et nos
genoux, nous traversons les broussailles et les orties pour déboucher
enfin tout au bord de l'allée, d'où nous embrassons d'un seul regard la
scène de notre exploit nocturne.
Soldats en treillis, policiers armés jusqu'aux dents, infirmiers et
officiers qui crient à tue-tête. Une ambulance et trois camions noirs.
Deux tiers des tombes sont ouvertes et les soldats en retirent des corps
en pleine décomposition, que les infirmiers enveloppent dans des
bâches grises et jettent comme des sacs de pommes de terre dans un
camion. Ils ont fait un bûcher de nos croix. L’âcre fumée nous pique les
yeux et les relents des cadavres nous donnent la nausée. Le cœur
soulevé, je vois Radoch près de moi pleurer en cachette ses deux
oncles, et lui me voit vomir.
Il sèche ses larmes et nous fait signe de fuir. Avant de décamper
derrière lui, je ramasse un marron parmi les feuilles mortes et je le serre
fort dans ma main, un très beau marron brun et luisant que je vais
déposer dans ma cache, au grenier, avec le flacon de Maminka, mes
livres français et mon journal.
Aujourd'hui, j'ai appris une chose aussi triste que décourageante.
On ne vit qu'une seule fois, comme dit oncle Edouard. J'ai compris que
l'on pouvait, en revanche, mourir plusieurs fois.
À la fin octobre
L’autre dimanche, pas le dernier mais l’avant-dernier, oncle
Edouard a chanté sa chère Chine et ses Chinois pour l'ultime fois. Il a
été alors question de cet art singulier de la calligraphie, art de bien
tracer ses caractères, que lui, Edouard Janvier, avait appris et oublié, il
y a de ça trois décennies.
« C’est la sœur aînée de la peinture, a-t-il dit, on calligraphie avec
un pinceau qui se comporte dans la main de l'artiste comme un véritable
sismographe de l'âme.
- Qu'est-ce qu'un sismographe, mon oncle ? ai-je demandé.

- Un appareil qui enregistre les tremblements de terre, m'a-t-il
expliqué. À l’égal d’un sismographe qui détecte les moindres secousses
du sol, le pinceau d'un calligraphe retranscrit les plus petits
frémissements de l'âme. Très souvent ce texte, dit herbe folle, n'est
lisible que pour celui qui l'a écrit.
J’ai décidé d'apprendre la calligraphie et de m'en servir pour écrire
mon journal, qui contient de plus en plus de souvenirs secrets, voire
dangereux, telle la description de notre exploit dans l'allée des fusillés.
Calligraphié, il deviendra illisible pour tout le monde, excepté pour moi.
Depuis la « nuit des marronniers », je le cache soigneusement avec le
flacon de Maminka, mon dictionnaire et la grammaire. Dans le grenier, je
les glisse sous une planche déclouée que je dissimule en tirant dessus
une caisse pleine de tuiles.
Comblé de vieux meubles et d'objets étranges, notre grenier est à
présent moins chaud qu'en été. Quand notre Loudmila est au marché ou
à l'église, j’y lis, assis sur une chaise dont un pied est cassé, ou j’écris,
appuyé sur une table roulante sans roulettes.
Notre grenier ressemble à la caverne d'Ali Baba, bien qu'il ne
contienne guère d'objets précieux. Il est plutôt rempli de choses usées,
couvertes de poussière et de toiles d'araignée. Il me semble parfois que
tous les greniers, comme le nôtre, racontent la fatigue, la maladie, la
lente agonie d'une maison qui vit, vieillit, souffre et se meurt avec ses
habitants.
Notre grenier n'a jamais été aussi triste qu’après la disparition de
Maminka, comme si les objets et les meubles qui lui ont appartenu
pleuraient silencieusement son voyage sans retour. Son secrétaire à la
porte disloquée et aux tiroirs mi-ouverts abrite deux souris, maman
souris et son petit, qui devant moi sautent d’un tiroir à l’autre sans
aucune crainte, préparant leur nourriture pour le long hiver, des grains
gris et jaunes, de la croûte de pain rassis et même le bout d'une bougie
qu'elles grignotent comme une friandise. Elles ont eu l’air très contentes
que je leur offre un morceau de fromage retiré de la souricière de notre
Loudmila.
Je crois qu'elles aiment la musique. Le jour où j'ai retendu le
ressort du phonographe de Maminka et fait tourner un disque larmoyant,
elles ont interrompu leur travail en dressant leurs oreilles pointues. La
grande corne en bois de ce phonographe est obstruée par une épaisse
toile d'araignée qui en rend le son plus pleurnichard encore, comme si

ces voix mortes de chanteurs d'opéra vous suppliaient de les délivrer de
leur emprisonnement dans l’autre monde.
En dépit de cette tristesse qui m'accable, j'aime bien notre grenier.
Quand il fait beau, deux ou trois rayons de soleil passent furtivement
entre les tuiles et percent le nuage de poussière fine qui plane autour de
moi. Ils m’emplissent d'une crainte inexplicable. Lorsqu'il fait mauvais
temps, ces mêmes fissures laissent passer quelques gouttes de pluie
qui dégoulinent lentement le long des poutres. Avec le premier rayon de
soleil, couvertes de ces gouttes, les grosses pièces de bois deviennent
argentées. Cette image m’emplit aussi d'une crainte que je ne sais pas
m’expliquer. Tristesse et joie mêlées. Indicibles, indescriptibles, ces
deux sœurs jumelles me causent un même pincement au cœur.
Abattu par ce poids de plus en plus lourd, je songe parfois à faire
une prière. Mais qui et comment prier ? Prier Dieu ? Dieu ne me paraît
être qu’un mot, à la fois doux et terrible. Il me semble que tous ceux qui
m'entourent Le cherchent désespérément. Notre Loudmila dit qu'Il se
trouve dans le cœur de ceux qui le cherchent. Radoch dit que Dieu est
interdit dans notre pays. Pourtant, oncle Edouard affirme que l'on ne
peut Le frapper d'interdiction comme on interdit l'abus d'alcool, et il cite
une pensée que - d'après lui - les Juifs ont emprunté aux Chinois : « Si
Dieu vivait sur Terre, les hommes casseraient Ses vitres ! »
En fin de compte, personne ne reste indifférent à l'égard de Dieu,
et moi non plus. Tchaslav dit que nos mères sont près de Lui. Si je Le
trouve un jour, je Le prierai de nous les rendre, parce qu'Il est tout-
puissant. S'il n'exauce pas ma prière, qu'Il prenne garde. Tchaslav et
moi casserons tous Ses carreaux et nous nous adresserons à la Sainte
Vierge, qui ne ravirait jamais la mère d'un enfant. Elle nous rendra nos
mères : avec la Sainte Vierge, tout est possible. J'ai vu son visage
dessiné dans le Petit Larousse illustré, le visage de la mère de Jésus,
qui avait les yeux noisette tout comme Maminka.
Tchaslav m'a dit qu'il allait tous les dimanches matin au cimetière
s'incliner sur la tombe de sa maman. Il s’y rend une fois par semaine,
accompagné de sa grand-mère, il se recueille devant cette stèle noire
qui porte une croix et un bas-relief, un profil blanc comme un lys. Je n'ai
jamais vu la tombe de Maminka, je ne sais même pas si elle est ornée
d'une croix. Si ce n’est pas le cas, quand je serai grand et fortuné, je lui
ferai bâtir le plus grand monument du cimetière. Paré de la sculpture
d'une biche couleur feuille-morte et, à son sommet, d’une croix blanche !

Hier, pour la première fois, j’ai relu mon journal. Il m’a fait
beaucoup souffrir, ç’a retourné le fer dans ma plaie. Ç'a été la première
et la dernière fois. Je ne le lirai plus et, dorénavant, je n’y écrirai que
quand des événements importants l’exigeront. Je ne le feuilletterai qu'à
la fin de ma vie. Pendant que je lisais, j'ai ouvert le flacon de Maminka et
j'ai senti son parfum. Comme j'ai gardé les yeux ouverts, je n'ai rien vu.
Elle était présente dans mon esprit, mais elle est restée invisible.
Je crains que son image ne disparaisse à jamais.
Noël
Un événement qui mérite d'être noté ! À Noël, les mites de l'oubli
ont dévoré une bonne partie de la mémoire d'oncle Edouard, surtout ses
précieux souvenirs de Chine. Un vrai drame !
Dimanche. À midi et demi, je sors dans le jardin pour prévenir
oncle Edouard que notre Loudmila a déjà servi le déjeuner. Accroupi
devant le potager, les yeux fixés sur une tête de chou couverte d'une
calotte de neige, il me regarde d’un air hébété.
« Quel déjeuner, quelle Loudmila ? murmure-t-il.
- Notre déjeuner du dimanche, le gigot de cadavre d'agneau que
notre Loudmila a rôti au four, lui dis-je, et je profite de l'occasion pour lui
demander une chose qui me tient à cœur depuis des jours. Oncle,
voudriez-vous m'apprendre la calligraphie chinoise ?
- De quoi s’agit-il ? répond-il. La calligraphie chinoise, mon
Louveteau, c'est du chinois pour moi.»
Surpris par cette déclaration et par le fait qu'il se mette soudain à
parler français, je lui réplique dans cette même langue, sans m'en
rendre compte :
« Pourtant, mon oncle, pendant votre inoubliable voyage en
Chine...
- Je n'ai jamais mis les pieds en Chine, m'interrompt-il en se
plongeant de nouveau dans l'observation de son chou gelé. Le chou
chinois, ça oui, poursuit-il. À Paris, j'en ai mangé à la sauce aigre-douce.
Enfant, j'ai entendu dire qu'on m'avait trouvé dans un chou. Formidable,
n'est-ce pas !
- Ce sont des contes de fées pour enfants, dis-je. Des contes à
dormir debout. »
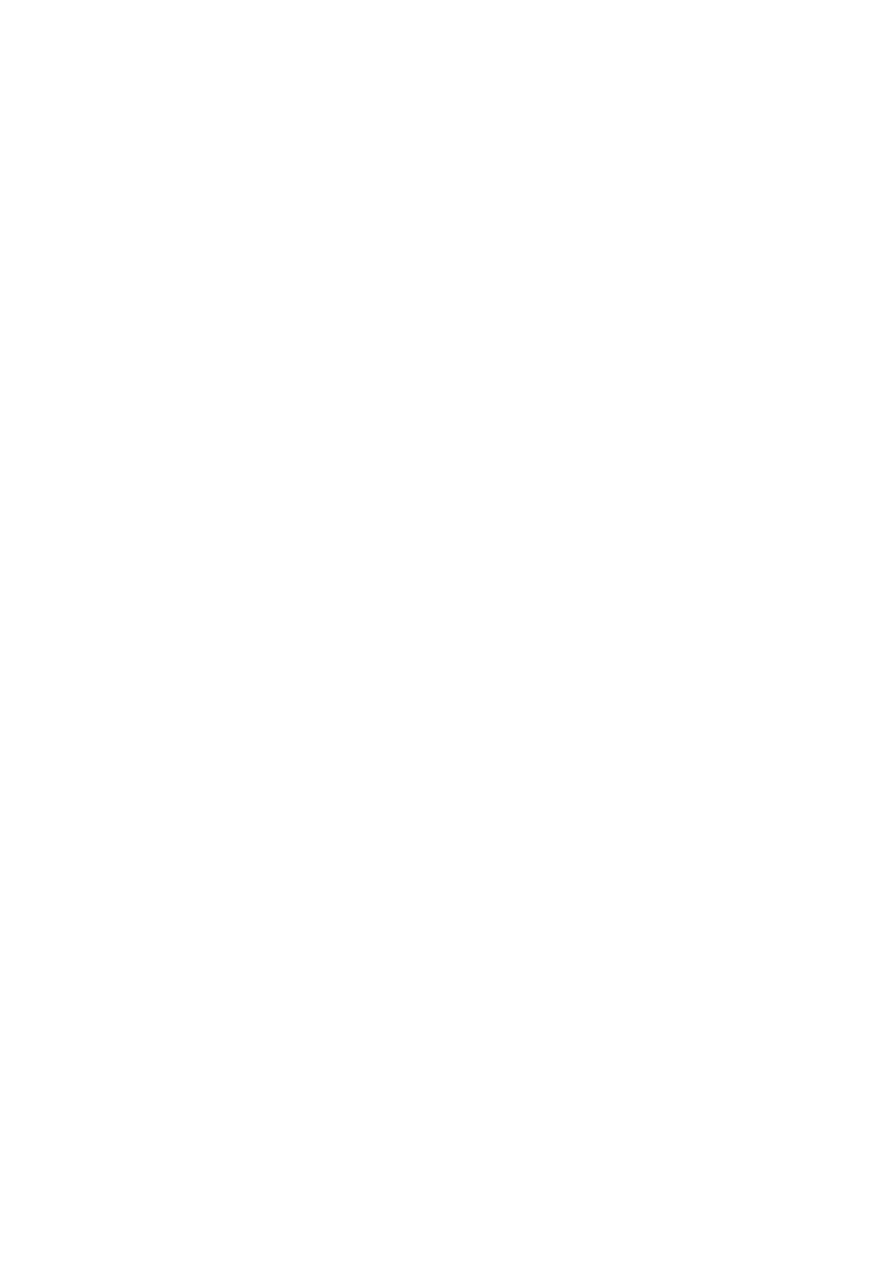
À ce moment-là, je sens la présence de quelqu'un derrière moi et
j'aperçois papa sur le seuil de la maison, l’air médusé.
« Tu parles... français ? bégaie-t-il.
- Normal ! répond oncle Edouard à ma place. N'est-il pas fils d'un
Français ! »
Papa blêmit et je vois qu'il a tout compris.
Moi, l'homme invisible, je redeviens visible, nu comme un ver,
rouge comme un coquelicot.
Papa nous tourne le dos pour étouffer un sanglot.
Pendant le repas, le regard baissé, nous n'avons pas eu le
courage de nous regarder dans les yeux, comme si la mort était une
honte. En ruminant mes légumes cuits, je n'ai cessé de frissonner dans
l’attente de la sonnerie à la porte de service : mon pénible rêve
menaçait de faire irruption dans la réalité. Personne n'a sonné. Peut-être
le réel sait-il être aussi cruel que le pire des cauchemars. Dorénavant,
Maminka n’aura plus le droit de faire partie de notre vie, sauf dans mes
rêves.
Noël, le jour de la naissance de Jésus, est l'anniversaire de tous
les enfants, m'a dit notre Loudmila. Il est source de vie, ruisseau de joie.
Somnolant sous une pluie glaciale, sans sapin décoré ni cadeaux sur
les fenêtres, notre Noël n'a jamais été si morne, si triste, pareil à un
ruisseau tari.
Le lendemain, j'ai fait une découverte extraordinaire, la trouvaille
de ma vie. La bibliothèque de papa occupe une alcôve au fond de notre
salle de séjour. C'est une armoire à trois portes, avec une seule clef
dans la serrure centrale. À la différence des bois de tonton Pinter, qui
fredonnent et chuchotent, l'acajou de la bibliothèque de papa est muet
comme s'il gardait un secret.
En ce jour férié, pendant que notre Loudmila était au marché et
papa dans son cabinet, j’ai pris dans sa bibliothèque le Petit Larousse
pour y chercher le sens du mot vernal, sur lequel j'avais trébuché dans
les Enfants du capitaine Grant, de Jules Verne. « Une plante vernale -
qui fleurit au printemps. » Un peu distrait, songeant au lointain
printemps de notre rue de Septembre, par mégarde j'ai laissé tomber
par terre un cahier coincé entre deux livres, un petit cahier jaunâtre sans
couverture dont les pages étaient couvertes d'une écriture serrée.
Cette écriture, je l'ai reconnue tout de suite, la même que celle de
la grammaire française de Maminka. Saisi de fièvre, j'ai parcouru la

première et la dernière page. Il s'en est fallu de peu que je ne
m'évanouisse : dans mes mains se trouvait le journal de grossesse de
Maminka ! Le journal de ma venue au monde ! Sans perdre une
seconde et profitant de l'absence de notre Loudmila, je me suis précipité
dans le grenier pour recopier la première page.
Je la recopie de nouveau ce soir dans mon journal, la gorge
nouée.
Le 13 novembre 1936
On dit que le nombre 13 porte malheur. Quel bonheur que ce
nombre. Après le départ d'Arnolphe, je suis retournée dans mon lit pour
faire encore un petit somme. Les yeux fermés, j'ai calculé le temps qui
me séparait encore du Grand Jour. Trois mois, à peine trois mois. Et, au
même moment, j'ai ressenti son coup de poing. Seigneur, je n'ai jamais
reçu un coup si merveilleux. Elle vit, ma petite princesse, elle s'est mise
à bouger ! Oui, je pressens que ce sera une fille. Je souhaite une fille et
je l'aurai.
J'ai décidé de tenir ce journal à partir d'aujourd'hui et d'y inscrire
tout ce qui se passera, jour après jour.
Arnolphe n'est pas encore au courant. Je vais mettre le
champagne au frais et ce soir, dès son retour, nous fêterons ça. Je sais
qu'Arnolphe préférerait avoir un fils, mais je suis sûre qu'il tombera
amoureux de ma petite princesse. Et, si malgré tout c'est un garçon, je
ne serai pas moins heureuse. La fille deviendra une grande pianiste, le
fils un grand prosateur...
Bouleversé, je chuchote : Hélas ! Maminka ! En dépit de tes vœux,
ça n’a pas été une fille, future pianiste, mais un fils, futur écrivain ! J'ai
tout compris, ma petite maman. Voilà pourquoi tu m'as abandonné.
C'était un fils non désiré, un fils qui laissait à désirer et, en plus, un
garçon boiteux, laid comme un pou, dont tous les camarades se
moquent : « Courage, Mio, ne te soucie pas de ta jambe droite trop
courte ; heureusement, l'autre est plus longue ! » Mais, ce garçon vilain
et infirme, ce « Mio - feuilles de chou », exaucera tout de même tes
souhaits et deviendra prosateur !
Une fois appris les trente-six mille mots de français, je fuirai mon
école, où mes copains se rient de moi, où on doit à tout prix « parler
serbe comme il faut pour que tout le monde vous comprenne ». Si vous
n'arrivez pas à rouler les r comme eux : oiseau rrrarrre, si vous articulez
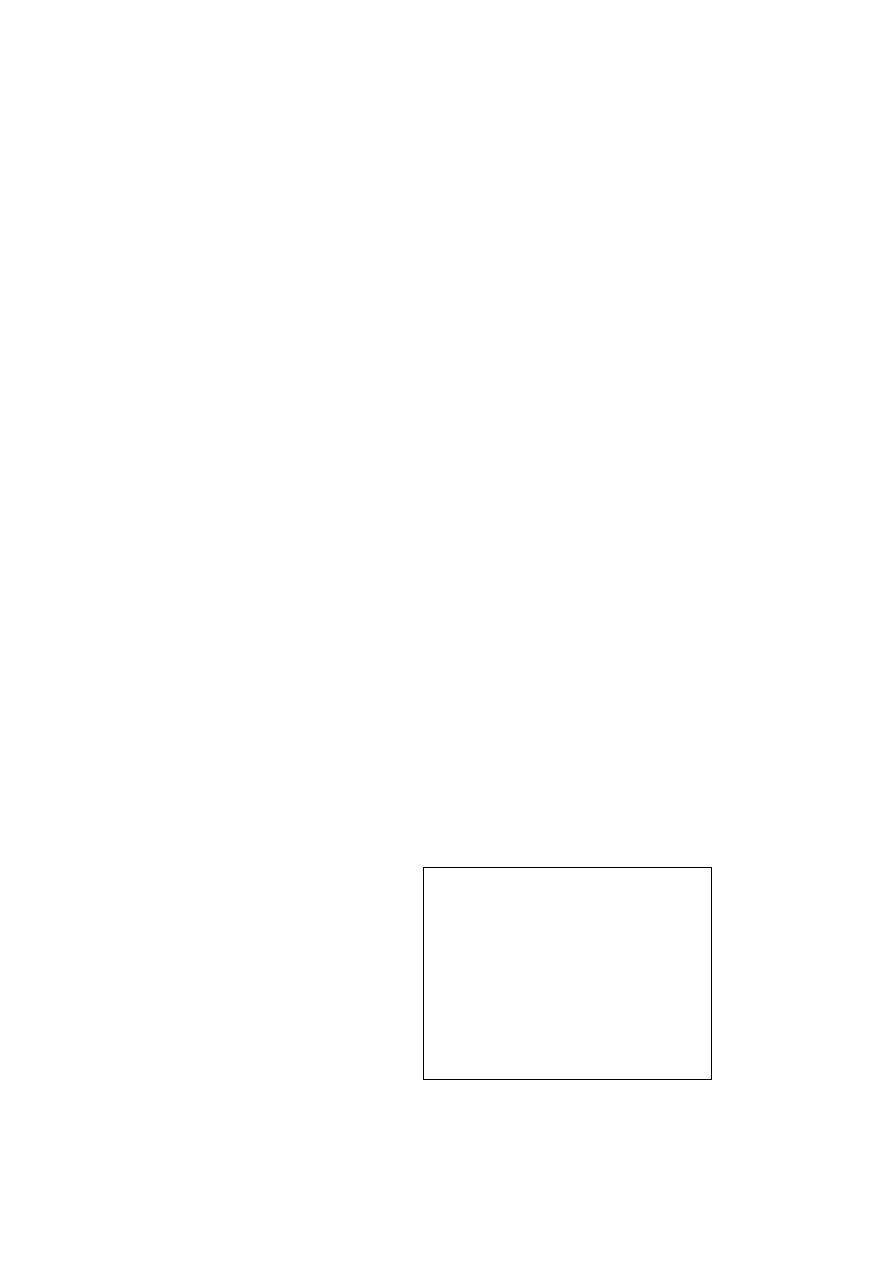
oiseau rare à la française, vous pouvez prendre vos cliques et vos
claques. Je les prendrai et je partirai sans aucun regret. J'irai au bout du
monde, là où tous les gens parlent français. Et, pour finir cette grande
aventure, je deviendrai un écrivain rédigeant ses ouvrages dans cette
langue.
Le texte court que j'ai recopié, le mot de Maminka écrit le 13
novembre 1936, trois mois avant ma venue au monde, est le seul
souvenir que j’ai pu arracher au journal de ma naissance. En remettant
le cahier jaunâtre à sa place, dans la bibliothèque de papa, je
n’imaginais même pas que le lendemain il disparaîtrait pour toujours.
On m'a volé mon seul et unique héritage, le journal de ma
naissance !
Le jour même de sa disparition, j'ai appris par cœur dix nouveaux
mots de français, des synonymes du verbe voler : dérober sans être vu,
escamoter avec adresse, subtiliser avec finesse, dépouiller, enlever à
quelqu'un tout ce qu'il a...
Je me sens dépouillé, on m'a enlevé tout ce que ma petite maman
m'a légué. Quel sale, quel détestable coup !
Après ses photos et ses vêtements volatilisés, papa me paiera
très cher ce dernier vol de Maminka. Quand je serai grand, je le tuerai.
Je bourrerai sa pipe d'un explosif archi-puissant. Il allumera cette
machine infernale, et BOUM !
Ce n’est pas par hasard que les Français disent « casser sa pipe »
pour quelqu'un qui meurt.
Comme je ne trouve pas de mot assez fort pour qualifier ce sale
coup, je vais tâcher de le représenter par un dessin, par le dessin d’un
enfant qui brandit une pancarte.

ENTRACTE
En dépit de quelques nuages se dessinant à l'horizon et menaçant
ma tranquillité depuis trois semaines, je ne vois guère les choses en
noir. Bien au contraire. À l'heure où certains de mes amis d'autrefois
subissent les pires épreuves existentielles, je vais mon petit bonhomme
de chemin sans trop de soucis. L'un de mes compagnons de jeunesse,
atteint d'un cancer foudroyant à l'âge de vingt-trois ans, disait avec un
sourire hautain : « Le temps viendra où les vivants envieront les morts. »
Moi, je ne rien à envier à personne. Je suis un homme chanceux,
malgré quelques tracas que me cause mon travail sur le journal du
Gamin. Sachant bien que la traduction est une école d'humilité, je ne
regrette pas de me l’être fixée pour tâche. Néanmoins le Gamin, ce
Petit Dragon, compagnon de ma prime jeunesse, me paraît souvent,
avec ses projets déraisonnables, trop exigeant à l'égard de sa vie future.
Ses ambitions, bien qu'il s’agisse de celles d'un enfant effronté et d'un

adolescent insatiable, me semblent démesurées. J’ai l’impression
parfois que ce morveux se comporte comme un jeune despote envers
l'homme entre deux âges qu'il va devenir.
Dire que l'enfance est malheureuse, que c’est un mauvais moment
à passer, m’apparaît de plus en plus ridicule. Esclave pendant des
années des desseins que j'avais formés à l’âge tendre, je commence
enfin à comprendre certaines choses, qu’il suffit d'appeler par leur nom.
Le « fâcheux moment à passer » est plutôt celui de l'âge mûr, de
l'homme fait, courbé sous le poids des serments trahis de sa jeunesse.
C'est la raison pour laquelle, depuis quelques jours, je traite mon
Dragon d'impitoyable petit tyran.
S'il a cru que je pleurerais ses infortunes, il s'est lourdement
trompé. Un pauvre orphelin ! Et alors ? Moi aussi, je suis orphelin, nous
sommes tous orphelins ou nous le deviendrons tôt ou tard. Toutefois, je
ne peux lui contester une certaine sensibilité, bien qu'elle tire sa source
d'une fragilité qu'un rien blesse et effarouche, tout comme la mienne
depuis mon âge de raison. Et alors ? On ne peut pas passer sa vie à
verser des larmes sur son nombril.
Quant à sa langue, qui fut aussi la mienne, c'est elle qui me cause
le plus de tourments. On dit que l'on peut tout faire avec sa langue - et
même se taire. Hélas ! cela n’a pas été le cas de mon Gamin, qui a crié
toute sa misère sur les toits. Traducteur, serviteur de sa parole, je lui
emboîte le pas et le sers fidèlement, essayant parfois d’enrichir un peu
son vocabulaire. Cette tâche n'est pas toujours agréable. Feu mon
oncle, que j'aimais et estimais, citait souvent ce vieil adage d'Extrême-
Orient : Un glaive n'a que deux tranchants ; la langue, elle, en a des
centaines.
Sa langue n'est pas morte en moi. Assoupie, cachée sous les
cendres comme la braise, elle est prête à être ravivée. Remuer ces
cendres réveille en moi des mots qui semblaient oubliés, qui, tirés de
leur sommeil, se manifestent dans leur sens originel. Ainsi ressuscités,
ils expriment leur sauvagerie primitive, des sentiments à l'état pur, ceux
d’un passé lointain. Bizarrement, ils se comportent comme des êtres
animés, capables de vivre en dehors des hommes et portant leur
fardeau de mémoire : autant de souvenirs doux et agréables dans les
mots-berceaux que de déchirures dans les mots-tortionnaires. Par
malheur, le plus souvent s’ouvrent des plaies mal cicatrisées, comme

sous un coup de couteau. C'est pour ça que je m'efforce de faire sortir le
Gamin du guêpier de sa langue.
Un seul mot à dix tranchants fait resurgir dix significations. Je l'ai
cruellement éprouvé ce matin même, me heurtant au mot « pavillon »,
que le Gamin utilise à plusieurs reprises pour parler d’un adulte qui
oublie son enfance. Instantanément, il a ravivé dans mon esprit l’image
de la maisonnette de ma grand-mère Iphigénie, entourée de son
vignoble, à l'ombre d'un verger parsemé de pêches blettes. Ce même
pavillon, comme la piqûre d’un frelon, m'a serré le cœur et rappelé les
oreilles ensanglantées de la pauvre chèvre Diana après le
bombardement décrit par le Gamin, ainsi que mon bateau faisant
naufrage en Nouvelle-Calédonie, le jour où j'ai baissé mon pavillon
devant ma belle Kanake. Ce même pavillon a fait réapparaître les
emblèmes de mon pays, qui ne l'est plus, le beau drapeau tricolore,
devenu rouge, puis blanc et enfin noir pour se mettre en berne.
Qu'importe ! La traduction reste pour moi le plus beau métier du
monde. Pareil à un architecte-constructeur de ponts, le traducteur nous
permet de traverser l'infranchissable, bien qu'une parole, pont entre les
hommes, se transforme quelquefois en un gouffre qui engloutit tout
irrémédiablement. La traduction, ce défi qui n’a pas de prix, on le paie
au prix fort, comme toute ouverture de la boîte de Pandore, bourrée des
dards du passé, de serpents, de guêpes et autres taons. Le plaisir le
plus vif de ce défi réside dans les phrases qui nous créent le plus de
difficultés et que l'on ne peut traduire, car l'esprit d'une langue se
manifeste à son plus haut degré dans ses mots intraduisibles.
Quant aux nids de frelons, guêpes et autres vipères, j’en trouve
abondamment dans mes dictionnaires, posés à même le sol, près de
Byzance, qui préfère appuyer sa longue barbe sur le Petit Larousse
plutôt que de se coucher dans son panier. Méfiante à mon égard, voire
même hostile lors de mon arrivée au chalet, elle s'est métamorphosée
depuis la mort de son maître et le départ de Mme Canac, surtout après
que je l’ai soignée quand elle a fait son hémorragie urinaire.
Ç’a été pour moi un moment dur, de loin plus dur que la mort de
M. Canac, ce petit matin brumeux où Byzance, accroupie sur le dernier
îlot de neige, a uriné du sang, un jet de sang cerise qui m’a rempli
d'épouvante, comme si c’étaient mes propres artères qui se vidaient,
reliées par des liens immatériels à celles de la chienne. De retour à la
maison, bien que je ne sois pas superstitieux, j'ai recouru à un « remède

» de ma grand-mère, qui, pour arrêter tout mauvais saignement,
attachait une clef au cou du malade. Quoiqu’un peu gêné, j'ai tout de
même attaché la clef du journal au collier de Byzance. Par bonheur, le
vétérinaire a déclaré qu’il ne s’agissait que d'un rhume. La chienne
l’avait probablement contracté sur le béton du garage, où elle était
restée couchée toute une matinée à me regarder réparer sans succès
le radiateur rouillé de notre limousine, à bout de souffle.
La note salée du vétérinaire est arrivée comme un cheveu sur la
soupe, à un moment où j’étais déjà dans des embarras gastriques et
financiers, à l’heure où mon compte bancaire se trouvait presque dans
le rouge, privé des versements mensuels de mon défunt maître. Sans
doute Mme Canac avait-elle fait une croix dessus, de même qu'elle avait
résilié notre abonnement à la télévision et au téléphone. Tant mieux : je
ne ferai plus ces rêves angoissants, provoqués par les images de
guerre, et je ne répondrai plus aux erreurs de numéro. Comme un
malheur ne vient jamais seul, outre ces soucis, qui ont persisté toute la
semaine dernière, Byzance et moi avons eu la visite inattendue du
patron de l'agence immobilière La Lavande, accompagné d'un couple de
Belges, acheteurs potentiels du chalet.
À mon grand soulagement, le prix exorbitant réclamé par Mme
Canac a vite refroidi l'ardeur de nos visiteurs. Le bruit du marteau du
patron de l'agence, fixant « À vendre » sur notre façade, a résonné à
mon oreille comme le son que rend un cercueil cloué.
_
Je suis conscient du risque que je cours et je ne crois pas que
Mme Canac y mette de la mauvaise grâce. Aussi, je ne songe pas à me
dérober à mes devoirs, ni à priver de mes soins attentifs ses
philodendrons ; j’envoie leurs photos à ma patronne tous les trois mois.
Suspendus dans la salle de séjour, devant la porte vitrée, juste en face
du Mont-Blanc, ils sont pleins de vie et ne cessent de grimper vers la
lumière, ressemblant à deux énormes pythons vert bouteille. Arrosés
deux fois par semaine l’été et une seule fois l’hiver, nourris
régulièrement d’engrais et rempotés une fois par an, ils se sont portés
comme des charmes jusqu'à la mi-mai.

Mais j’ai depuis remarqué quelques feuilles du bas de l'un de ces
reptiles séchées et décolorées. Je me suis empressé de les recouvrir
d'une fine couche de peinture vert foncé, trouvée dans le grenier. Ce
petit maquillage aidant, mes dernières photos ont repris du poil de la
bête. Malgré tous ces tracas, je suis un homme chanceux. Grâce à M.
Pétré, j'ai encore refait surface. Grand, les épaules carrées, les
moustaches roux carotte, deux fois veuf et des allures de bûcheron
joyeux, M. Pétré est propriétaire de l'Auberge du Roi. Je ne sais
comment il a deviné que Byzance et moi avions le ventre creux lors de
notre promenade quotidienne d'avant-hier. Probablement nous a-t-il vu
fouiller une poubelle derrière son chalet, une corbeille en osier où des
randonneurs avaient jeté le reste de leur casse-croûte. Nous y avons
trouvé la moitié d'un sandwich au fromage que nous partagions, lorsqu'il
nous a fait signe de nous approcher de sa terrasse, dont il était en train
de repeindre la clôture, en cette veille de saison estivale.
« Ras le bol, m'sieur Paul, m'a-t-il dit, ruisselant de sueur. Si vous
acheviez cette foutue clôture à ma place, vous auriez ce soir un repas
gratis chez Le Roi, une escalope de poulet à la crème et une carafe de
vin, vous et votre cabot.
- Relax, Max, ai-je répondu à sa manière, même si je ne m'appelle
pas Paul, ni lui Max. Merci, monsieur Pétré, bien que mon chien ne
boive du vin que très rarement. Quant à moi, je ne mange pas de
viande. »
En m'attablant, le soir, au fond de son restaurant, à côté de la
porte des toilettes, la barbe de Byzance posée sur mes pieds, j'ai senti
dans mon dos une douleur lancinante, conséquence de cette journée
passée à genoux. Au début de la soirée, mon pas rendu difficile par ma
jambe droite, est devenu carrément celui d'un vieillard décrépit. C’est à
croire qu'à partir de soixante ans nous vieillissons en accéléré, comme
dans les films muets, de même que les chiens et les enfants, sept ans
par an.
Le restaurant était désert. À cette époque de l’année, il n’y a pas
même un garçon de café. M. Pétré m'a servi lui-même une assiette de
légumes cuits et s’est s'assis en face de moi, sans demander mon
consentement. Trempant sa moustache rousse dans son verre de vin, il
m'a regardé manger sans un mot. Il a bu le même vin que moi ; il boit
toujours ce que boivent ses clients : un verre de pastis avec les gens
buvant du pastis, un petit blanc avec les hôtes qui commandent un petit
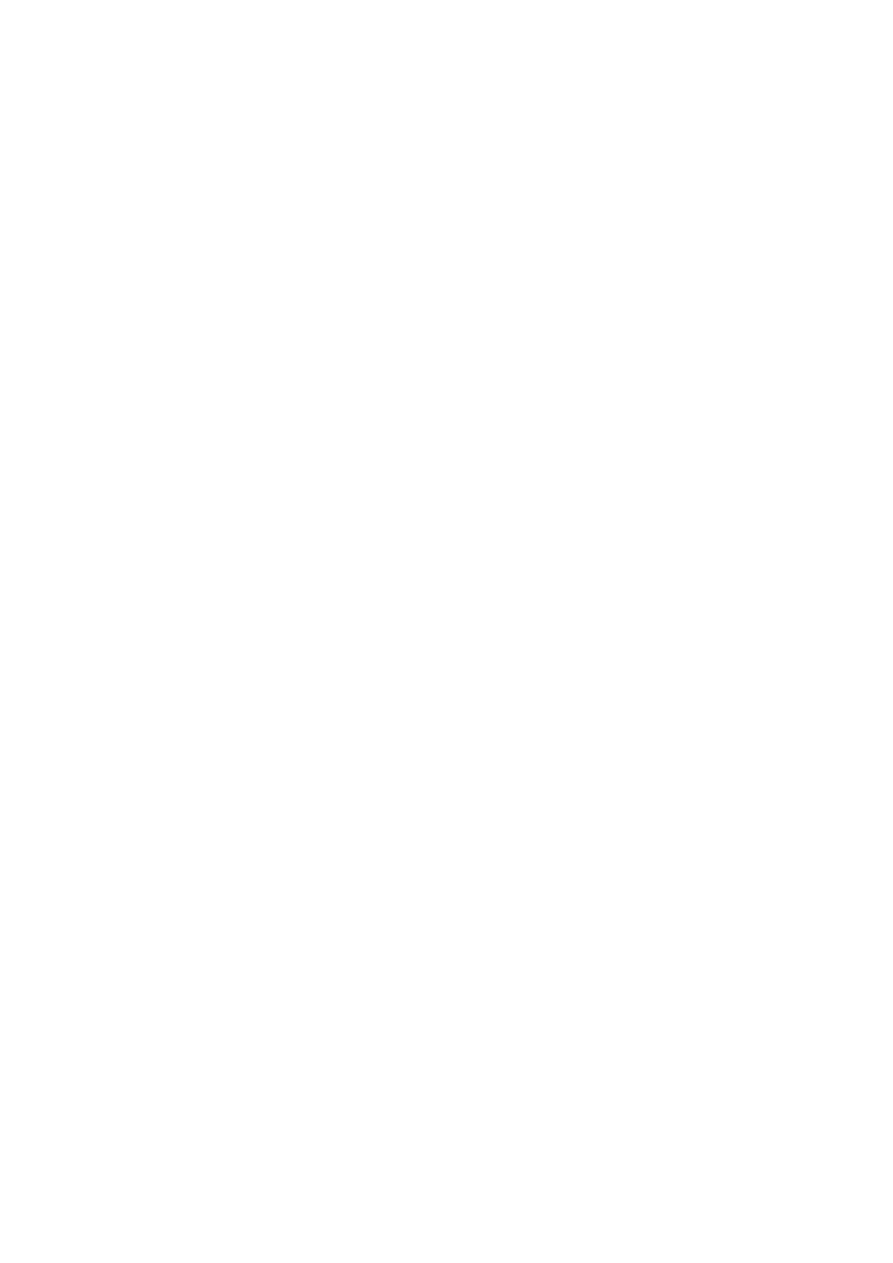
blanc, une bière avec les buveurs de bière. Il ne se soûle jamais, même
s'il boit en compagnie de trente-six clients en une seule journée.
Il ne s'était pas assis en face de moi par hasard. Il voulait «
parler affaire », comme il dit. « Parler affaire » signifiait s'occuper de
Jean, Pierre et Paul.
« J'en ai ras le bol, m'sieur Paul. Si vous acceptiez de vous
consacrer à mes trois vieux poneys une heure par jour, vous auriez
chez Le Roi votre assiette de légumes, une cuisse de poulet pour votre
chien et une carafe de vin tous les jours que Dieu fait. Au bout de vingt
ans de bons et loyaux services, mes braves Jean, Pierre et Paul
méritent d'être servis comme le pape pendant leur année sabbatique,
avant que... »
Là, M. Pétré s'est brusquement tu.
« Avant que...? ai-je demandé.
- Bientôt, m'a-t-il répondu, ou dans à peine quelques décennies,
nous serons aussi obligés de donner le coup de grâce à la plupart de
nos retraités. »
Aussitôt proposé, aussitôt accepté. En échange d'une escalope
quotidienne pour Byzance et d’une soupe de légumes pour moi, je
deviendrai une sorte de valet d'écurie de M. Pétré. Je m'occuperai de la
nourriture de ses poneys : de l'avoine concassée pour Jean et Pierre, et
de la farine de maïs pour Paul, qui a les dents gâtées. Je nettoierai leurs
stalles et leur litière, je les brosserai et peignerai, je prendrai soin de
leurs mangeoire et abreuvoir. Au printemps, avant leur départ pour
l'abattoir, je tresserai leur crinière et leur queue pour ce dernier voyage.
Quant au coup de grâce censé être administré aux petits vieux et
prophétisé par M. Pétré, il semblerait que je puisse m'attendre à le subir
bientôt moi aussi.
« Ras le bol, m'sieur Paul, me glisse M. Pétré, soudain assombri,
tendant l’oreille à des rires retentissant à l'extérieur. Cette marmaille
sotte, j'en ai plein les bottes ! »
Notre conversation est interrompue par l'irruption d'une poignée de
jeunes, quatre garçons et une fille, qui se précipitent vers la table de
billard. Le plus âgé, incontestablement le chef du groupe, un adolescent
d'environ seize ans, sort de sa veste en cuir une liasse de billets de cent
francs. Arborant une crinière teinte dans un jaune criard, il roule un
billet, le passe à la flamme d'une lampe à pétrole et s'en sert pour

allumer sa cigarette, salué en cela par les cris d'approbation de
l’assistance.
Il frappe d’un coup fort le bord de la table de jeu de sa batte de
base-ball.
« Cinq chopes de bibine ! » lance-t-il.
Murmurant un juron, M. Pétré se hâte de quitter ma table pour
regagner son comptoir et remplir de mousse les cinq grands verres à
anse. La table de billard est éclairée par un plafonnier vert, dont la
lumière froide donne au visage des jeunes l'air sournois et menaçant. Le
faux blond est entouré de deux babouins malpropres et mal peignés se
ressemblant comme deux gouttes d'eau, visiblement des jumeaux, du
plus jeune membre de cette insolite compagnie, un morveux d'à peine
neuf ans, et d'une fille pubère aux cheveux en broussaille, qui attire mon
attention plus que les garçons.
À ma grande surprise, je remarque que cette fille de douze ans
est enceinte au moment où, exhalant une méchante odeur de bière, elle
heurte du pied ma chaise pour disparaître dans les toilettes.
« Pardon, madame », dis-je confus.
De retour des toilettes, rejoignant le groupe de canailles qui
tapent dans les billes de billard avec leurs battes de base-ball, la fille
tend son bras vers moi et jette tout fort au faux blond :
« Il m'a traité de “madame” ! » se plaint-elle.
Le visage angulaire et écailleux d'un lézard, le dos voûté, penché
en avant comme s’il était un peu bossu ou comme s'il marchait contre
un vent violent, le faux blond se dirige vers moi, une grande chope
toujours pleine de bière à la main.
« C’est vrai que tu as traité mademoiselle ma petite sœur de putain
? me demande-t-il, en dégageant, lui aussi, une forte odeur d'alcool.
- Excusez-moi, monsieur, dis-je. Ce n'est pas vrai. J'ai dit à
mademoiselle : “Pardon, madame”.
- C'est bonnet blanc et blanc bonnet, rétorque-t-il en ricanant.
Toutes les dames sont des putains, madame, tadame et sadame. T'as
insulté une future mère. Quant au père de son enfant, je le tuerais
comme un chien si ce n'était moi. Tu dois être puni, pépé. T'as de la
chance de te trouver en face d'un homme charitable, qui va t'offrir le
choix de ton châtiment : ou tu avales cette bille de billard, ou bien tu
avales cette bière d'un seul trait.
- Je préfère la bière, monsieur, dis-je.

- O.K., pépé, tranche-t-il en crachant une salive glaireuse dans la
chope. Mon petit nom, c’est Molo. Et cette mousse s'appelle cocktail
Molotov, dit-il. Tu va te régaler... »
_
Je me réveille en sursaut, presque étouffé par mes vomissures.
Après mon retour de l’auberge, agenouillé devant la douche, j'ai vomi et
me suis endormi, la tête appuyée sur un socle carrelé. Quoique je sois
engourdi de froid, je me précipite sous une douche glaciale pour ôter
ces saletés des deux mondes, le réel et celui de mes cauchemars.
Un peu apaisé, je me prépare pour ma nuit de travail, la traduction
du journal du Gamin. Comme à l'accoutumée, j'endosse ma redingote
de sommelier, je mets mes gants blancs aux index troués et
raccommodés, je me prépare du thé et m'installe devant mon secrétaire.
Je suis réglé comme le papier à musique sur lequel j'écris. C'est le
moment pour Byzance de quitter son panier et de poser sa barbe sur le
Larousse illustré.
Je suis plus déterminé que jamais : j'arracherai le Gamin des
griffes de tous ses souvenirs, de l'étreinte périlleuse de sa langue. Car,
comme disait mon oncle : « Bien que la langue n'ait pas d'os, elle est
capable de les rompre. »
Allons de l'avant, mon Gamin !

LE LIVRE DE MA VIE
Sous le signe du Chien, 1946
L'été
C'est à ne pas y croire, je n'ai pas touché à mon journal depuis
presque dix mois !
Notre école a déménagé, nous avons quitté le grand entrepôt
délabré qui nous servait d'abri depuis la guerre pour emménager dans la
demeure du bon roi Pierre Ier. Notre directrice et nos trois institutrices
ont transformé la chambre à coucher et le salon du roi en bureaux et ont
aussi occupé sa salle de bains. Nos trois classes, celle de Tchaslav et
la mienne ainsi que celles de Radoch et de Zorko, se sont installées
dans la salle à manger, la salle de séjour et le grand vestibule. Mme
Karpov m'a dit que le bon roi Pierre aurait été très content s'il avait su
que les écoliers occuperaient sa maison après sa mort.

En quittant heureux notre entrepôt croulant, nous avions l'espoir
de rencontrer sous ce nouveau toit le spectre royal ou les fantômes de
ses serviteurs. Au rez-de-chaussée, entassés comme des harengs dans
notre classe, au lieu d'entendre les pas feutrés du roi au-dessus de nos
têtes, nous écoutons à longueur de journée le bruit de la chasse d'eau
et des bottes de la camarade Kovatch sur le carrelage de la salle de
bains ou sur le parquet du salon princier.
Le bilan de l'hiver et du printemps passés est plutôt mitigé. Inquiet
à cause de son père, toujours incarcéré, Tchaslav est devenu maigre
comme un clou. Contrairement à lui, Radoch a grossi. Mélancolique
sans raison apparente, bouffi, de plus en plus ventru et fessu, il grignote
sans répit des bonbons fourrés, de la nougatine et autres cacahouètes.
Oncle Edouard, pour se rendre seul chez nous dimanche dernier,
n’a pas pris le bon tramway et s'est égaré à l'autre bout de la ville. Puis,
hélant un taxi, il n'a pu se rappeler le nom de notre rue. Il a persisté à
demander au chauffeur de le déposer dans la Septième rue sur la
colline des Taupes. Par bonheur, le bonhomme au volant a réussi à
résoudre ce rébus : la Septième rue était la rue de Septembre, et la
colline des Taupes notre colline de Toptchider.
Peu ému de cette mésaventure, oncle Edouard a débarqué à la
maison avec une mystérieuse valise et une grande nouvelle : il finirait
dans un proche avenir dans notre garage-buanderie un
DÉDEBRUPASS, un détecteur de bruits du passé. Charmé par son
entreprise, je lui ai proposé mon modeste soutien et ai pu ainsi assister
à l'ouverture de son bagage, contenant un haut-parleur, un micro et un
ramassis de câbles, prises, roues dentées, pivots et ressorts.
« Je prouverai, m’a-t-il dit, j'établirai irréfutablement que des
ondes sonores se propagent autour de nous bien après la disparition de
leurs sources émettrices dans le passé, des ondes acoustiques émises,
il y a plusieurs siècles, par des civilisations disparues, les Grecs, les
Romains et d’autres grands ancêtres. C'est formidable, n'est-ce pas !
- C'est formidable », ai-je approuvé.
Nous rejoignant au milieu de sa tirade, papa et tante Milena ont
échangé un regard effrayé. Ma tante n'a guère apprécié le projet d'oncle
Edouard.
« Pour écouter les Grecs, a-t-elle lâché à voix basse, il s'est mis à
écouter mes conversations téléphoniques. »

Papa s'est raclé la gorge et empressé de nous annoncer une
grande nouvelle.
« Nous allons à la mer ! s'est-il exclamé. La semaine prochaine,
nous allons tous à la mer ! »
Un rayon de soleil éblouissant dans un ciel menaçant !
Dire que je verrai la mer et que j'apprendrai à nager ! Je n'arrive
pas à y croire ! Grâce à son patient influent, joueur de cartes, papa a pu
obtenir pour nous un séjour de deux semaines dans une maison de
repos au bord de la mer, à deux pas de Trieste et de la frontière
italienne ! Seule la pensée de Maminka, qui ne sera pas de la partie, a
gâté ma joie, une pensée qui m'a serré le cœur.
Dès le lendemain, nous avons entrepris les préparatifs pour ce
voyage. Oncle Edouard a abandonné temporairement la construction de
son DÉDEBRUPASS pour se consacrer à la réparation de vieux
accessoires de plage sortis de sa cave, un parasol, deux matelas
gonflables et une chaise-longue. Tante Milena a raccommodé leurs
maillots de bain en laine, rongés par les mites pendant la guerre -
preuve incontestable que ces insectes nuisibles ne dévorent pas
seulement les souvenirs.
Notre Loudmila a rempli trois boîtes à chaussures de joliettes et de
gâteaux secs. Papa m'a acheté une canne à pêche avec un double
hameçon et un maillot de bain en forme de culotte descendant jusqu'aux
genoux. Quant à moi, je me suis préparé consciencieusement à ma
première rencontre avec l'eau salée en déversant dans notre baignoire
une boîte du sel marin de notre Loudmila, qui n'a nullement apprécié
mes exercices et m'a tiré l'oreille.
Jour J, le matin de notre voyage. Je suis resté toute la nuit sur le
qui-vive. Derniers préparatifs. Notre Loudmila s'est levée à l'aube pour
aller acheter du pain frais et remplir un grand panier de nourriture.
Morceaux de deux poulets panés, œufs durs, fromage, tomates,
poivrons, fruits et boissons. Comme nous n’avions pas de places
réservées et que la foule de voyageurs était énorme, nous nous
sommes rendus à la gare deux heures avant le départ de notre train.
Papa et oncle Edouard sont allés jusqu’à un poste d'aiguillage situé au
bord de la Save, à deux kilomètres de la gare, où les employés des
chemins de fer raccordent habituellement les rames des wagons. Là où

la locomotive à vapeur s'arrête quelques instants, ils monteront
discrètement dans le train et occuperont un compartiment. Une fois
arrivés à la gare, ils ouvriront leur fenêtre et nous leur lancerons nos
bagages. Si nous échouons, nous passerons toute la journée et toute la
nuit dans le couloir, entassés comme des sardines.
Sur le quai des grandes lignes, tout autour de nous, c’est une
bousculade et un tumulte indescriptibles. Des enfants qui pleurent et
pissent dans leur culotte, des mères qui les giflent, des grand-mères qui
étouffent, des pères qui hurlent à tue-tête. Des gitans munis de violons
et de tambours étourdissants escortent l'un des leurs qui part pour le
service militaire ; un autre groupe de personnes avinées accompagne
deux jeunes mariés. Des peaux de pommes et de pastèques jonchent le
sol et l'odeur de transpiration prend à la gorge.
Notre train entre enfin en gare. Beaucoup de fenêtres sont déjà
occupées par des petits malins, des pères de famille, comme papa et
oncle Edouard. De même que tous les autres, ils se démènent en criant
et en brandissent un chapeau ou une casquette pour attirer l'attention de
leurs proches. La locomotive s'arrête en crachant un nuage de fumée
irritante. Comme tous ces gens déchaînés, tante Milena et notre
Loudmila lancent nos bagages par la fenêtre dans les bras de papa et
d'oncle Edouard, qui ne cesse de hurler : « La chaise-longue ! La
chaise-longue ! » On me lance en dernier, tel un vulgaire sac à dos.
Dans le compartiment, mon oncle prend le rôle de commandant de
bord. Il nous dénombre trois fois de suite pour s'assurer que personne
n’est resté sur le quai. Il constate que nous sommes un de trop, vu qu'il
a compté deux fois son épouse. Il fait aussi le compte exact de nos
paquets, onze en tout avec sa chaise-longue et la boîte à chapeaux de
tante Milena. Il nous presse de les glisser dans les filets à bagage et de
nous asseoir sur les banquettes avant que quelqu'un ne nous devance.
Alors que nous sommes en train de mettre ses ordres à exécution,
une famille de roux essoufflés et ruisselant de sueur fait irruption. Je n'ai
jamais vu une famille entière de rouquins et de rouquines : la grand-
mère et la mère sont rousses, le père roux, le fils aîné roux et la fille
cadette rousse. Les parents s'asseyent à côté de nous sans dire
bonjour, installent leur progéniture sur leurs genoux et ouvrent un
panier d'où saute un chat roux. Je me pince l'oreille, me demandant si
c’est un rêve couleur carotte.

Notre compartiment est conçu pour six voyageurs. Il y a sept
grandes personnes et trois enfants entassés sur les banquettes, une
bonne partie de leurs colis sur leurs genoux. Oncle Edouard, notre
commandant de bord, prend les choses en main et, bizarrement, tout le
monde lui obéit sans protester.
À son ordre, nous sortons tous nos sacs et valises des filets à
bagage pour les ranger à même le sol entre les banquettes. Ils se
transforment ainsi en une sorte de plate-forme de la hauteur des sièges,
sur laquelle oncle Edouard pose sa chaise-longue. Il s'y affale, tout en
dirigeant la suite des opérations : tous les enfants vont être installés
dans les filets à bagage, moi et la petite rousse tête contre tête, et son
grand frère dans le filet opposé.
Enchanté, j'observe le monde des grandes personnes à mes
pieds. Ma voisine, le visage couvert de taches de rousseur, arbore de
jolies nattes nouées au sommet de sa tête. Ses cheveux sentent l'herbe
fraîchement fauchée, l’odeur qu'exhale la petite chambre de notre
Loudmila. Subitement, transporté de joie, d'une joie inexplicable,
indicible, telle que je n'en avais pas éprouvé depuis des mois, je ressens
une douce secousse dans tout le corps : notre train démarre enfin.
Les cahots toujours plus forts et les sifflements joyeux de la
locomotive tirent les grandes personnes, en bas, de leur torpeur. Assis à
côté de la portière, le père de famille roux se lève, jette le chat dans les
bras de sa fille, ôte sa casquette en cuir et lance, souriant, un bonjour
radieux à ma famille. Papa et oncle Edouard lui répondent par un
bonjour tout aussi enjoué. C'est le signe pour leur grand-mère et notre
Loudmila d'ouvrir chacune son panier de nourriture et d'étaler leurs
gourmandises. Tour à tour, elles les offrent à leurs voisins : poulet pané
en échange de tranches de jambon fumé, œufs durs et fromage
échangés contre des boudins noirs et des oignons nouveaux.
J'écarquille les yeux : tante Milena, qui depuis toujours déteste le
boudin noir et les oignons crus, les trempe dans le sel et les croque à
belles dents, et papa, qui n'a jamais avalé une seule goutte d'alcool, boit
l'eau de vie de notre ami rouquin à même la bouteille. Oncle Edouard le
surpasse, buvant à la régalade. Notre train, dans un grondement,
traverse le pont-rail qui enjambe la Save et s'engage dans le silence des
champs de maïs. Ballotté, je glisse dans le filet, et le sommet de ma tête
touche les nattes de ma voisine. Je respire, les yeux fermés, l’odeur de
la pomme qu'elle est en train de manger, et mon corps tout entier est

inondé par une nouvelle vague de bonheur, comme si mon âme
possédait enfin quelque chose qu'elle avait désiré depuis toujours.
Nous dormons, mangeons et dormons. À l'aube, un énorme bruit me
tire de mon sommeil. Je sursaute dans mon filet et me cogne la tête
contre le plafond dans une totale obscurité, prêt à dégringoler sur les
grandes personnes endormies sur les banquettes. C’est alors que notre
train sort d'un tunnel pour déboucher dans le brouillard silencieux du
petit matin.
Je suis le seul à être éveillé, les têtes des grandes personnes
branlent sur leurs dossiers, pareilles à des marionnettes hirsutes.
Penché vers la fenêtre, je suis le premier, le seul à voir la mer. D'un bleu
nacré, elle a l'air d'un ciel inférieur, d'un ciel d'en bas. Je ne suis ni
surpris ni ému, malgré cette majesté somnolant sous un voile de brume
légère. J’éprouve une paix étrange devant cette beauté menaçante,
comme si j'avais déjà eu l’occasion de la voir. Elle ne me fait nullement
peur, en dépit de son immensité, car je sens que la fin de sa grandeur
sans fin se trouve en moi-même.
Oncle Edouard m'a dit une fois que la mer avait engendré tous les
êtres vivants, et il avait raison, comme d'habitude. La mer est comme la
mère et je comprends enfin pourquoi la langue française les désigne
par les mêmes sons. C'est pour cette raison que ce tête-à-tête avec la
mer m’a paru être une seconde naissance.
Une heure plus tard, je sors de notre bungalow et je traverse une
petite plage de sable qui nous sépare de l'eau. Les lambeaux de brume
ont fondu comme neige au soleil. Oncle Edouard m'a devancé. Assis au
bord de sa chaise-longue, les jambes de son pantalon retroussées, les
pieds dans l'eau, il observe le monde aquatique, de minuscules
poissons, crabes et algues tremblantes. Je m'assieds près de lui et
trempe aussi mes pieds dans l'eau claire comme le cristal, brûlant
d'envie de la goûter.
« Vas-y, mon Louveteau, me dit oncle Edouard dans un sourire,
comme s'il avait deviné mes pensées. Elle est propre comme un sou
neuf, poursuit-il en m'observant laper un peu d'eau dans le creux de ma
main. Elle n'a jamais été si limpide, dit-il dans un soupir, purifiée, comme
toujours après une grande guerre. Pendant que les hommes s'entre-
tuent, mère Nature en profite pour se débarrasser de leurs saletés. »

Tante Milena et papa nous rejoignent sur la plage. Ils portent de
drôles de maillots de bain faits d’une laine épaisse. C'est la première
fois que je vois leurs jambes nues et elles me font rire. Papa a de
courtes jambes arquées et poilues. Tante Milena a des jambes grêles à
la peau plissée. Elle est coiffée d'un énorme chapeau de paille et se
protège encore du soleil en s’asseyant sous un parasol et en enfilant
des lunettes noires.
Les yeux pétillants, papa s'exclame subitement :
« L'heure est venue d'apprendre à Marie-Loup à nager ! »
C’est le calme plat, dans notre crique, la mer est d'huile. Bras
dessus, bras dessous, traînant nos pieds sur le fond sablonneux, nous
nous engageons dans l'eau jusqu'à la poitrine. Il va m'apprendre la
brasse, à nager sur le ventre. Mais, avant tout, il faut que j'apprenne à
me maintenir à la surface par des mouvements appropriés. La technique
de la brasse, je la connais par cœur. La semaine dernière, en l’absence
de notre Loudmila, je me suis entraîné, à plat ventre sur la table de la
cuisine, en suivant au pied de la lettre les instructions de Zorko,
excellent nageur : « Tu réunis tes mains sous ton menton, les coudes
près du corps, les jambes repliées, puis tu tends les bras loin en avant
et tu donnes des coups de pied à droite et à gauche... » Mais, dans
l'eau, tout est différent, l'eau vous enveloppe sournoisement de partout,
comme si elle voulait vous attirer dans le piège de ses profondeurs.
Plus mort que vif, je me couche sur les bras de papa et porte mes
deux mains en avant. Simultanément, je fais travailler mes jambes, je
donne de puissants coups de pied.
Aveuglé par l'eau salée, j'entends les cris d'oncle Edouard :
« Il nage comme un poisson, Louveteau ! Formidable, n'est-ce pas
! »
Ravi, lui aussi, papa écarte les bras. J'avale une grande gorgée
d'eau et je commence à couler. Heureusement, ma jambe gauche, celle
qui est plus longue que l'autre, touche le fond. Je pousse dessus, tout
en agitant les bras comme une grenouille. Dans l'écume qui m'entoure,
personne ne voit ma jambe appuyée sur le fond. Et je feins de nager,
heureux comme un roi au septième ciel, je nage, je nage dans mon ciel
terrestre.
« Bravo, mon Louveteau ! Je viens te rejoindre ! s'écrie oncle
Edouard et il se jette à l'eau en oubliant d'enlever son pantalon.
- Ton maillot, Edouard ! » crie tante Milena.

Trop tard. Oncle Edouard va nous démontrer que, lorsqu’il
évoquait la valeur sportive de sa jeunesse ce n'était pas pure
vantardise. D'après lui, avant la Première Guerre, il fut champion de son
école en dos crawlé, ce qu'il nous prouve à présent, en gagnant le large
tel un moulin à vent flottant.
« Edouard, Edouard ! crie tante Milena. Prends garde aux requins !
»
Mon oncle, crawlant sur le dos, n'entend rien. Il va s'éloigner de
plus en plus et disparaître derrière les rochers, au-delà de notre crique.
Il ne reviendra que tard dans l'après-midi, dans la barque d'un pêcheur
qui l'a trouvé échoué sur un banc de sable dans la baie voisine,
engourdi par le froid et incapable de lui indiquer d'où il était parti.
« D'une maison indienne », lui a expliqué mon oncle, dont les
idées embrouillées lui faisaient croire que notre bungalow était situé
quelque part en Extrême-Orient.
Ainsi, le même jour, j'ai appris à faire semblant de nager et deviné
quelle était la curieuse maladie d'oncle Edouard. Le soir, en sortant sur
la plage après dîner, je l'ai retrouvé assis dans sa chaise-longue, au
bord de l'eau, emmitouflé dans une couverture. Ses yeux d'aigle erraient
sur la mer ridée, le long d'une merveilleuse épée argentée que dessinait
la lune.
« Berceau de tout ce qui est vivant, m'a-t-il dit. Plaine liquide.
Empire d’ondes capiteuses. Un beau jour, je le traverserai d'un bout à
l'autre en dos crawlé.
- Je vous suivrai, mon oncle, à la brasse », ai-je dit.
En guise de réponse et avec un sourire approbateur, il a jeté un
bout de sa couverture par-dessus mon épaule et m'a serré contre lui. Ce
soir, oncle Edouard est devenu mon meilleur ami.
« Les rêves ne devraient pas avoir d'âge, m'a-t-il glissé à l'oreille
d'un ton complice. Ah ! comme j'envie ta jeunesse, mon cher Louveteau,
ce royaume de liberté où tous les songes sont permis et leur
accomplissement toujours à portée de la main. Ah ! comme j'aimerais y
retourner.
- Qu'est-ce que l'accomplissement d'un rêve, mon oncle ?
- Rester un éternel enfant. »
J'ai aussitôt décidé de rester un éternel enfant comme mon oncle
Edouard. Ainsi, tous les rêves seront à portée de ma main. Éternel
enfant, je deviendrai écrivain, ça va de soi. J'inventerai et décrirai des

mondes qui n'existent pas et leurs habitants imaginaires, de nouveaux
mondes meilleurs où les Maminka ne pourront jamais mourir ni faire de
leurs petits des orphelins.
Et, le jour où je prendrai mon courage à deux mains pour relire
mon journal, je m'en servirai pour écrire un livre sur notre colline de
Toptchider et ses malheureux garçons, dont les rêves n'étaient pas à
portée de la main. J'ai déjà le titre : Le Livre de ma vie. J'ai déjà les
personnages principaux : oncle Edouard, qui retombe en enfance, et
quatre garçons, les quatre mousquetaires, Tchaslav, Radoch, Zorko et
moi, qui vieillissons sept ans par an, à la manière des chiens.
Le jour de notre retour, la rue de Septembre paraît plus que
jamais somnoler. Rien n’a changé, tout est immobile, comme si j’avais
rêvé mon voyage, les deux semaines passées au bord de la mer. En
entendant les abeilles bourdonner dans la vigne vierge, dont les feuilles
sont déjà bordées d'or, je me demande où commence et où finit le rêve.
Nulle trace de mes amis. Un mot suspendu au cou du mannequin
noir de la vitrine de l'épicerie de M. Samar annonce sa fermeture
annuelle. Couvert d'une fine couche de farine, le Noir aussi est
immobile. Sans doute Maya est-elle partie avec son père passer ses
vacances à la campagne, chez sa grand-mère.
Soudain triste et accablé par cette solitude presque insupportable,
j'ai l'heureuse idée de fouiller notre cache, dont nous ne nous sommes
pas servis depuis toute une année. Tchaslav avait arraché une brique
au pied d’un mur mitoyen à l’aide de son canif, puis creusé un trou où
nous avions déposé une boîte de sardines enveloppée d’une toile cirée,
avant de remettre la brique en place : c’est notre boîte aux lettres, nous
y cachons les messages importants.
Après m'être assuré qu'il n'y avait personne aux alentours, je retire
la brique du mur. La boîte de sardine est bien là, puant comme une
punaise, mais son précieux contenu me fait oublier sa mauvaise odeur :
un bout de papier enroulé, écrit de la main de Radoch, un mot qui me
transporte de joie.
Mardi, 13. Midi.
Partis sur les radeaux des Six Peupliers. R. T. Z.
Je repasse par la maison en toute hâte pour prendre mon maillot
de bain et je me précipite vers la Save. Malheureusement, je ne peux

enlever mes souliers orthopédiques, qui me brûlent les pieds. Moi, le
canard boiteux, je ne peux marcher pieds nus comme les autres
enfants. En passant devant les peupliers, je les compte une fois de plus
- je n'arrive pas à m'en empêcher - et je constate de nouveau que le
nom de la station de tramway n'est pas justifié. Ils sont dix, majestueux,
mais fatigués par la chaleur estivale, las de rester debout et d'attendre
en vain les premières pluies d'automne.
Un bruit de pas attire mon attention : c'est une colonne
d’Allemands, prisonniers de guerre, qui rentrent d'un chantier de
construction. Je les regarde à la dérobée, collé contre un peuplier. La
tête rasée, le visage décharné et terreux, tout de gris vêtus, ils
marchent d’un pas lent, péniblement, n’ayant plus rien à voir avec les
impitoyables guerriers volants qui avaient bombardé notre ville. Les
yeux baissés, le regard fuyant, leurs gourdes cliquetant à leur ceinture,
ils traînent leurs pieds comme pris dans des entraves invisibles.
Il me font pitié, m’attendrissent subitement, surtout le dernier de la
colonne, un petit maigre sans âge, glabre, boiteux. C’est le seul à lever
son regard vers moi, un regard bleu et pétillant. Stupéfait, je le vois me
faire un clin d'œil, un de ces clins d’œil que seuls de vrais copains
peuvent échanger. Je lui rends la pareille en souriant. Puis nous nous
séparons pour toujours, boitant tous les deux et, tout à coup,
joyeusement complices.
Il a suffi d’un simple clin d'œil pour que nous nous pardonnions
tout ce que s'était passé pendant et après la guerre. Je lui ai pardonné
de nous avoir sauvagement bombardés, d'avoir détruit la moitié de notre
ville, et il m'a pardonné de l'avoir emprisonné, enchaîné et affamé. Ainsi,
je me suis fait un ami dont j'ignore le nom et que je ne reverrai jamais,
mais qui restera mon frère de peine.
Du printemps à l'automne, des milliers de troncs d'arbres flottent
le long de la rive droite de notre Save, maintenus par des cordes de fer.
Armés de longues perches à crochets, de vieux loups de rivière
conduisent ces radeaux, appelés trains de flottage. C'est sur ces
radeaux, d'avril à mi-septembre, que les enfants de notre Colline se
mesurent entre eux au nombre de baignades. Sautant d'un tronc à
l'autre, les plus courageux atteignent parfois le milieu de la rivière, où
l'eau verdâtre forme souvent de gros remous.

Clopinant et les jambes mal assurées sur la terre ferme, je n’ai
jamais osé un tel exploit, marcher sur ces troncs qui se cabrent et
bondissent dans l'eau comme des crocodiles. Je me contente de rester
en compagnie de Maya et de Marina sur un banc de sable, de regarder
les garçons sauter de tronc en tronc pour se jeter dans l'eau avec des
cris de joie.
J'ai appris à nager, j'ai un maillot de bain dernier cri, je ne traînerai
plus sur la rive avec les filles. Pour une fois, je ferai un plongeon, je
piquerai une tête et je montrerai à Tchaslav, à Maya et aux autres
comment je maîtrise la brasse. S’il en est besoin, je me servirai un peu
de ma jambe gauche pour m’appuyer sur le fond ; personne n'en verra
rien, la Save est moins limpide que la mer.
À l'exception de Maya, ils sont tous là, Tchaslav, Radoch et Zorko.
Ils poussent des hourras et admirent mon maillot de bain, confectionné
à Paris et orné de menues tours Eiffel multicolores. Je suis le seul à
avoir un vrai maillot de bain ; celui de Radoch, au couleurs de l’arc-en-
ciel, un cadeau de son frère dans lequel il s'était pavané l'année passée,
est devenu trop petit pour notre camarade ventru. À l’égal de Tchaslav
et de Zorko, cette année Radoch porte un simple caleçon à jambes
courtes.
Je les trouve très beaux, mes amis, brunis par le soleil, pareils à
des statues de bronze, les muscles couverts de gouttelettes luisantes et
les cheveux en bataille. Même Radoch me paraît beau, quoiqu'il ait
beaucoup grossi en quinze jours. Leurs yeux sont rouges, ils ont encore
plongé dans la rivière en les gardant ouverts. Ils me racontent qu’il ont
vu un énorme poisson-chat près des radeaux, un silure moustachu
aussi gros que Radoch. Ils se démènent et rient à qui mieux mieux,
écartant autant que faire se peut les bras pour me montrer la taille de ce
monstre aquatique :
« Comme ça ! Comme ça ! Comme ça !... »
Je me change pudiquement derrière un rocher et m'engage dans
l'eau à l'endroit où la pente d'un banc de sable m'assure une descente
aisée. Pendant ce temps, je me répète : « Tu réunis tes mains sous ton
menton... jambes repliées... tu tends les bras loin en avant... » Le
courant est plus fort que prévu et me fait chanceler. Lorsque je suis
enfin dans l'eau jusqu’à la taille, je plonge, je me lance...
J'entends les cris de joie de mes amis sur la rive :
« Bravo, Mio ! Bravo, vieux ! »

Je tends les bras, je donne des coups de pied.
« Bravo, champion ! »
Ma jambe gauche appuyant sur le fond, j'avance contre le courant.
Une petite vague qui heurte un radeau vire vers moi. Elle me gifle et me
fait avaler une gorgée d'eau. Au même moment, ma jambe gauche bat
dans le vide, elle ne touche plus le fond. Le sol s'est soudain dérobé
sous moi. Transi de peur, j'agite très fort les pieds plusieurs fois sans
parvenir à atteindre le fond. J'ai beau agiter les bras : je vois la rive
s'éloigner. Mes amis se trouvent toujours au bord de l'eau, à une
vingtaine de mètres, mais leur attention est attirée par autre chose.
Brandissant leur casquette, ils saluent le passage d'un beau bateau.
Emporté par le courant, je commence à couler, seuls mes yeux
restent en surface. Je sais que tout est fini : lorsque mes camarades
tourneront leur regard vers moi, j’aurai disparu à jamais, englouti par les
flots.
Avec ce vide sous moi et ce vide en moi, je n'ai plus eu peur. La
tête vide aussi, je me suis laissé sombrer dans le trou. Quand ma jambe
gauche a touché le sol du salut, je suis resté indifférent, comme détaché
de la vie. Je savais que le Bon Dieu n'avait pas voulu de moi. Je ne lui ai
pas dit merci. Je n'ai pas crié victoire. De retour du néant, j'en ai
rapporté un bout. C'est comme une maladie qu’on attrape quand
quelqu'un vous souffle son mal mortel en pleine figure. Elle s'installe en
vous, vous ronge et ne vous quitte plus.
Ces trois secondes entre la vie et la mort me semblent maintenant
avoir duré toute une éternité. Elles m'ont fait vieillir de vingt ans en une
fraction de seconde. J'aimerais décrire la mort. Elle ressemble à la
photo de ma grand-mère paternelle, que je n'ai pas connue, puisqu’elle
est morte bien avant ma naissance, aussi me paraît-elle morte depuis
toujours. Parfois, j’observe de longues minutes sa photo, accrochée à
côté de la bibliothèque de papa. Gris pâle, un gris un peu flou, une
grande bouche édentée comme celle d'une grenouille, elle vous souffle
au visage son sourire blafard.
C'est avec l'image de ce sourire vide que je suis revenu à la vie.
Je n'arrive plus à m'en débarrasser, pareil à la pomme qui ne peut
chasser le ver rampant dans sa chair. C'est drôle et curieux : même
respirant la santé et ayant toute la vie devant soi, on porte ce petit vide
comme un fruit doux renferme son noyau amer.

Chose étrange, le soir même de ma noyade, une fois couché, la
glande de mon cou, celle que j'ai héritée de Maminka, s’est mise à
sécréter sa goutte visqueuse insipide et inodore. C'est bien curieux. Est-
ce un signe de Maminka pour saluer mon retour ? Elle, qui m'a
abandonné en choisissant la mort. J'aimerais comprendre la mort. Dans
l'étreinte fatale du courant de la Save, elle m’a semblé très proche de la
vie, une voisine. Notre Radoch répète souvent les paroles d'un sage
découvert dans à son mur ouest, d’un épigone occidental du grand
Confucius : « Toi qui ne comprends pas la vie, comment comprendrais-
tu la mort. »
Je crois que la vie est plus difficile à comprendre.
L'automne
Quand je pense que papa m'a offert un chien ! À vrai dire, c'est
plutôt à Tchaslav que je dois Blacky, c'est lui qui l'a trouvé dans le
terrain vague, au bout de notre rue. Abandonné par sa mère et ses
maîtres, maigre comme un manche à balai, Blacky errait là à la
recherche de nourriture. C’est un labrador noir d’à peine trois ou quatre
mois, mâtiné d'une autre race. Noir comme du jais, il a une tache
blanche sur la poitrine en forme d'étoile.
Après l'avoir emmené dans sa cave, notre quartier général,
Tchaslav nous a convoqués d'urgence en utilisant comme à
l’accoutumée trois sonneries de téléphone.
Une demi-heure plus tard, nous voilà tous dans sa cave. Nous
déplaçons la grande armoire et nous nous installons dans la grotte-abri
antiaérien. Blacky a déjà avalé le goûter de Tchaslav, tout un sandwich
au fromage et au salami. Visiblement très content, il se roule par terre
en attendant des caresses.
Radoch ouvre la séance, une cigarette bulgare qu’il n’a pas
allumée au coin de sa bouche.
Ordre du jour : comment sauver le chien errant.
Tchaslav insiste d'emblée :
« Blacky doit être adopté.
- Comment sais-tu qu'il s'appelle Blacky ? demande Radoch.
- C'est moi qui l'ai baptisé, explique Tchaslav.

- Votons ! propose Radoch. Que ceux qui son pour ce nom lèvent
la main. »
Nous levons tous la main. Le nom de Blacky est approuvé à
l'unanimité. Zorko, les poches toujours pleines de choses utiles, offre au
chien un morceau de sucre. Pourtant, l'adoption de Blacky n'ira pas
comme sur des roulettes. Tchaslav ne peut le garder chez lui, sa grand-
mère est allergique aux poils de chien. Radoch ne peut pas non plus,
son chat est méchant. Zorko doit aussi refuser : sa mère a une peur
maladive des chiens.
Il ne reste plus que moi. D’après ce que je sais, mon père et notre
Loudmila ne sont pas allergiques aux chiens et n'en ont pas une peur
maladive. Nous disposons d'un beau jardin, où Blacky pourrait s'en
donner à cœur joie. De surcroît, étant végétarien, j'aurais le droit de lui
céder mon morceau de viande.
Avant notre arrivée, Tchaslav a déjà bricolé un collier et une
laisse. Je rentre à la maison avec Blacky. N’ayant pas l’habitude de la
laisse, il s’empêtre dans mes jambes et trébuche, embarrassé comme
une poule qui a couvé un canard. Mais, dès que je le détache dans
notre arrière-cour, il se transforme en formidable coureur, un vrai
coureur de haies. Pris d’une joie débordante, il bondit, se met à
gambader et s'élance enfin par-dessus notre potager.
Je suis émerveillé, mais ce n'est pas le cas de notre Loudmila, qui
butte ses pommes de terre. Elle sourcille et bougonne devant la gaieté
et l'entrain de Blacky.
« C’est une joie de trois jours, dit-elle. Un animal n'est pas un
joujou. Il faut s'en occuper, il faut le nourrir, le toiletter, nettoyer derrière
lui, le promener. Je n’ai pas de temps à y consacrer, j’ai déjà assez à
faire.
- Loulou, lui dis-je. - Quand j’essaie de l'amadouer, je l'appelle “ma
Loulou”. - C'est moi qui m'en occuperai, ma Loulou. Je le nourrirai,
toiletterai et tout le reste.
- Ce ne sont que de belles paroles, marmonne-t-elle.
- Parole d'honneur, dis-je.
- Les belles paroles ne mettent pas de beurre dans les épinards »,
conclut-elle, inflexible.
Mon Blacky pousse soudain un grondement sourd en faisant le
gros dos. Je m'empresse de l'attacher : quelqu'un est en train d'entrer

dans notre cour. Un bruit de pas précède l'arrivée de papa, suivi d'oncle
Edouard et de tante Milena.
« C'est papa, dis-je à Blacky en le détachant. C'est ma tante
Milena et mon oncle Edouard. Sois gentil, sois sage. C'est Blacky, dis-je
à papa. Notre chien de garde. »
La queue entre les jambes, notre chien de garde se prosterne
devant ma famille et se fait tout petit.
Touché par ce geste, papa toussote et échange un sourire
hésitant avec oncle Edouard. Celui-ci hoche la tête. Le gorge nouée,
j'observe papa, qui hésite toujours avant de s'accroupir brusquement
devant Blacky.
« Sois le bienvenu chez nous, chien-chien », dit-il.
Miracle ! Comme s'il avait compris ses paroles, Blacky lui fait la
fête. Il lèche sa main, mordille le pan de sa veste, jappe avec joie, tout
haletant, et se met à courir tel un lièvre autour de nous, sautant par-
dessus les groseilliers de notre Loudmila, qui ne sourcille plus et
commence à sourire elle aussi.
Ainsi, Blacky a fait entrer le sourire dans notre maison.
Papa et oncle Edouard, qu’accompagne tante Milena, sont
revenus bredouilles de leur pêche dominicale. Non seulement ils n'ont
rien attrapé, mais en plus oncle Edouard a perdu sa canne à pêche,
emportée par le fort courant de la rivière de Toptchider. Ce n’est pas la
fin de ses infortunes de ce jour : terminant sa course folle et prenant
ses bottes en caoutchouc pour un tronc d'arbre, Blacky s'arrête près de
lui, lève la patte et se soulage contre sa jambe.
Nous éclatons de rire, tout le monde rit aux larmes, sauf oncle
Edouard, qui n'a rien vu ni rien compris.
Ainsi, Blacky a fait entrer le rire dans notre maison.
Ses yeux d'aigle perdus dans le ciel, mon oncle nous cite la
pensée d'un sage, certainement chinois.
« Si tu cherches un véritable ami, oublie la gent humaine et trouve-
toi plutôt un chien, seul être à ne jamais mentir en amour. Il est
tellement fidèle qu'on peut se demander si les hommes méritent un tel
attachement.
- C'est vrai, dis-je. Si vous étiez en train de vous noyer, votre chien
ne regarderait pas ailleurs. Il vous sauverait de l'eau profonde.
- Quelle idée morbide, marmonne papa.

- Quelle métaphore ! s'enflamme oncle Edouard. Quelle image
sublime ! Félicitations, mon cher Louveteau. Quand on se noie dans un
verre d'eau, souvent vos amis vous tournent le dos.
- Ne parle pas comme ça devant un enfant, proteste papa à mi-
voix en français.
- Je ne suis plus un enfant », dis-je moi aussi en français.
Comme l’autre fois, quand je me suis exprimé en français, papa
reste bouche bée, ainsi que tante Milena. Oncle Edouard, en revanche,
ne réagit pas.
« Enfants, Arnolphe et moi avions un braque français, poursuit-il. Il
est mort de sa belle mort à l'âge de quinze ans. Pour ce qui est de
l'odorat et de l'ouïe, les chiens sont de loin supérieurs aux hommes. Ils
sont capables de sentir ce que nous ne sentons pas, d'entendre ce que
nous n'entendons guère et, parfois, de voir ce qui pour nous est
invisible, mais ils ont un triste talon d'Achille, leur pauvre longévité. Par
rapport à l'homme, un chien vieillit sept ans par an. À treize ans, il en a
donc quatre-vingt-onze. Avoir un chien veut dire se préparer à sa perte.
Aimer un chien veut dire se préparer à vivre un deuil. Adorer un chien
veut dire se préparer à subir une très grande douleur. »
Mon menton commence à trembloter, signe que je risque de
fondre en larmes. Je me retiens et dis d'une voix ferme :
« Blacky et moi vieillirons ensemble, sept ans par an. »
Les grandes personnes me regardent comme tombées des nues.
Une fois de plus, ils n'ont rien compris.
J’ai commencé le même soir à m'occuper de Blacky. Je lui ai
fabriqué une niche dans notre buanderie : j'ai renversé un grand
tonneau vide et y ai mis une vieille couverture. Il a apprécié la polenta à
la poitrine fumée de notre Loudmila, beaucoup plus que la brosse et le
D.D.T. qu'on m'avait donnés pour l'épucer. Il a longtemps hésité avant
d’entrer dans sa nouvelle niche, reniflant les douves du tonneau sentant
le vin aigre, mais, une fois à l'intérieur, il a dormi comme une souche,
épuisé par les événements de cette longue journée.
Je n'avais jamais vu un chien rêver. Ébahi, je l'ai regardé remuer
les pattes comme s'il pourchassait du gibier et l'ai écouté glapir dans
son sommeil. Un beau rêve ou un cauchemar ? Je n'en sais rien. Oncle
Edouard prétend qu'ils sont capables de sentir, d'entendre et même de
voir des choses que les hommes ignorent. J'aimerais lui apprendre la

langue française, et moi j'apprendrai la sienne, pour qu'il me raconte le
monde invisible qui nous entoure.
On dit que les chiens sont muets. Je ne crois pas que ce soit vrai.
En observant Blacky, je me suis rendu compte que son silence en disait
parfois plus long que toute une phrase. Par ailleurs, même dans notre
langue, le silence en dit souvent plus long que la plus longue des
paroles. En devenant écrivain un jour, je m’efforcerai d'écrire de
nombreux silences entre mes mots et je ferai de Blacky le personnage
principal du Livre de ma vie.
Mais d’abord il m'aidera à résoudre certaines énigmes qui me
hantent et me rongent. Quelquefois, surtout le soir avant de plonger
dans le sommeil, j'ai l'impression que Maminka est près de moi. J’ai du
mal à décrire sa présence dans la pénombre du plafond ou derrière les
vitres de ma fenêtre, car elle n'apparaît ni comme être vivant ni comme
fantôme. Elle est là, un point c'est tout. Elle est là, comme sortie de moi-
même. Elle n'a pas de corps, rien qu'un sourire qui me parle en
chuchotant, rien qu'un regard qui me caresse. Je parie que Blacky
pourrait la voir. Le seul problème, c'est que Blacky n'a pas le droit
d'entrer dans la maison et encore moins dans ma chambre.
Mon chien est un magicien. À côté de lui, tout s'anime et devient
vivant, même ce qui est sans vie. Souvent, sans raison apparente, il
s'immobilise devant une pierre, un arbre ou une plante. On dirait qu'il a
vu quelque chose ou entendu un bruit, un mot, pour moi inaudible. Assis
sur ses pattes de derrière, il penche la tête à droite et dresse les
oreilles. Il écoute et voit l'invisible. Près de lui, je devine que jadis nous
étions une grande famille de frères et de sœurs - plantes, animaux et
humains -, avant de nous séparer et de perdre le souvenir de notre
langue commune.
L’instant d’après, Blacky a l'air d'avoir tout oublié. Il se lance dans
de nouveaux jeux, de nouvelles espiègleries et fait même une bêtise,
comme le jour où il s’est amusé à mâchouiller les pantoufles de notre
Loudmila. En un mot, il ressemble à s'y méprendre à Douchann, le
jeune frère de Zorko, qui bave et balbutie au lieu de parler, mais qui est
capable sans se tromper d'élever au carré un nombre à sept chiffres. Il
ressemble aussi à oncle Edouard, qui a oublié son voyage en Chine,
mais qui se souvient parfaitement de ses jouets d'enfant.
Près de Blacky, j'observe l'automne d'un œil nouveau, comme si
je ne l'avais jamais vu. L'essaim d'abeilles de notre vigne vierge ne

bourdonne plus : il chante une vieille berceuse pour m'endormir quand
je lis le dimanche dans mon hamac, tendu entre le cerisier et la clôture.
Feignant de dormir, les yeux mi-clos, je lorgne par-dessus un livre posé
sur ma poitrine et guette les esprits incorporels qui fourmillent dans
notre jardin. Contrairement à moi, Blacky peut les voir. Au pied de mon
hamac, il ne dort que d'un œil, prêt à nous défendre contre un danger
imaginaire, car pour lui, comme pour le commun des chiens, l'imaginaire
est plus réel que le réel.
Le museau entre deux touffes d'herbe, aplati comme une crêpe, il
est capable de rester des heures sans remuer un cil, mais son
immobilité est trompeuse. Il suffit que je saute de mon hamac pour qu'il
bondisse, comme piqué par une guêpe, pour qu'il se renverse aussitôt
sur le dos, pattes écartées, s’offrant à mes jeux et à mes caresses. Je
me couche à côté de lui, je le dorlote, le pétris et le chatouille, avec les
mêmes paroles élogieuses : « Blacky est le plus beau chien de la
Colline, le plus sage, le plus courageux de tous les toutous... » Ces
louanges, je les prononce bien entendu en français, car je tiens à ce
qu'il apprenne cette langue avant notre premier voyage en France,
puisque papa et oncle Edouard m'ont promis de m'emmener à Lyon,
leur ville natale, pour que je goûte aux vraies pommes de terre à la
lyonnaise.
Mes camarades de classe m'envient d'avoir Blacky, qui m'attend
toute la matinée à la lisière d'un jardin public, en face de l'école. Bien
qu'il ne soit pas attaché, il ne bouge pas de l’endroit où je l’ai laissé le
matin. Un garçon de la classe B a même tenté de lui graisser la patte,
de le faire quitter son poste de garde, moyennant une saucisse, mais
Blacky ne s’est pas laissé corrompre. Après avoir ingurgité la saucisse,
il a chassé le traître avec un terrible grondement.
À midi, quand nous rentrons à la maison, Tchaslav, Radoch,
Zorko et moi, il nous suit comme une ombre. Il aime bien mes amis,
surtout Tchaslav, son parrain, mais il n'obéit qu'à mes ordres. Seuls les
pipis d'autres chiens le font désobéir. Il est irrésistiblement attiré par
leurs odeurs, autant que le fer par l'aimant. Dans ces moments-là j'ai
beau l’exhorter : sourd à mes ordres, il se colle aux troncs d'arbre ou
aux pylônes électriques pour renifler avidement l'urine des autres chiens
et y ajouter quelques gouttes de la sienne, comme s'il répondait à une
dépêche.

Radoch affirme qu'il s'agit réellement de messages dont la race
canine se sert pour échanger des nouvelles, une sorte de
correspondance, des lettres chargées d'odeurs. Selon Radoch, le nez
d'un chien est cent mille fois plus sensible que celui d'un homme. Cela
me paraît vrai, car rien qu’en flairant mon pantalon Blacky devine qu’un
morceau de mimolette, son fromage préféré, se cache dans ma poche.
Si les chiens s’envoient des télégrammes odorants, je pense que les
fleurs de notre jardin le font aussi, s’offrant les unes aux autres de
tendres mots parfumés.
La semaine dernière, dans le terrain vague situé au bout de la rue
de Septembre, nous avons organisé pour lui une course de haies. Étant
donné que je ne peux courir convenablement, que Radoch est trop gros,
et Tchaslav trop petit, c’est Zorko qui a joué le rôle du « lièvre ».
Tchaslav avait défini le tracé à parcourir, une petite piste qui comprenait
quelques obstacles naturels : deux buissons épineux, le reste d'une
clôture et une tranchée. Suivant Zorko dans sa course, Blacky était en
train de sauter tous les obstacles plusieurs fois de suite, joyeux et avec
la plus grande ardeur, quand est survenu un incident totalement
imprévu.
Je n'en crois pas mes yeux. Soudain, sorti de terre comme un
champignon, un deuxième chien prend part à la course. C'est un lévrier
café au lait tacheté de brun. Poussant des aboiements sauvages, il
poursuit notre Blacky à fond de train, le rejoint et, sournoisement, essaie
de le mordre à la hanche. Mais Blacky n'est pas tombé de la dernière
pluie. Tout en courant à côté de l'autre chien, il bondit comme un
chevreau. L'agresseur tente de lui sauter à la gorge, mais Blacky
l’esquive et riposte. Ils se livrent une bataille acharnée, se rouent de
coup de gueule et, dans un nuage de poussière, font tout pour
s'entr'égorger.
Nous arrivons en courant sur les lieux de la rixe en même temps
que le propriétaire du lévrier, un moustachu vêtu d'un costume vert. Il
brandit son fusil de chasse et s'en sert pour séparer les chiens. Il leur
donne des coups de crosse, s'interpose enfin et emmène son chien,
jurant comme un charretier et pestant contre nous et Blacky.
Après son départ, nous avons soigneusement examiné tout le
corps de Blacky, son cou, ses cuisses et ses épaules. Nous n'avons
trouvé qu'une seule blessure, sur la croupe, une petite morsure que
notre Loudmila a désinfecté avec de la teinture d'iode.
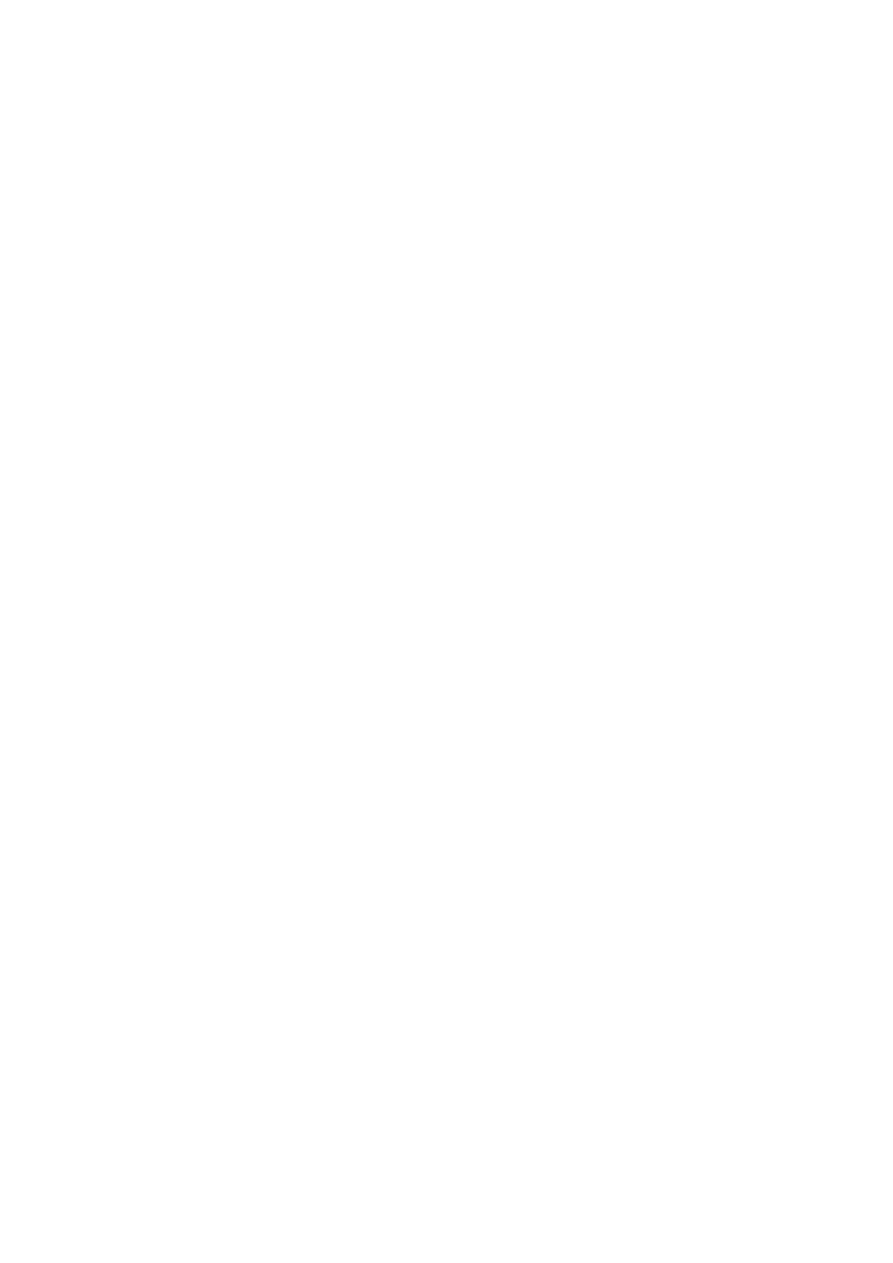
Connaissant notre voisinage comme sa poche, elle a tout de suite
identifié le maître du lévrier, un ancien combattant, chasseur passionné,
qui vient d’emménager dans une villa de la rue voisine, dont les
propriétaires ont été arrêtés. Le lévrier s'appelle Mac, et son maître
moustachu camarade Kovatch, parent lointain probablement de notre
institutrice.
Dimanche
C'est fou à quel point le temps passe vite quand on va tous les
jours à l'école. Une semaine entière s'est écoulée depuis le corps à
corps entre Blacky et le méchant Mac. Aujourd'hui, à midi, juste après le
départ de papa pour un colloque de stomatologues à Budapest, notre
Loudmila m'a apporté des nouvelles fraîches de ce Mac bagarreur.
Grâce au téléphone arabe, elle a appris que Mac, mordu il y a quelque
temps par un porc sauvage, était tombé gravement malade et que
l'ancien combattant avait remué ciel et terre pour se procurer la dose de
pénicilline nécessaire. Sans ce médicament rare et cher, Mac y aurait
laissé sa peau.
Dans un pays où la pénicilline est aussi rare qu'un mouton à cinq
pattes, alors qu’il n’y en a même pas pour les humains, le moustachu en
a trouvé pour son lévrier. Dieu merci, m'a dit à la fin notre Loudmila, ce
n’était pas la rage, mais une infection très grave pour les chiens, qui
n’est pas transmissible à l'homme.
« Plus un homme aime son chien, plus vaut la vie de cet animal »,
ai-je dit à notre Loudmila.
Je n’ai pas ajouté que pour sauver Blacky d'une maladie mortelle
j’étais prêt à briser la vitrine de papa, dans le cabinet, et à y prendre la
pénicilline uniquement destinée aux hommes. Quand notre Loudima a
terminé son récit, ma gorge s’est serrée à une sombre pensée, une
pensée que je n'ose pas confier même au Livre de ma vie.
Mardi
À mon retour de l'école, je suis allé directement voir Blacky dans la
buanderie. Depuis hier, il ne bouge pas de son tonneau. Aplati sur sa
couverture, il regarde en l'air sans ciller. Il n'a mangé que la moitié de sa

gamelle, bien que je lui aie préparé son plat préféré, de la polenta à la
poitrine fumée. Je me suis empressé d'effleurer sa truffe. Par bonheur,
elle est toujours froide et humide. Sachant de quoi il parle, oncle
Edouard m'a dit qu’une truffe froide et humide était signe de bonne
santé.
Mercredi
Depuis vingt-quatre heures, Blacky ne touche plus à sa gamelle. À
mon retour de l'école, je me suis agenouillé devant son tonneau et nos
yeux se sont croisés. C’était la première fois que je le regardais droit
dans les yeux. On passe des journées entières en compagnie de l’être
qui vous est le plus cher, on joue à mille jeux avec lui, on le cajole et
dorlote sans jamais le regarder dans les yeux. Et, un jour maudit, quand
un oiseau de mauvais augure vous survole, on échange enfin un regard
avec lui.
Chose étrange et atroce : je n'ai pas pu supporter son regard
vitreux et j'ai baissé les yeux au bout de quelques interminables
secondes. Sa truffe n'était plus froide ni humide, mais plutôt sèche et
tiède. Je me suis précipité dans le cabinet de papa avec la ferme
intention de briser sa vitrine et de m'emparer de la pénicilline. Nul doute
que Blacky avait attrapé la maladie mortelle du lévrier : sans
médicaments, il mourra à coup sûr.
La vitrine, ouverte, est vide ! Mes oreilles se mettent à
bourdonner, et mon menton à trembler. Je fouille en vain une armoire.
Je décroche un tableau qui cache le coffre fort de papa et l'observe,
impuissant, les yeux embués de larmes. Quand il part en voyage pour
plusieurs jours, craignant les cambriolages, papa y range ses précieux
instruments et médicaments. Sans lui, Blacky va succomber, de même
que Maminka, qui s'est donné la mort pendant l’absence de papa.
Si Blacky meurt, je le tuerai. Je demanderai à Tchaslav de me
trouver une poignée d'explosif. J'en bourrerai sa pipe préférée, et BOUM
! Puis je me donnerai la mort, moi aussi, comme Maminka. Ainsi, nous
serons tous morts et la boucle sera bouclée. Seule notre Loudmila
restera en vie pour raconter aux gens de son pays le triste sort des
Janvier.

Je redescends en courant dans la buanderie. Les yeux toujours
dans le vide, Blacky est immobile. Je me jette à genoux devant lui et
j’éclate en sanglots :
« Il n'y a pas de pénicilline, Blacky ! Une fois de plus, papa est
parti en voyage d'affaires ! Tiens bon, Blacky, il sera de retour demain,
dans l'après-midi ! »
Je touche doucement sa truffe. Sèche et tiède.
Il remue un peu et me lèche la main.
Sa langue aussi est chaude et desséchée.
« Tiens bon, Blacky ! Tiens, mon ami ! Ne me quitte pas comme
Maminka ! »
J'essaie de faire une prière, de supplier Dieu de sauver mon
Blacky. Mains jointes, je lève les yeux vers Lui. Je ne connais aucune
prière, je n'ai jamais prié. On m'a dit à l'école que Dieu n'existait plus.
Mais notre Loudmila affirme qu'Il se trouve dans le cœur de ceux qui Le
cherchent. Je Le cherche de tout mon cœur, mais Il reste muet,
insensible. Je Lui jure que, s’Il sauve mon Blacky, j'irai à genoux jusqu'à
la Save et, si cela ne suffit pas, jusqu'à la mer !
Blacky fixe sur moi ses yeux larmoyants, où luit une étincelle,
promesse de fidélité et de félicité éternelles. On dit que les animaux ne
pleurent jamais, qu'ils ne peuvent pas verser de larmes. Je ne pense
pas que ce soit vrai. J'ai connu un chien qui a pleuré ses fausses
promesses.
Il se prénommait Blacky.
Jeudi noir
Je me réveille en sursaut, à l’aube, tiré du sommeil par un râle.
Est-ce un rêve ?... Pieds nus, couvert seulement de ma chemise de nuit,
je cours à toutes jambes vers la buanderie. Blacky n'est plus dans le
tonneau, il s'est efforcé de ramper vers la sortie, mais n’y est pas
parvenu. Plus que jamais aplati, se prosternant devant la mort, les yeux
ternes, il regarde toujours en l'air, vers ce Dieu sans cœur qui nous a
séparés, qui m'a enlevé tout ce que j'aimais, mais qui ne pourra jamais
me ravir mon amour.
Je n'ai plus de larmes. Je n'ai qu'une pensée : il faut se mettre au
travail. Bêche. Scie. Marteau. Une latte et trois clous.

L'endroit que j'ai choisi se trouve au fond du jardin, entre la souche
de l'abricotier et les pétunias mauves de notre Loudmila, qui ont déjà
commencé à faner. À chaque coup de bêche, je pousse un cri inaudible.
La terre est pleine de cailloux et difficile à creuser. Ma pauvre jambe
droite me fait de plus en plus mal. Essoufflé et ruisselant de sueur, je
crois voir Tchaslav à l'entrée du jardin. Je m'arrête un moment : c’était
sûrement une illusion trompeuse...
Une demi-heure plus tard, Tchaslav revient, cette fois en chair et
en os, accompagné de Radoch et de Zorko. Tous trois sont munis
d'outils pour creuser la terre. Ils me serrent la main d’un air morose en
murmurant un « sorry, vieux ». Ils m'écartent de la fosse, m'obligeant à
m'asseoir dans l'herbe pour reprendre haleine et se mettent à
approfondir le trou, au pied des pétunias.
Un triste sourire au coin des lèvres, ils saluent mon travail de
menuisier : la croix en bois que j'ai fabriquée pour notre Blacky leur plaît
beaucoup. Pour la rendre plus belle encore, Zorko, qui a les poches
toujours pleines d'objets utiles, en sort un pinceau et un flacon d'encre
de Chine et écrit au milieu de la croix en grosses lettres majuscules :
BLACKY (1946-1946)
Le défunt est déjà enveloppé dans un drap blanc provenant de
mon lit. Agenouillés tous les quatre, nous le posons dans la fosse avec
d'infinies précautions, comme si nous craignions qu'il ne se réveille.
Puis, nous redressant, nous jetons chacun une poignée de terre sur le
drap blanc. Je jette aussi un morceau de mimolette. Zorko commence à
combler la fosse. Cette pénible besogne terminée, je plante la croix sur
le petit monticule.
Il est midi précis quand Radoch nous ordonne : « Garde à vous ! »
; c’est l'heure où, tous les premiers jeudis du mois, les sirènes du
quartier hurlent trois fois de suite. Elles résonnent à nos oreilles comme
les cloches d'une église. Les yeux perlés de larmes, mais fiers, nous
écoutons ce triste hurlement qui, au nom de toute la colline de
Toptchider, pleure le départ de Blacky.
J'ai enfin le droit de porter le deuil.
Sous le signe du Cochon
Le 1er février

Dimanche. Six mois après la mort de Blacky. Ce matin, notre
Loudmila m'a dit qu'hier soir papa lui avait demandé d'enlever la croix de
Blacky, car les gens qui allaient venir dîner chez nous n'apprécieraient
guère de voir une croix chrétienne sur la tombe d'un chien.
Il me le paiera cher. Un jour, je le tuerai. Je bourrerai sa pipe de
dynamite, et BOUM !
Je sors dans le jardin, suivi de notre Loudmila. La croix a disparu,
mais un miracle s'est produit, une chose extraordinaire, qui force notre
Loudmila à faire le signe de croix. Malgré la neige et les gelées
nocturnes, les pétunias mauves, au-dessus de la tombe de Blacky, ont
fleuri miraculeusement pendant la nuit.
Fin février
Ces temps-ci, oncle Edouard a beaucoup changé. Amaigri et
décharné comme s'il n'avait plus de corps, il flotte dans son costume en
tweed, devenu trop grand pour lui. Ses yeux vert argent sont délavés et
bordés d'écarlate, son nez d'aigle est de plus en plus pointu, ses dents
ont noirci et se sont cassées comme des clous de girofle.
Selon toute apparence, il a abandonné la construction de son
fameux DÉDEBRUPASS, son détecteur des bruits légués aux
générations à venir pas les anciens Grecs et Romains.
« À quoi bon, nous a-t-il dit lors du déjeuner de dimanche dernier,
à quoi bon se casser la tête avec une machine sophistiquée, quand on
peut les écouter à l'oreille nue. Il suffit de la dresser comme un chien. »
Assis à sa droite, papa a échangé un sourire aigre avec tante
Miliena, et lui a demandé d'un ton peu rassurant :
« Pourrais-tu nous transmettre un de leurs messages ? »
Oncle Edouard lui a répondu du tac au tac :
«
Memento, homo, quia pulvis es et in pulverem reverteris.
- C'est du grec pour moi, a dit tante Milena.
- C'est du latin, madame, l’a corrigée mon oncle, nous traduisant
aussitôt cette vieille sagesse latine. “Souviens-toi, homme, que tu es
poussière et que tu retourneras à la poussière”. Formidable, n'est-ce
pas ! »

Dans le silence gênant qui a suivi, je me suis hâté de l’approuver :
« C'est formidable, mon oncle ! »
Le
mot
« madame », qu’il a employé pour s’adresser à ma tante, ne
m'a pas échappé. Depuis quelque temps, il parle à ses proches comme
à des étrangers. Ce même dimanche, à la fin du repas, il a traité notre
Loudmila de quidam et, à l'heure du digestif, il a salué l'arrivée de Mlle
Lecco par une nouvelle locution latine, acedo nemini, qu'il n’a pas voulu
traduire.
J'ai entendu papa glisser la traduction à tante Milena :
« “Je ne m'accorde avec personne.” »
Et il a ajouté, toujours à mi-voix :
« Bizarre. Edouard n'a jamais étudié le latin.
- Ni le chinois, a chuchoté tante Milena dans un soupir. Pourtant,
depuis peu, il s'est mis à chanter en chinois en se rasant. Ma meilleure
amie, sinologue, qui l’a écouté en douce, en a conclu que les paroles
étaient celles d'une langue morte, un dialecte provenant de la frontière
entre la Chine et la Mandchourie. »
De prime abord, la première locution latine citée par mon oncle
m'a paru pouvoir être inscrite en épigraphe du Livre de ma vie. « Tu es
poussière et tu retourneras à la poussière ! » Mais le soir, en repassant
ces mots dans ma tête avant de m’endormir, j'ai soudain hésité : peut-
être les sages Romains s'étaient-ils trompés ?
Car s’ils avaient raison, Maminka aussi aurait été poussière et y
serait retournée comme une étoile filante. Néanmoins, elle m'a mis au
monde et je suis toujours vivant. Elle m'a laissé en héritage son visage
aux pommettes un peu saillantes, son petit menton avec son grain de
beauté et cette glande ouverte sur mon cou, qui, à l'époque de la pleine
lune, sécrète une goutte transparente. De surcroît, son flacon embaume
toujours son bouquet de fleurs et de fruits, comme de son vivant.
Somme toute, elle n’a pu retourner à la poussière, elle vit en moi, bien
qu’elle ait disparu en apparence. Nous nous suivons et nous égrenons
telles les perles d'un collier chinois.
Quand je serai grand, j'épouserai Maya, la fille de M. Samar. Nous
aurons un fils aux pommettes saillantes, qui aura un petit menton avec
un grain de beauté et une glande ouverte sur son cou sécrétant une
goutte les nuits de pleine lune. Rien n'est perdu, la mort n'est qu'un
grand voyage. Seule notre institutrice, la camarade Kovatch, sans doute

issue de la poussière, à en juger d'après ses bottes militaires toujours
couvertes de boue, risque fort d'y retourner.
Le dimanche suivant, pour la première fois depuis la disparition de
Maminka, oncle Edouard et tante Milena n'ont pas assisté à notre
déjeuner du dimanche. La veille, bien que nous soyons tout près du
printemps, une grosse neige s'est abattue sur notre Colline. Il a neigé
toute la journée et toute la nuit. Tôt le matin, pendant une courte trêve,
je suis sorti et me suis dirigé vers la Save. Notre Loudmila était un peu
souffrante et papa m'a envoyé chercher à sa place chez le boulanger
une miche et un pain viennois.
Hélas ! papa a oublié que nul ne peut échapper à sa destinée, que
l'homme propose et que Dieu dispose, comme disait Mme Karpov. Notre
destin ne voulait pas que nous mangions du pain frais en compagnie
d'oncle Edouard et de tante Milena.
Dans la neige jusqu'aux genoux, j'arrive devant la boulangerie de
M. Pop en même temps que la bande de Pirot, que j'ai déjà vu plusieurs
fois acheter là du pain chaud, le rompre en gros morceaux et le mâcher
les yeux fermés devant la vitrine, tout en respirant avidement l'odeur du
cochon de lait que M. Pop rôtit dans son four tous les dimanches matin.
Les pauvres garçons de la bande de Pirot ne peuvent rien faire d’autre
que croquer à belles dents leur pain et imaginer le goût de ce cochon
croustillant.
Ils feignent de ne pas me voir entrer dans la boutique mais, dès
que je ressors, ils me barrent la route. Souriant sans desserrer les
dents, ils m'encerclent et me poussent de leur poitrine vers la cour d'une
maison abandonnée. Ma miche disparaît dans le sac en bandoulière de
Pirot, et mon pain viennois dans leurs bouches de meurt-de-faim. Seul
Pirot, de trois ans mon aîné et fils de ferrailleurs, est gitan ; quant à ses
quatre comparses, tous de mon âge, ils ont le même teint café au lait,
faute de se débarbouiller quotidiennement.
Voler mes deux pains ne leur suffit pas. Ils s'emparent de mon
bonnet fourré et de mon châle, qui disparaissent à leur tour dans le sac
de Pirot. Je ne pleure qu'à cause du châle en laine portant mes initiales,
M.-L., que notre Loudmila a mis trois semaines à tricoter. Mes larmes
les irritent, ils me font un croc-en-jambe et me jettent violemment dans
un tas de neige.

« Pendant la guerre, crient-ils dans un fou rire, nos combattants
ont mangé de l'herbe ! Puisqu’il n’y a pas d'herbe, tu boufferas de la
neige, petit bourgeois, fils à papa ! »
Et ils m'en remplissent la bouche, les narines, les oreilles, ils en
mettent même dans le col de mon anorak. Ils me frottent le visage et la
nuque avec de la neige. Par chance, une brusque rafale de vent
interrompt cette torture, un vent qui m'apporte la délivrance en même
temps qu’une nouvelle chute de neige. Mes tortionnaires plient bagage
et se dispersent, me laissant tout seul, enlisé dans ma congère.
Une demi-heure plus tard, après avoir regagné la maison à grand-
peine, fouetté par des tourbillons de flocons, transi et trempé jusqu'aux
os, je savoure le bain brûlant préparé par notre Loudmila. Elle me dit
qu'oncle Edouard vient de téléphoner : ils ne peuvent venir, les
tramways ne marchent plus. Privés de notre miche toute fraîche, nous
ferons griller du pain rassis.
À la tombée du jour, j'ai une poussée de fièvre. Mon vieux
compagnon, le thermomètre de notre Loudmila, affiche 38°, puis 39,5°.
Je brûle, bous, tremble et grelotte tour à tour. Coiffée de son turban et
assise au bord de mon lit avec un teint de déterrée, Maminka se penche
sur moi pour m'effleurer les paupières de ses lèvres froides. Couvert de
sueur, je m'agite désespérément, je me blottis sous mon oreiller et je
pousse des cris que personne ne peut entendre. Elle se lève, fâchée, et
se dresse devant moi de toute sa hauteur. Elle défait son turban d'un
geste solennel, à l’image des illusionnistes de cirque. Elle le noue par
une extrémité autour de son cou comme une cravate, et jette l'autre bout
vers le plafond. La longue pièce d'étoffe s'envole et, miraculeusement,
reste étirée en l'air, comme dans un tour de magie.
Glacé d'épouvante, je me mets à hurler et me réveille dans les
bras de notre Loudmila, juste au moment où papa pénètre dans ma
chambre avec un grand verre d'eau et des gélules multicolores. Il me
force à en avaler une rose et deux bleues, ainsi qu’à vider le verre. Il
pose sur mon front brûlant une serviette humide et notre Loudmila
commence à roucouler, comme pour un bébé :
« Rêve, toi, douceur de ma vie,
Rêve du ciel qui fait éclore les fleurs... »

Et je rêve d'une fleur immense qui fleurit, ouvrant ses pétales, qui
m'aspire dans sa corolle odorante, douce et capiteuse, pareille à un
berceau...
Le lendemain matin, la fièvre est un peu tombée, mais elle
persiste. Le thermomètre de notre Loudmila indique 38° et je n'ai aucun
moyen de tricher avec le mercure. Couché dans la chambre de papa et
de Maminka, dans leur grand lit à colonnes, j'observe la gueule
incandescente de la cheminée de forge. Affaibli, j’ai la sensation d’être
entouré d'une odeur très désagréable, tenace et fétide, que je n'arrive
pas à m’expliquer. Tout ce que je touche, hume ou goûte répand cette
insupportable puanteur : les draps du lit amidonnés, le thé au citron, la
biscotte beurrée et même ma propre peau ont des relents qui me
prennent à la gorge. J'ai l'impression d'être penché au-dessus d’un puits
conduisant directement en enfer, que cet enfer se trouve en moi. Pour
échapper à la nausée, je saute du lit, je vais en titubant jusqu’à la
fenêtre et l'entrouvre pour aspirer une bouffée d'air frais. Ce que
j’aperçois me coupe le souffle et me fait oublier en un instant mes
fantômes pestilentiels.
La chambre à coucher de papa et de Maminka donne sur la rue,
sur ce qui, jusqu'à la nuit dernière, était notre rue de Septembre,
devenue une énorme congère. J’ai le souvenir de neiges abondantes
tombées certaines années, atteignant parfois deux mètres, la hauteur
de notre porte cochère. Mais je n'ai jamais vu la neige engloutir les deux
grands cerisiers, en face de chez nous. Et encore moins de neige rouge,
une pellicule d’un rouge brunâtre couvrant les congères, ce que papa
expliquera être un phénomène rare, mais naturel : notre ville a été
survolée par un nuage de sable du Sahara.
Moi, un enfant de l’Europe de l’Est, entouré de sable venu du
désert en plein hiver ! Je n'en crois pas mes yeux.
Le jour suivant, couché de nouveau dans le lit de papa et de
Maminka, je souffre beaucoup moins de mes odeurs désagréables, qui
disparaissent progressivement avec ma fièvre, et je me demande où est
la frontière entre le réel et le merveilleux.
Le merveilleux m'attire irrésistiblement. Le flacon de Maminka, qui
ne cesse d'exhaler ses senteurs, est une merveille. Les pétunias qui ont
fleuri sur la tombe de Blacky sont un miracle. Mais les vrais miracles, on
ne les trouve que dans les livres. Dans les livres, tout miracle est

naturel. Plonger à Vingt Mille Lieues sous les mers, voyager De la Terre
à la Lune ! Comprendre la langue des insectes, celle de La Cigale et la
Fourmi ! Visiter avec Gulliver Lilliput et participer aux aventures de
Robinson Crusoé ! Éprouver des frissons à la lecture des Histoires
extraordinaires, de mon maître Edgar Allan Poe, sans quitter la Colline
et le lit sécurisant de papa et de Maminka !
Quand je serai prosateur, à l'exemple de mon maître Poe, j'écrirai
des histoires extraordinaires. Dans le Petit Larousse illustré, sa vie et
son œuvre sont résumées par quatre lignes, avec la remarque suivante:
« écrivain américain à l’imagination déréglée. » Je ne sais pas comment
je dois interpréter ce mot déréglé. En cherchant une explication dans le
Petit Larousse de papa, j'ai trouvé des synonymes, les adjectifs dérangé
et détraqué, « se dit d'une personne dont les facultés intellectuelles sont
perturbées », d’une personne déséquilibrée, atteinte de troubles
mentaux.
Comment est-ce possible ? Il me semble pour la première fois
que le Petit Larousse s'est trompé. Si c'était vrai, les vénérables Jules
Verne, Swift, Daniel Defoe et autres La Fontaine seraient tous des
déséquilibrés mentaux. Si la lecture de ces grands fous conduit mon
imagination à la folie, je cours donc le risque de devenir un vrai écrivain.
Sans doute mon maître Poe fait-il partie des plus grands et des
plus fous. Parmi ses histoires à dormir debout, dénichées dans la
bibliothèque de papa, celle que je préfère est son Chat noir, que j'ai
déjà lu trois fois en frissonnant.
Aujourd'hui, à midi, j'ai eu un geste malheureux. Papa dit souvent
que le fait de tuer un homme n'est pas le pire des crimes, que le plus
odieux, un de ceux qu’ont commis les fascistes, est de détruire un livre.
Aujourd'hui, au bout de la quatrième lecture, transi de peur, j'ai jeté au
feu le Chat noir, de mon maître Poe, sentant bien que je deviendrais fou
si je ne le brûlais pas sur-le-champ. Peut-être mon imagination est-elle
déjà déréglée ?
Sous le signe du Rat
Mon anniversaire
Avant-hier, nous sommes entrés dans l'année du Rat. Je ne
comprends pas pourquoi depuis un an je n'ai pas touché au Livre de ma

vie. Après avoir lu Les Aventures d'Arthur Gordon Pym, de mon maître
Poe, je n'ai plus eu envie d'écrire. Les gribouillages pleurnichards d'un
enfant infirme n'ont rien en commun avec la grandeur du maître. Je ne
deviendrai jamais un déséquilibré, un vrai écrivain. Je m'efforce quand
même de noter ici en quelques phrases les derniers événements d'une
année morne, qui est passée comme un éclair.
Selon papa, oncle Edouard est gravement malade et tante Milena
sera obligée de le mettre dans une maison de santé qui coûte les yeux
de la tête. Les yeux de la tête de son frère, puisque tante Milena -
toujours au dire de papa - est chargée d'argent comme un crapaud de
plumes. Tout bien considéré, la maladie de mon oncle pourrait être
qualifiée de retour en enfance.
De plus en plus maigre, Tchaslav fond comme neige au soleil
depuis que l'emprisonnement de son père a été reconduit une nouvelle
fois. En revanche, Radoch continue à grossir. Atteint d’une grave
mélancolie qu'il appelle le « mal de l'Occident », il se déclare «
malheureux comme les pierres du chemin ». Belle expression ! Les
pierres que les hommes foulent aux pieds doivent être très
malheureuses.
Zorko, lui, passe des heures à la piscine dans une eau mal
chauffée à faire dix kilomètres de crawl par jour. À l'exemple du grand
frère de Radoch, il se prépare à traverser à la nage un lac, à la frontière
grecque, pour ensuite fuir vers le Canada. Je n'ai rien à lui envier,
puisque je nage moi aussi, en imagination, plongé dans Les plus beaux
poèmes de la langue française, un livre que papa m'a offert pour mon
anniversaire, à son retour de Paris.
« La poésie d'un peuple, a-t-il dit, c'est son âme. »
En écoutant quotidiennement glorifier l'âme slave, je me suis dit :
goûtons un peu à une autre âme. Outre que j’apprends tous les jours dix
mots de français par cœur, j'ai décidé de me former également à la
poésie française.
Tous les mois, j'apprendrai un poème de ma petite anthologie.
Une fois par mois, je noterai le plus beau vers d’un poème. Au lieu de
m'enliser dans mes gribouillages pleurnichards, je composerai un
magnifique bouquet de vers qui, tel un tourbillon de feuilles mortes,
traversera les saisons et m'aidera à fuir l'Ogre de mon enfance, comme
Le Petit Poucet dans ses bottes de sept lieues.

Sous le signe du Bœuf
C’est mon signe ! Douze ans après ma naissance, nous nous
retrouvons dans l'année du Bœuf. Laborieux, le Bœuf est le roi des
esclaves. Son année, que m'apporte-t-elle ?
Au bout de vingt-quatre mois, ma cueillette des plus beaux vers
français est achevée. Mon bouquet en contient vingt-quatre, provenant
d’un même nombre de poèmes et d’un même nombre de poètes. Je les
recopie dans Le Livre de ma vie :
BOUQUET DES PLUS BEAUX VERS
DE LA POÉSIE FRANÇAISE
Cueillis par Miodrag, Marie, Loup Janvier (10 - 12 ans)
PRENDS GARDE, ENFANT
Mon beau navire ô ma mémoire,
J'ai plus de souvenirs que si j'avais mille ans.
À mes pieds c'est la nuit, le silence.
Le vent se lève !... Il faut tenter de vivre !
Adieu, passé, songe rapide.
À l'heure où la rosée au soleil s'évapore
Les
nœuds ont éclaté. Les roses envolées.
Ne pourrons-nous jamais sur l'océan des âges /
Jeter l'ancre un seul jour ?
J'attends l'écho de ma grandeur interne.
Je vous connais, ô monstre !
Je n'ai rien à offrir et rien à demander.
Lorsque l'enfant paraît
Un air très vieux, languissant et funèbre,
Le
cœur trempé sept fois dans le néant divin,
Le poète impuissant qui maudit son génie,
Il pleure sans raison dans ce cœur qui s'écœure,
L'âme qui souffre sans colère.
Et quand il croit serrer son bonheur il le broie.

Il fait noir, enfant, voleur d'étincelles !
Oisive jeunesse à tout asservie,
Prends garde à la douceur des choses.
Mais viendra le jour des adieux,
Quand tu aimes il faut partir.
Il me reste d'être l'ombre parmi les ombres.
Le printemps du Bœuf
Hier, miraculeusement, la grisaille de notre quotidien a été balayée
par l'arrivée soudaine de notre institutrice, la camarade Kovatch. Après
plusieurs semaines d'absence, elle est apparue sans ses bottes
militaires, enceinte jusqu'aux yeux. Elle est venue nous dire bonjour et
au revoir, et nous présenter sa remplaçante, qui ressemble à un
criquet, vêtue comme il sied à une sauterelle d'un costume jaune et vert.
« Je ne pige que dalle, nous a dit Zorko à la sortie de l'école. Elle
n'est pas mariée.
- Ne te fais pas plus idiot que tu n’es, l'a blâmé Tchaslav.
- Non seulement elle n'est pas mariée, a enrichit Zorko, mais il
paraît qu’elle n'a jamais connu l'amour d'un homme.
- Si c'était vrai, ce serait l'Immaculée Conception, a conclut
Radoch.
- Imma... culée concept... ? » ai-je bégayé.
Une fois de plus, Radoch a sorti une explication de son fameux
mur ouest.
« C’est le privilège qu’a eu la Vierge Marie d’être préservée du
péché, a-t-il dit. Comme la parthénogenèse chez les animaux et les
communistes, la reproduction à partir d'un œuf non fécondé, privilège
des anciennes combattantes.
- Formidable ! » ai-je dit, feignant d'avoir tout compris.
- S’agissant d’une Monténégrine, tout miracle est possible, a
poursuivi Radoch avec un sourire qui nous promettait une nouvelle
curiosité en provenance de son mur ouest. Savez-vous, s’est-il exclamé,
savez-vous que le Monténégro est aujourd’hui encore en guerre contre
le Japon ? »
Nous avons tendu l’oreille.

« En 1905, en pleine guerre russo-japonaise, le prince
monténégrin Nicolas demande à ses frères russes de lui fournir des
armes pour l’aider à renforcer son absolutisme. De tout temps,
l’absolutisme a été cher au cœur des Russes, et le tsar, sans la moindre
hésitation, envoie à ses frères monténégrins huit centaines de fusils, qui servent
à tirer sur les têtes désobéissantes comme sur des pigeons d’argile. En
guise de remerciement, le Monténégro déclare la guerre à l’ennemi des
Russes, le Japon. Ç’a été une guerre sans un seul coup de feu, mais
aussi sans aucun traité de paix. Il ne sera jamais signé, et c’est pourquoi
on peut considérer que le Japon et l’une des républiques yougoslaves
sont toujours en guerre ! »
La fin de l’histoire de Radoch a déclenché notre hilarité, une vraie
explosion de rires.
De retour à la maison, je n'ai pas eu le temps d’approfondir mes
connaissances sur l'Immaculée Conception. Dans la dernière chambre,
en cherchant le Petit Larousse illustré, j'ai fait une horrible découverte.
Mes chers Coureurs avaient disparu. À l’endroit où le tableau était
suspendu, au lieu de ses couleurs éclatantes, ne m'attendait qu'un
triste rectangle poussiéreux.
Le soir, dès que papa a accroché son chapeau dans le vestibule,
notre Loudmila lui a demandé :
« Monsieur Arnolphe en a-t-il obtenu un prix convenable ?
- Dérisoire, Loudmila, a répondu papa, d’un ton morne. Mais cet
argent suffira quand même à couvrir la pension annuelle de mon frère,
Edouard, ainsi que l'achat d’une nouvelle fraise. »
Mes oreilles se sont mises à bourdonner. Non seulement à cause
de la disparition de mes chers Coureurs, mais parce que notre
Loudmila, au lieu d'adresser à papa son simple « Monsieur », a utilisé
pour la première fois son prénom, Arnolphe. De surcroît, sans employer
son habituel « mademoiselle », papa l'a appelée Loudmila tout court.
Couché tôt, je m'abandonne lentement au sommeil. Je retourne dans
ma tête l'expression de Radoch : « Immaculée Conception ». J'égrène
ses syllabes : Imma-cu-lée con-cep-tion, im-ma-cu-lée, im-ma-cu-lée...
Soudain, le grincement bref d'une porte me tire de ma
somnolence. De même que la nuit où j'ai rêvé le grand crapaud qui
pataugeait dans le sol détrempé de ma chambre, j'aperçois devant la
porte du séjour une silhouette blanche. Tout d’abord, je pense qu’il

s’agit de la Vierge Marie, qui se faufile dans ma chambre pour
m'instruire sur le sens de l’expression Immaculée Conception. La
prétendue Vierge est habillée, comme sur les tableaux, d'une longue
robe couleur lait. Pieds nus, elle traîne ses talons sur le parquet et se
dirige vers la chambre à coucher de papa. Arrivée devant sa porte, elle
s'immobilise un instant et je la reconnais aussitôt, le souffle coupé. C’est
notre Loudmila, éclairée par un rayon de lune, le visage pâle comme un
masque de plâtre, qui se glisse dans la chambre de papa.
Couvert de sueurs froides, je tends l’oreille. Silence de plomb.
Puis un bruit à peine perceptible, celui du vieux matelas à ressorts, qui
est secoué plusieurs fois d'affilée, d'abord à intervalles longs, devenant
de plus en plus courts et de plus en plus bruyants. Ce bruit recèle en lui
quelque chose d'inexplicable, une sauvagerie animale qui me soulève le
cœur. Féroce comme si quelqu’un portait des coups cruels, il est mêlé
de ronflements et de vrombissements en cascade, de gémissements de
plus en plus aigus, qui finissent par le cri de deux bouches essoufflées
mugissant à l'unisson.
Ensuite, de nouveau, un silence de mort. Glacé d'épouvante, le
cœur dans la gorge durant de longues minutes, j'attends, je guette le
moindre bruit. Finalement, la porte de papa grince légèrement et la
chemise de nuit couleur lait rebrousse chemin. Auréolée du clair de
lune, elle traverse ma chambre à pas feutrés et disparaît dans la salle
de séjour.
Je ne m'endors qu'au petit matin, épuisé par cette longue veille. Je
me rends compte que je suce de nouveau mon pouce, malgré tous mes
serments d’arrêter, mais je ne fais rien pour m'en empêcher. Exténué
par cette nuit blanche, je me réveille avec une violente douleur à la tête,
du côté gauche. Notre Loudmila m'oblige à avaler deux cachets
d'aspirine. Les yeux fermés, je retiens ma respiration pour ne pas sentir
l'odeur de sa peau, une odeur rance, pénétrante, suffocante, l'odeur
d'un mugissement qui fait ressembler l'homme à la bête.
Elle croit que je suis en train de m’endormir et me gazouille d'une
voix qui - Dieu seul sait comment - est devenue chevrotante :
« Rêve, toi, douceur de ma vie,
Rêve du ciel qui fait éclore les fleurs... »
L'été du Bœuf

Cette première nuit de veille n'a pas été la dernière. Tous les
soirs, j’attends pendant des heures le passage de notre Loudmila. Pour
rejoindre papa, elle pourrait traverser la salle à manger en évitant ma
chambre, mais elle ne le fait pas. Ses allées et venues rares et
irrégulières me causent de terribles insomnies, accompagnées de
migraine. La tête lourde, sur le chemin de l'école, je titube comme un
ivrogne, mes jambes se dérobent sous moi. Trahi par papa, qui a
chassé Maminka dans la mort pour pouvoir mugir à l’unisson avec cette
jeune étrangère, Loudmila, j'ai la ferme intention de les tuer tous les
deux.
Je leur administrerai un puissant somnifère, je traînerai leurs corps
dans la cave, jusqu’à cette alcôve où le major Schultz nous avait laissé
du charbon moulé, et je les emmurerai vivants, comme le héros de mon
maître Poe son chat noir. Ensuite, je me pendrai ou je me jetterai sous
le train comme la sœur de Pirot le gitan. Ainsi, il n'y aura personne pour
raconter le triste sort des Janvier et seul Le Livre de ma vie pourra en
témoigner.
Mercredi, une fois de plus, Radoch a apporté au quartier général
une bouteille de vin rouge. Nous avons bu au goulot, assis en rond,
tirant à tour de rôle sur une cigarette que Radoch avait roulée à la main.
Nous avons parlé de notre avenir. Tchaslav rêve de devenir aviateur et
constructeur d'avions. Zorko veut être illusionniste. Il s'entraîne déjà :
devant nos yeux émerveillés, il a fait sortir de sa casquette une
tourterelle puis l'a fait disparaître dans la poche de son blouson. Radoch
veut devenir bibliothécaire, afin de pouvoir lire toute sa vie. J'ai déclaré
vouloir être écrivain et lui ai promis un exemplaire gratuit de mes futurs
livres pour sa bibliothèque.
À l’issue de notre discussion, seul Radoch n’a pas vomi. Rentré à
la maison, je me suis couché sans tarder et ai dormi comme une
souche, pour la première fois depuis des jours. Je me fichais du
passage de Loudmila comme de ma première chemise.
Le lendemain, profitant de son absence, je suis allé dans notre
buanderie remplir une flasque de vin du tonneau de papa, ce même
tonneau où mon Blacky avait passé les derniers instants de sa vie. Les
douves resserrées, lavé et rincé, il y a un an, le tonneau est rempli d'un
vin capiteux jaune doré que papa achète à la campagne, dans le village
où nous avons vécu pendant la guerre.
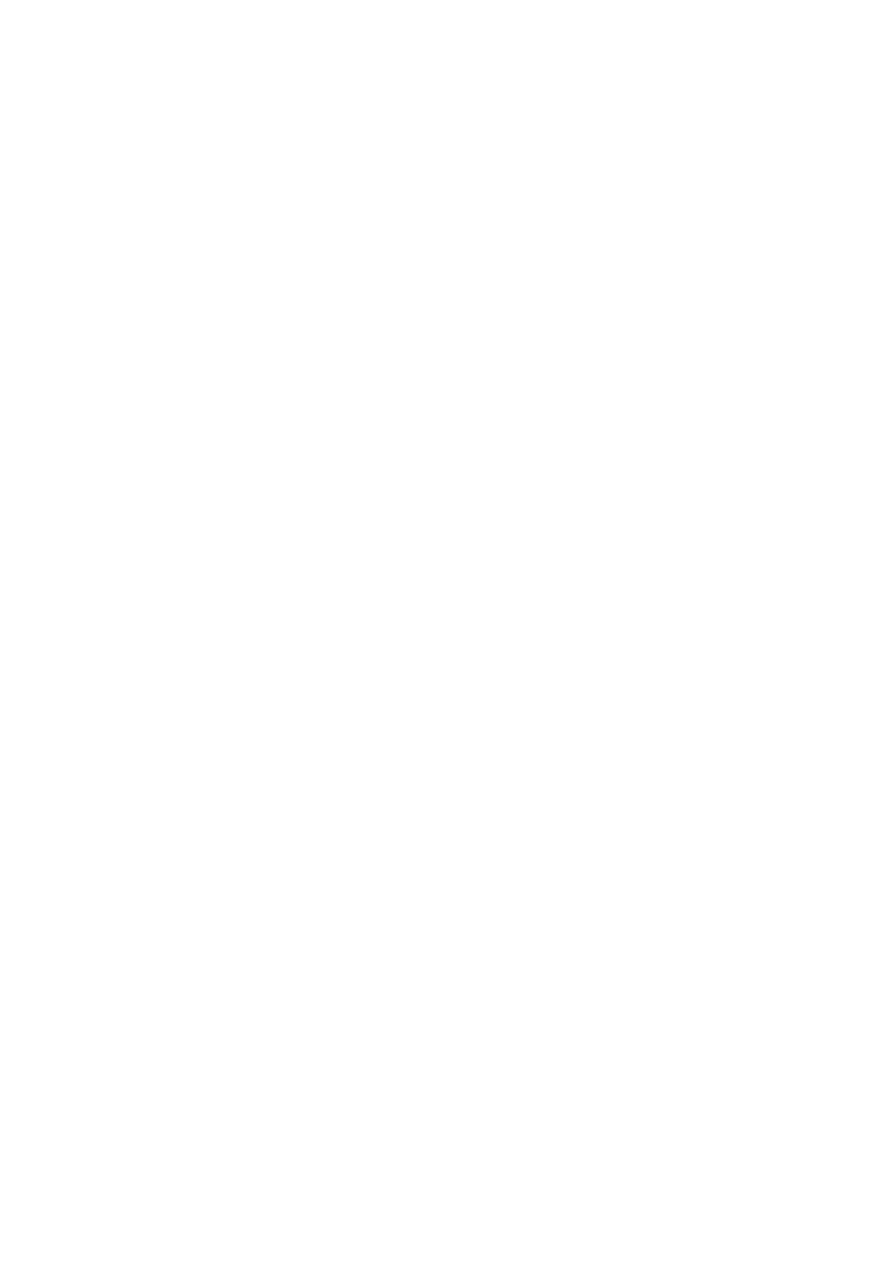
À ma grande joie, après avoir vidé la flasque de son capiteux
contenu doré, je sombre dans le sommeil sans aucune peine et je dors
à poings fermés huit heures d'affilée. Pelotonné dans les bras de
Morphée, dieu des songes, je ne crains plus que Loudmila passe par
ma chambre. Parfois, mon protecteur Morphée me fait rêver de
Maminka et de Blacky, qui apparaissent au pied de mon lit, silencieux,
rassurants et souriants comme deux anges gardiens.
Chaque jour, je prends soin de remplir ma flasque, que je cache
dans les ressorts de mon lit. Et je ne vomis plus à la fin de nos réunions
dans notre quartier général, bien que je trouve le vin rouge de Radoch
un peu acide. Mais, des goûts et des couleurs, on ne discute pas.
Inquiet de me voir les yeux cernés et le visage blême, papa m'a fait
examiner par un collègue radiologue, qui n'a rien trouvé de grave. Juste
une mauvaise haleine, due au vin jaune de papa et dont je me
débarrasse, en même temps que de l'odeur du tabac, en mastiquant de
la pâte dentifrice.
Voilà une grande nouvelle, une première ! Je nage comme un
poisson, aussi bien que Tchaslav ou Zorko ! Lors de nos premières
baignades près des radeaux, j'ai peu à peu cessé de m’appuyer sur le
fond avec ma jambe gauche, me laissant flotter sans crainte dans le
courant vert de la Save. Apprendre à nager, ce n'est pas la mer à boire -
juste quelques gorgées d'eau -, on y parvient aussi facilement qu’à
avaler un verre de vin. De plus, dans l'eau nous sommes tous pareils, à
l'instar des poissons. Dans cet élément merveilleux, royaume d'égalité et
de liberté, il n'y a pas d'enfants infirmes qui se déplaceraient en
clopinant.
La seule chose qui me gêne, qui m’est pénible, c’est la loi de la
nudité inventée par Radoch, le plus vieux d’entre nous, qui nous oblige
à adopter la tenue d'Adam avant de nous baigner.
« Montre-nous ta boutique ! nous répète-t-il. Comment le Bon Dieu
t'a fait ! »
Une petite touffe de poils sous sa lèvre inférieure, qu'il qualifie d’«
impériale », et arborant des poils lisses sous les aisselles et sur le bas-
ventre, il en est fier comme un paon se mirant dans sa queue. Tchaslav
et Zorko, qui se déshabillent de leur plein gré avant d’enfiler leur
minislip, peuvent aussi se vanter d’avoir du duvet sur le bas-ventre. Je
suis le seul à être dépourvu de poils, à être glabre comme un œuf dans

mon ridicule maillot de bain démodé. Embarrassé, mal à l'aise, je me
change toujours à l'écart des autres, derrière un rocher, craignant qu'ils
ne m'ôtent de force mes habits, comme ils l'ont déjà fait ce jour où j'ai
failli mourir de honte.
Impudiques, ils caressent leur membre viril pour le faire gonfler.
Chacun l'appelle à sa manière : Radoch le lingot d'amour, Tchaslav le
doigt qui n'a point d'ongle, Zorko le onzième doigt. Et il ajoute, avec
effronterie : « Si ma grand-tante en avait un, ce serait mon grand-oncle.
» Faute d'une vraie érection, ils sont tous trois équipés d’objets de forme
ovale, qu'ils glissent dans leur minislip - Radoch une carotte, Tchaslav
une courgette, et Zorko un petit épi de maïs - avant d'aborder les filles
de notre île.
Le lit de la Save, par manque de pluies, s’est tari et rétréci au point
que l’île des Gitans se trouve pour ainsi dire à portée de la main. Située
non loin de l’embouchure de la Save et du Danube, marécageuse et
couverte d'une végétation luxuriante, cette île des Gitans servait jadis
d'abri aux gens du voyage. À son extrémité ouest, en amont de la
rivière, la grand-tante de Zorko y possède un hectare de terre, où, l’été,
elle laisse son bœuf paître en liberté. Le bœuf s'appelle Alex, en
l’honneur de son défunt mari.
Avant de traverser la rivière à la nage, nous enroulons nos
sandales dans nos habits d'été, tee-shirt et pantalon, et attachons avec
notre ceinture ce balluchon sur la tête. Le courant tiède et caressant,
d’un vert jade, nous berce et nous chatouille. Au milieu de la rivière,
Zorko annonce :
« Mecs, vous allez avoir une grande surprise ! »
Le terrain de sa grand-tante, entouré de roseaux et envahi de
hautes herbes et de plantes, est presque impénétrable. S'il n'y avait pas
une armée de moustiques, ce serait le lieu idéal pour fuir le monde.
Heureusement, Zorko, qui a toujours les poches pleines d’objets utiles,
distribue à chacun un morceau de gaze en guise de moustiquaire.
S'il n'y avait pas ces satanés moustiques, ce serait l'endroit rêvé
pour construire une hutte de paille, vivre avec Maya, cultiver la terre
aidés d'Alex - par exemple le riz, qui se prête à merveille aux sols
marécageux -, écrire des livres et mettre un enfant au monde, un Mio
bis ou une Maya bis, en ayant recours non pas aux mugissements
bestiaux, mais à l'Immaculée Conception. Dans notre ferme, seul Alex
aurait le droit de mugir à sa guise.

Il est là, majestueux bœuf de trait, armé de cornes qui n’ont rien à
envier aux défenses d'un éléphant. En ruminant, il nous observe en coin
d’un œil qui n'inspire pas vraiment confiance. Seul Zorko ne craint pas
de l'approcher, une branche à la main pour chasser les taons et les
moustiques de ses épaules. Alex pousse un bref beuglement, lève la
queue et projette aux pieds de Zorko une énorme bouse, un signe de
gratitude qui nous fait rire à nous en décrocher la mâchoire.
Zorko, nullement affecté pas notre fou rire, se saisit tel un vrai
bouvier d’une corde dissimulée par terre et tire dessus de toutes ses
forces. À notre grande surprise, sur une dizaine de mètres carrés, le
terrain couvert de plantes et d'herbes fauchées se soulève comme le
décor d'un théâtre. Et nous voyons apparaître, fascinés, un planeur
militaire, un vrai petit avion sans moteur, à moitié immergé dans un
étang.
« Bon sang ! fait Tchaslav en se raclant la gorge.
- Formidable... n'est-ce pas... dis-je en bégayant.
- C’est un souvenir du bombardement anglais, nous explique
Zorko, l’air triomphant. Les Anglais se sont servis en secret de plusieurs
planeurs, dont la plupart ont été abattus. Celui-ci est tombé sans son
pilote dans le marais et n'a jamais été détecté. En tous cas, pas avant
ce printemps où mon oncle a décidé de faire paître Alex ici. Après avoir
construit cette cache, il m'a amené ici la veille de son accident. »
Piqué par plusieurs moustiques qui semblent faire leurs délices de
son gros ventre, Radoch est de plus en plus irrité :
« Quel accident ? demande-t-il.
- Un accident de voiture. Il a eu les jambes paralysées.
- À quoi peut-nous servir cet engin ? »
La réponse de Zorko nous laisse baba :
« À fuir à l'étranger. »
Dans le silence absolu qui s'installe, nous écoutons les
moustiques striduler comme des chasseurs bombardiers allemands.
D'un seul coup de sa paume, Radoch en écrase trois sur son sein
gonflé, pareil à celui d'une fille.
« Comment vas-tu décoller dans ce bourbier ? demande-t-il,
léchant son sang dans le creux de sa main.
- De la même façon que mon oncle l'avait envisagé, répond Zorko.
- Et qu'avait-il envisagé ? bougonne Radoch.

- De se servir de sa barque et de son hors-bord. Le planeur est
équipé de flotteurs. Un moteur de quarante chevaux pourrait le faire
décoller, ça marchera comme sur des roulettes. »
Le visage boudeur de Radoch s'empourpre subitement. Il
demande d’une voix tremblante :
« Quelle est son rayon d’action ?
- Il est illimité si les vents sont favorables. »
Radieux, Radoch avale sa salive.
« Il est donc capable d’atteindre ce lac situé à la frontière grecque
que mon frère avait traversé à la nage ?
- Si les vents sont favorables.
- Combien de personnes peut-il transporter ?
- Trois adultes. C’est-à-dire quatre enfants.
- Nous sommes quatre ! jubile Radoch. Ça baigne !
- Je pourrais piloter, se propose Tchaslav. J'ai fait deux heures de
vol en planeur avec mon père. Rien de plus facile, c’est bête comme
chou.
- Et le moteur de la barque ? intervient Zorko. Voilà le hic. Qui va
conduire la barque ? Le kamikaze qui s'en chargera devra se sacrifier
pour la cause. »
En les écoutant parler, fébrile, je n'ai qu'une pensée en tête :
Maya ! Si je m'envole avec les autres, Maya restera sur le carreau, à la
merci de ce maudit Gillé, secrétaire de la jeunesse communiste, qui,
depuis des semaines, rôde autour de la boutique de son père avec des
intentions plutôt douteuses.
Mon sang ne fait qu'un tour et je lâche :
« Je serai le kamikaze, je piloterai la barque ! »
Mes amis me regardent, éberlués.
« Pourquoi te sacrifies-tu ? »
N’osant leur avouer les vraies raisons de ma décision, je réponds
sans réfléchir :
« Je dois m’incliner avant sur la tombe de ma mère. »
Mes amis toussotent, échangeant un regard furtif.
« O. K., Mio, me dit Radoch. Dans ce cas, nous emmènerons
Maya à ta place. »
Je reste consterné. Je me suis donc doublement sacrifié, mais j'en
suis content, pourvu que Maya échappe à ce Gillé, à ce séducteur sans
scrupules.

Radoch prend aussitôt les choses en main. Le planeur, nous le
tirerons du marais avec l'aide d'Alex, le nettoierons et réparerons l'un de
ses flotteurs, cassé. Tchaslav est chargé de se procurer de l'essence
pour le hors-bord, Zorko de trouver un joug et des chaînes pour atteler
Alex. Moi, le kamikaze, d'apprendre avec Zorko à tenir en bride les
quarante chevaux. Lui, Radoch, est responsable de la nourriture et des
boissons pour le voyage. Il se proclame le commandant en chef de la
future opération secrète, à laquelle il faut trouver un nom de code.
Le soir approche, nous sommes tous couverts de piqûres de
moustiques et nous ne songeons qu'à rentrer à la maison, contemplant
les éphémères papillonner à la surface de l'étang. Ces insectes fragiles,
dont l’existence ne dure qu'une seule journée, expriment une singulière
joie de vivre. Quoiqu’ils soient nés pour mourir, ils font de leur vie une
fête perpétuelle. Leur allégresse ressemble à notre ardeur : l'enfance est
comme le vol frénétique des éphémères.
« Le nom de code de l'opération ? répète Radoch.
- Petit cheval de fées, dit Tchaslav. Ma grand-mère appelle les
éphémères petits chevaux de fées. Comme un conte de fées.
- Chapeau ! Chapeau ! » nous exclamons-nous en chœur.
L'automne du Bœuf
L'opération de sauvetage du Petit cheval de fées se révèle être
beaucoup plus compliquée que nous ne l'avions imaginé. Le majestueux
Alex n'est pas vraiment un bœuf de trait ou de labour, c’est plutôt un
taureau orgueilleux qui ne supporte pas son joug, ni aucune autre sorte
d'attelage. Lors de notre premier essai pour tirer le planeur hors de la
vase où il s'était enlisé, Alex a piqué une colère noire, il s’est mis à
beugler comme un damné et a rompu la chaîne attachée à son joug,
faisant s’enfoncer un peu plus le planeur dans la boue. Le second essai
a été tout aussi infructueux : Alex a cassé le deuxième flotteur et nous
avons compris que l'envol du Petit cheval de fées n'aurait lieu, dans le
meilleur des cas, que l'été prochain. À l'arrivée des premières pluies
automnales, nous nous sommes, provisoirement, endormis sur le
manche, sans toutefois renoncer à notre entreprise.
Dimanche dernier, pour nous réconforter et nous encourager,
Tchaslav nous a annoncé une merveilleuse nouvelle : il travaille sur la

construction de deux tandems, qu'il compte finir au moment de la fonte
des neiges. Ces deux engins nous permettront de gagner plus
rapidement la Save et de parcourir notre Colline en évitant les pièges
de la bande de Pirot. Le premier tandem, destiné à Zorko et à Radoch,
en raison du poids de ce dernier, disposera d'un châssis renforcé. Le
second, construit pour Tchaslav et pour moi, sera muni à l’arrière d'un
siège supplémentaire, qui au besoin pourra accueillir Maya.
Maya, derrière moi, je n'en crois pas mes oreilles !
Quelques heures plus tard, rendant visite avec papa à oncle
Edouard et tante Milena, ma joie matinale s'évanouit à la vue du
malade. Gisant dans sa chaise-longue comme s’il n’avait plus d’os, le
visage émacié et cireux, les yeux ternes, oncle Edouard nous salue d'un
sourire frêle.
« Enfin, dit-il en s'adressant à moi. Bienvenu sous mon misérable
toit, honorable maître Ming. »
Il me donne froid dans le dos. Il ne plaisante pas, il ne me
reconnaît vraiment pas. Je lui tends la main et, à mon grand
étonnement, il l'embrasse avec un infini respect.
« Et moi, je suis maître Confucius ! lâche papa en riant.
- Tu devrais avoir honte, Arnolphe, chuchote tante Milena,
furieuse. Ton frère est gravement malade.
- Inouï ! lui réplique papa à mi-voix. Ne pas reconnaître son propre
neveu !
- Et pour cause, gronde tante Milena. Depuis deux semaines, il
m'appelle madame Butterfly. »
Oncle Edouard fait comme s'il n'avait rien entendu. Il s’amuse à un
jeu d'enfant, le jeu d'un bambin de trois ans. Sa bouche édentée grande
ouverte, il pousse un cri étouffé qui me donne des frissons, il hulule telle
une chouette, tapant de ses mains ses joues décharnées comme s'il
battait la mesure d'une berceuse. Son chant me fait comprendre une
chose aussi drôle que sinistre : l’enfance retrouvée, royaume de liberté,
pourrait se transformer en une terrible prison.
Samedi, jour férié
Fête nationale, temps gris et pluvieux. Tôt dans la matinée, l'envie
de voir notre futur tandem à trois places me démangeant, je fais un saut

jusque chez Tchaslav. Je le trouve tout seul dans la grotte ouverte, en
train de travailler. Je suis enthousiasmé : notre tandem est presque
terminé, il ne manque que la selle de Maya. Tchaslav reconnaît mon
pas boiteux et me dit, sans lever la tête :
« Tu veux t'incliner sur la tombe de ta mère ?
- Encore faudrait-il que je sache où elle se trouve.
- Ce n'est pas une tombe, c’est un tombeau », réplique-t-il.
Mon
cœur se met à battre :
« Comment le sais-tu ?
- Je le sais, vieux, répond-il d'un ton sec. Enlève ton caban,
m'ordonne-t-il. On ne fait pas de la bicyclette vêtu de la sorte, ficelé
comme un saucisson. Tu risquerais de te casser la gueule. Je vais te
prêter un veston. »
Les oreilles en feu, je m'emballe :
« Nous allons faire du tandem ?
- Nous allons le mettre à l'épreuve, me dit-il. Nous allons faire un
tour, un saut jusqu'au cimetière de Toptchider. Une fois arrivés, je
t'indiquerai ce que tu dois faire. »
En passant devant l'épicerie de M. Samar, nous apercevons Maya
en train de dépoussiérer le mannequin noir dans la vitrine embuée.
Tchaslav freine, relève ses lunettes d'aviateur et actionne son timbre
avertisseur. Écartant l'index et le majeur de sa main levée, Maya nous
fait le signe de la victoire. Je me cache derrière Tchaslav, pour qu’elle
ne me voie pas engoncé dans la veste trop grande et tout crotté,
puisque notre tandem n’a pas de garde-boue. Je décide de m’équiper
pour la fonte des neiges de tous les accessoires d'un vrai cycliste :
casquette, bidon et pince-pantalons.
Heureusement, Tchaslav remet ses lunettes et nous continuons
notre course vers la pente ouest de la Colline. En traversant une grande
flaque d’eau boueuse, nous croisons Pirot le gitan avec trois membres
de sa bande et nous les éclaboussons. Ils en restent bouche bée, mais
ne nous insultent pas ni ne nous poursuivent : ils n'ont jamais vu de
tandem.
À l'entrée du cimetière, Tchaslav s'arrête et saute de sa selle en
m'aidant à quitter la mienne. Il appuie notre superbe engin contre la
clôture en fer forgé et, à ma grande surprise, allume un mégot.
« Je t'attends ici, me dit-il. Tu as dix minutes pour faire le
nécessaire. Prends l'allée principale et tourne à droite à hauteur de la

deuxième parcelle. Tu verras l'inscrit : “Concessions à trente ans”. Votre
tombeau, c’est le troisième, il est en marbre noir, avec un petit buste
blanc, celui de ton aïeul maternel. C'est ma grand-mère qui me l'a
montré lors de notre dernière visite à maman. »
Mes oreilles commencent à bourdonner et je balbutie :
« Concession... à trente ans ? Qu’est-ce que ça veut dire ?
- À trente, cinquante, cent ans, ou à perpétuité, m'explique
Tchaslav, rejetant en l'air la fumée de son mégot qui, miraculeusement,
prend la forme d'un anneau. Une fois ce temps écoulé, poursuit-il, si la
famille ne paie rien, la tombe est rasée, on fait place nette pour de
nouveaux clients. »
La voix cassée, le cœur dans la gorge, je murmure :
« Trente ans... Dix minutes...
- Trente ans, ça passe vite », me dit Tchaslav.
Je lui tourne le dos et je m’engage dans l'allée principale.
Tchaslav a dit la vérité, mais toute vérité n'est pas bonne à dire. À
hauteur de la deuxième parcelle, je lis sur une plaque rouillée : «
Concessions à trente ans », et mon cœur se serre davantage. Le
tombeau, en marbre noir, arbore une sculpture d’un blanc sale, la tête et
le haut du buste d'un homme avec favoris et moustache en croc, dont le
nom et le prénom, gravés en gros caractères, n’ont laissé que peu de
place à ceux de son épouse. Le nom de Maminka n'y est pas, elle n'a
droit qu’à une croix en bois, placée avec négligence contre une colonne,
comme on appuie un balai contre un mur.
Elle porte une simple inscription tracée au burin incandescent :
JELENA JANVIER 1915 - _1945
Le
cœur de plus en plus serré, je retourne dans mon esprit les
paroles cruelles de Tchaslav :
« Trente ans, ça passe vite. »
Maminka n'en avait que trente quand elle m'a abandonné. Je n'ai
que dix minutes, accordées par Tchaslav, pour comprendre sa vie et sa
mort. Hélas ! sa croix, gorgée de pluie et déjà un peu pourrie, reste
désespérément muette comme une porte close. Une pensée confuse
me trotte dans la tête : on ne dit pas par hasard qu'il faut faire une croix
sur... pour dire qu’il faut renoncer à quelque chose ou quitter quelqu'un à
jamais. Je me penche vers le bois, qui dégage une odeur de moisi, et je

le frôle de mes lèvres tremblantes, de même que Maminka effleurait
mes paupières.
Voué à être rasé pour laisser la place à de futurs morts, son
tombeau me semble appartenir à toute la race humaine, une race de
petits chevaux de fée. Est-il possible que nous ne soyons tous nés que
pour mourir ? Jamais je ne permettrai cette démolition. Si papa laisse sa
tombe à l'abandon, je le tuerai et je paierai le tribut tous les trente ans.
Et, si je deviens un écrivain célèbre, j'achèterai une concession à
perpétuité avant de mourir à mon tour. Ainsi, la demeure éternelle des
Janvier évoquera notre triste sort jusqu'à la fin des temps.
Trempé, je rejoins Tchaslav, qui, son mégot éteint au coin de la
bouche, me paraît avoir vieilli de dix ans pendant mes dix minutes
d’absence.
« J'ai réfléchi, dit-il. Trente ans, c’est toute une vie bien accomplie,
si on meurt à trente ans. »
Il m'aide à enfourcher le tandem et nous nous empressons de
rentrer chez nous, afin de nous préparer à la soirée dansante qui doit
avoir lieu dans la salle de gymnastique de notre école et que nous ne
voudrions rater pour rien au monde.
La grande salle polyvalente du rez-de-chaussée de notre nouvelle
école est pour moi le théâtre de vives émotions, de tourments, d'émois
et de désarrois. Tantôt salle de sport, tantôt salle de bal ou salle de
conférences, elle m'apparaît même en rêve, sous la forme d’un lieu soit
paradisiaque, soit infernal.
Tous les jeudis après-midi, elle devient salle de gymnastique,
nous offrant toutes sortes d'appareils pour nos exercices : poutres,
tremplins, cheval-arçons et autres trapèzes. Ma jambe droite
m'empêche d’exercer au sol, mais, à la barre fixe, avec Zorko qui m’aide
pour y grimper, je deviens le roi de l'élévation. M’étant longuement
entraîné dans notre buanderie avec un tuyau fixé sous le plafond,
j’accomplis un exploit inimaginable pour la plupart de mes camarades, je
m'élève sur la barre à la force d'un seul bras et, devant les spectateurs
admiratifs, j'y reste suspendu pendant une minute entière, avant que
Zorko ne m'aide à redescendre. Cet acte de bravoure provoque
régulièrement les applaudissements des filles et rend les élèves de
terminale verts de jalousie. Envieux comme un pou, le gros Gillé,
surnommé le Melon à cause de sa tête qui en a la forme, a même

essayé une fois de me secouer avec sa perche pour me faire tomber
comme une noix de coco.
Dans cette salle de gymnastique transformée une fois par mois en
salle de conférences, ce même Gillé fait la pluie et le beau temps
pendant les réunions de la jeu-nesse communiste, menaçant
d’expulsion de l’école tous les bourgeois « malpensants ». Sur le seul
scooter de toute la Colline, mis à sa disposition par le Comité de la
jeunesse de la ville, il ne cesse de rôder autour de l'épicerie de M.
Samar.
Enfin, débarrassée tous les samedis soir de ses tremplins,
échasses et poutres, notre austère salle de conférences, exhalant
toujours une odeur de transpiration due aux efforts physiques ou à la
peur, se métamorphose comme par miracle en salle de danse. Les
garçons, cheveux lavés, gominés et lissés, se rangent le long de la baie
vitrée, qui donne sur la rue. Quant aux filles, sur leur trente-et- un,
attroupées au pied du mur opposé, nattées ou bouclées, elles ont le
même air distrait et désintéressé que les garçons, en attendant que
l'orchestre se mette en place pour ouvrir le bal par un boogie-woogie
assourdissant, suivi d'un foxtrot et d'un tango.
Étourdi par la musique, serré dans mon nouveau costume deux
pièces, dont le tissu rêche me gratte le cou et les cuisses, j'attends le
tango, unique danse que je maîtrise à peu près et que Tchaslav m'a
apprise dans sa cave. Les joues pivoine et me tordant les doigts, je
regarde les garçons courageux inviter les filles à danser. Depuis des
semaines, depuis notre emménagement dans la nouvelle école, je jure
sur mon honneur que le samedi suivant j'inviterai une fille à danser. Le
samedi fatidique arrive, je me rends au bal, tout en continuant, entre
deux danses, à prêter serment. Les jambes flageolantes, je jure, je jure
à n’en plus finir, et la soirée s'achève sans que j’aie bougé de mon
pitoyable poste d'observation.
Le lendemain, je prête à nouveau serment, et je jure, je jure tout
au long de la semaine, comptant les jours qui me séparent encore du
samedi à venir. Tchaslav, bien qu’il n’arrive qu'à l'épaule de la majorité
des filles, se fiche de sa taille. Comme Zorko, il ne rate pas une seule
danse, en faisant des acrobaties dignes d'un danseur de music-hall.
Quant à Zorko, doué d'un magnifique pas de gymnastique, d'un pas de
félin, il ne danse pas, il rêve en dansant. On dirait qu'il vogue dans les

airs, qu’il ne touche pas le sol : aussi, quand les dames invitent à
danser, beaucoup de filles se précipitent vers lui. En revanche, jamais
une seule n'a songé à se diriger vers moi, comme si j'étais vraiment
l'Homme invisible, et ce malgré la très belle cravate bleu-blanc-rouge
que papa m'a prêtée, la plus belle de toute la salle, et qui m'étrangle
depuis le début du bal.
Ma malchance, la dois-je une fois de plus à mes habits démodés
et ridicules, à ce nouveau coup bas de papa, qui m'a obligé à mettre des
vêtements d'un autre âge, une veste à carreaux et un pantalon qui
ressemble à une culotte de cheval ? Du jamais vu dans notre école !
« Et ton cheval, mon cavalier ? m'a demandé Gillé le Melon à
l’entrée en contrôlant mon billet. Tu as oublié ton cheval ! »
Riant aux éclats, toute l’assistance s'est moqué de moi. Plus un
peuple est petit, et plus il se replie sur lui-même, sur sa vanité et son
hostilité à l'égard des étrangers.
« Miodrrrrag, Marrrrie, Loup Janvier ! Fausse couche frrrrançaise
et catholique ! Un petit manche d'étrrrrille ! Espèce de demi-porrrrtion !
Au lieu de te laisser pousser les cheveux, tu devrais plutôt laisser
pousser ta jambe ! »
Ravalant mes larmes, je me suis enfui dans la salle.
La seule chose qui me console de ma timidité, c'est la ferme
conviction que le tango se prête plus à l'écoute qu'à la danse. Un tango
argentin, il faudrait l'écouter plutôt que le danser. En compagnie de
Maya, si elle acceptait, j’écouterais cette musique du matin au soir, mais
elle préfère bouger. Elle n'a pas raté une seule danse de la soirée, elle a
invité Zorko à danser deux fois de suite. Lors de la seconde rumba, Gillé
le Melon les a interrompus avec un air faussement poli. Il s’est approché
d’eux en se dandinant comme un orangoutan, a ôté sa casquette ornée
d'une étoile rouge et étiré ses lèvres baveuses d'une oreille à l'autre.
« Le camarade n'a rien contre ? » a-t-il demandé, en se penchant
vers Zorko de toute la hauteur d’un élève de terminale.
Zorko a été contraint à s’incliner, mais Maya n'a pas cédé. Maya
l'orgueilleuse a repoussé le corsaire.
« Bas les pattes, sacré King-Kong ! a-t-elle dit. Jeux de main, jeux
de vilain ! »

Et elle a pris la poudre d'escampette juste au moment où Radoch,
percussionniste de notre orchestre, battait les dernières mesures de la
danse finale.
Rouge de colère, Gillé a grondé entre ses dents :
« Je te rendrai la pareille, fille de putain ! »
N'osant pas rentrer chez elle toute seule, Maya nous a attendus à
la sortie de l'école. Il était vingt-deux heures et la nuit de la nouvelle lune
était pleine d'ombres menaçantes. Entourant Maya pour la protéger de
toute sorte de danger, Radoch, Tchaslav, Zorko et moi nous dirigeons
coude à coude vers la rue de Septembre. Chemin faisant, je ressasse
en moi-même : un samedi de plus d’espoirs trahis où j'ai manqué à mes
serments !
Pour nous rendre chez Maya, nous devons longer le parc qui
entoure le monastère des religieuses. Passer devant l'allée des
marronniers me donne froid dans le dos, bien que je sache que les
fusillés ont depuis longtemps été déterrés. Toutefois, mon inquiétude
n'est pas sans fondement : trois silhouettes surgissent de l'obscurité sur
la droite et se dirigent droit sur nous, tandis que deux autres
apparaissent à notre gauche.
Le dos collé contre le portail de l'ancienne demeure royale, nous
nous voyons encerclés par la bande de Pirot. Tous les cinq ont un
couteau entre les dents. Un battant entrouvert de la grande porte permet
à Maya de se glisser à l'intérieur du domaine pour disparaître dans les
ténèbres en direction de l'épicerie de son père. Zorko s'empresse de
claquer le vantail derrière elle.
Pirot nous aborde, suivi de sa jumelle à la peau tannée et aux
yeux brillants, noirs comme du jais. Orphelins de leur père et de leur
mère ferrailleurs, depuis la mort de leur sœur aînée, qui s'est jetée sous
un train, ils vivent tout seuls dans une baraque, au pied de la Colline.
Bien qu'ils aient notre âge, ils semblent beaucoup plus vieux, peut-être à
cause de la misère qui a ravagé leur visage. Ils retirent le couteau de
leur bouche pour nous adresser un grand sourire édenté qui nous fait
frissonner.
« La jeune dame s'est barrée et a laissé ses cavaliers sur le
carreau, dit Pirot, tout en effleurant nos poches d’une main habile. Les
cavaliers rentrent de la soirée dansante, ricane-t-il. Maintenant, c'est moi
qui mène la danse. Les danseurs vont vider leurs poches ou ils vont
recevoir une danse. »

Pétrifiés, muets, nous le laissons explorer nos poches. Le fait qu’il
ne trouve rien dans les miennes ni dans celles de Tchaslav le rend
morose. Le visage fermé, la lèvre inférieure saillante, il fouille Zorko et
Radoch, qui seront délestés de leurs maigres biens, Zorko d'une pile de
poche, et Radoch d'un paquet de cigarettes.
« On dirait que les cavaliers sont plus pauvres que nous, ricane
Pirot, en faisant un clin d'œil à sa sœur. Ils sont nus comme s’ils sortaient
du ventre de leur mère, ils traînent la savate, mais portent la cravate. »
La
sœur du brigand-poète s'approche de moi, me soufflant au
visage sa mauvaise haleine, une odeur de tabac et de bière. Elle
empoigne la cravate empruntée à papa, ma belle cravate bleu- blanc-
rouge, et d'un coup sec la tranche de son couteau juste sous ma gorge,
ne laissant que son nœud pendre à mon cou. Elle renifle avidement la
soie que j'avais parfumée avec le flacon de Maminka.
« Ça sent bon, petit morpion », me dit la voleuse-poétesse.
Puis elle répète son geste d’égorgeuse sous la pomme d'Adam de
Radoch et de Zorko. Portant une écharpe au lieu d’une cravate,
Tchaslav connaîtra le même sort : son écharpe en soie crue disparaîtra
dans le sac de Pirot.
Nos agresseurs s'éclipseront dans la nuit aussi brusquement
qu'ils sont apparus, nous permettant de reprendre enfin haleine.
« Bon sang ! dit Tchaslav. C’est ce qui s'appelle un vol à main
armée !
-
Ça s'appelle la lutte des classes », réplique Radoch.
Sous le signe du Tigre,
la fonte des neiges
L'année du Tigre ! Encore une petite semaine et nous mettront un
tigre dans le moteur de nos tandems ! Nom de code, une idée de
Radoch : Tigre 1 et Tigre 2. Attendant avec impatience notre première
promenade en compagnie de Maya, je regarde fondre au soleil les
derniers îlots de neige noircie.
Le vague à l'âme, plongé dans une étrange mélancolie, je leur dis
adieu. Ensevelie sous la neige comme sous un linceul blanc, notre
Colline me paraît encore plus belle qu'à son épanouissement, au
printemps ou en été. Couleur de la mort chez les Chinois, selon oncle

Edouard, cette blancheur de la neige, cette couleur sans couleurs,
m'inonde de la joie triste et indicible qui purifie le monde. On raconte
que la mort dans la neige ressemble à un sommeil flatteur, qu’elle nous
débarrasse de tout ce qui corrompt le cœur. Ma douce tristesse, qui n’a rien
de sombre, me berce tout l’hiver de longues rêveries.
Jamais cette saison ne m’a paru si courte, jamais la neige si peu
profonde. Autrefois, dans les années qui ont précédé et suivi la
disparition de Maminka, la neige atteignait souvent les toits des maisons
et les employés municipaux creusaient des tranchées étroites au milieu
de la chaussée pour que les habitants de la Colline puissent se
déplacer. Quant aux propriétaires des villas, ils étaient obligés de
dégager des couloirs à la pelle pour relier ainsi leur

cour au fossé principal. Ces passages étaient si profonds que
parfois, à cinq ou six ans, j'avais peur de m'égarer dans ce labyrinthe
blanc dont les parois étaient deux fois plus hautes que moi.
« C'est une vue de l'esprit, m'a dit Radoch. Cet hiver, la neige a
été aussi abondante que les autres années. Nous étions simplement
plus petits et le monde qui nous entourait nous paraissait plus grand. »
C’est peut-être la vérité de Radoch, mais pas la mienne. Plus je
grandis, et plus je me sens petit, ne cessant de regarder le monde du
bas vers le haut, avec l'œil d'un chien craignant une réprimande ou un
coup de pied. C'est pourquoi, faute de grandir dans mon esprit, je
grandirai dans les livres que j'écrirai un jour.
Dire que la neige a fondu, que nos tandems sont achevés, prêts à
parcourir la Colline ! Dimanche matin, transporté de joie, je me réveille
au chant du coq. Les quatre mousquetaires ont dorénavant une
mascotte, la belle Maya, dont le siège en cuir tigré est monté à l'arrière
du Tigre 2, notre tandem, à Tchaslav et à moi. Impatient, je compte les
minutes qui nous séparent du départ.
Maya arrive la dernière, au moment où Radoch nous donne l'ordre
d'enfourcher nos Tigres. Je pousse en cachette un soupir de
soulagement. Elle s'installe derrière moi et m’enlace les épaules. Nous
nous dirigeons à toute allure vers la Save, en faisant tinter les timbres
avertisseurs de nos guidons. Les jambes de sauterelle de Tchaslav
pédalent comme un moulin à vent. Au comble de la joie, Maya pousse
des cris aigus et me serre de plus en plus fort. À chaque virage, je sens
dans mon dos la pression de sa poitrine ferme, le contact de la pointe
de ses seins. Saisi de vertige, j'éprouve quelque chose d'étrange,
d'atroce : la braguette de mon pantalon gonfle à la manière d’un ballon.
Pris de panique, je lui donne discrètement une tape et, à ma grande
stupeur, je touche un membre qui se comporte comme un tuyau
d'arrosage affolé. Dégonflé quand nous arrivons sur les bords de la
Save, il laisse dans mon caleçon le souvenir de sa brève apparition, une
innommable bavure tiède qui a barbouillé mon bas-ventre.
Cet événement répugnant, par bonheur passé inaperçu, tombe
dans l'oubli dès que nous montons à bord de la petite barque de l'oncle
de Zorko. Seul à savoir manier l’aviron pour naviguer en pointe, il nous
aligne sur les bancs de façon que le gros Radoch ne nous fasse pas

couler. Il s'installe à l'arrière de l'embarcation et avance à la godille tel
un vrai chef de nage.
Dans le silence qui nous entoure, nous nous taisons soudain
comme si nous pénétrions dans un sanctuaire, respirant au rythme
rapide des clapotis sous l'aviron de Zorko. Porteuse d’un limon
printanier, l'eau vert-jaune tourbillonne derrière nous, me rappelant la
noyade à laquelle je n’étais pas prédestiné dans ce même bras de
rivière. Envoûtante et menaçante à la fois, une force mystérieuse me
taquine, me pousse à sauter dans les profondeurs de la Save. Depuis le
départ de Maminka, cette même force séductrice m'a rendu visite à
maintes reprises pour me mettre à l’épreuve et m’offrir toutes sortes de
périls, m'inviter à me supprimer : me pendre dans le grenier, sauter sous
un train, faire hara-kiri comme de nobles Japonais ou, tout simplement,
me laisser aller à la ruine, pareil au bateau qui coule de son plein gré en
se sabordant.
Radoch dit que la mort est contagieuse, que tous nous devons
mourir un jour, que la mort est une pandémie inguérissable qui affecte
tous les humains. Je ne pense pas que ce soit tout à fait vrai. Le suicide
est plus contagieux. Quant à la vie, autant que je puisse en juger, c’est
la plus infectieuse de toutes les maladies.
En présence de Maya, le bœuf Alex se montre beaucoup plus
coopératif que lors de notre première rencontre. Il avale gloutonnement
dans sa main une grande touffe d'herbe, se délecte d'une poignée de
sel que Maya, petite-fille de paysans, lui a apportée en cadeau, accepte
de porter son joug et d'être attelé. Attaché à une barre entre deux
flotteurs du Petit cheval de fées, il le tire du bourbier et le dépose sur
l'eau stagnante. Munis de produits de nettoyage, de brosses et de
serpillières, nous passons la journée à le frotter, décrotter, gratter et
torcher.
En fin d'après-midi, le Petit cheval de fées est propre comme une
écuelle à chat. Hélas ! cette propreté nouvellement acquise nous fait
mieux mesurer les dégâts occasionnés par sa chute. La peau couverte
de piqûres de moustiques et de brûlures d'orties, nous nous voyons
obligés de reporter notre vol, dans le meilleur des cas à l'automne, sinon
au printemps prochain.

« Petit à petit, l'oiseau fait son nid, dis-je en citant oncle Edouard.
Et j'ajoute d'une voix sonore, feignant d’avoir confiance en l'avenir :
Formidable, n'est-ce pas ! »
C'est Tchaslav qui va remonter notre moral ébranlé en sortant de
son sac un marteau, un sachet de clous et une quinzaine de gros
caractères, découpés dans une feuille d'aluminium. Souriant, mais
bouche cousue, il nous tourne le dos et se met à les clouer sur le flanc
du planeur. Pendant ce temps, Zorko grimpe sur une aile et se faufile
dans la cabine de pilotage. Deux minutes plus tard, Tchaslav s’arrête,
s'écarte et nous dévoile son œuvre.
Enchantés, nous lisons : « P’tit cheval de fées ».
Seul Radoch fronce les sourcils.
« Pourquoi cette apostrophe ? demande-t-il.
- Il n'y avait plus d'aluminium », explique Tchaslav.
Débordant de joie, Maya s'écrie :
« Longue vie au P’tit cheval de fées ! »
Nous l'acclamons par des cris de liesse :
« Longue vie ! Hip, hip, hip, hourra ! »
Alors que Zorko nous salue de la cabine, en agitant les ailerons et
le stabilisateur du planeur, nous crions à l'unisson :
« Bon vent au P’tit cheval de fées ! »
Sur le chemin du retour, les yeux rivés sur les remous de l'eau, je
me mords les joues jusqu'au sang en écoutant Maya se plaindre des
méchancetés et des vilenies que lui fait subir de plus en plus souvent
Gillé le Melon, ce séducteur, ce maître chanteur qui a décidé de
corrompre son innocence et sa vertu.
Usant de fausses promesses et de menaces, soufflant le chaud et
le froid, l’infâme Gillé tente de l'acculer au mur : des vacances dans un
camp de jeunesse communiste au bord de la mer, fermeture de
l'épicerie de son père, balades sur son scooter, expulsion de l'école...
Maya n'ose se confier à son père, de crainte qu'il ne décroche du mur
son fusil de chasse !
Au terme de son récit, les dents serrés, je jure en mon for intérieur
:
« S'il touche à Maya, je le décrocherai moi-même ! »
Rentré à la maison, je me précipite dans la salle de bains pour
laver de mon bas-ventre cette ignoble bavure qui me fait mourir de

honte. Allongé dans la baignoire, les yeux mi-fermés, je la frotte avec
une éponge. Dans ma tête resurgit notre course folle sur le Tigre 2, les
virages que nous avons dévalés ; l’image est si vivante que j’ai
l’impression que Maya, en chair et en os, se trouve de nouveau derrière
moi, la pointe de ses seins appuyée sur mon dos.
Je presse mon éponge, je frotte de toutes mes forces et une
vague de chaleur intense me submerge. Empoignant mon épi de maïs,
pris de vertige de même que sur la bicyclette, essoufflé comme pendant
une course de vitesse, je vis un instant de petite mort sublime. Mon
tuyau d'arrosage affolé crache sa salive, qui ressemble à du blanc d'œuf,
et se dégonfle aussitôt tel un ballon percé.
Le souffle perdu et le cœur défaillant, j'observe le crachat flotter
au-dessus de mon nombril et je commence à comprendre que je viens
de commettre ce même acte ignoble que, depuis peu, mes amis
pratiquent et décrivent avec fierté et délectation. C'est le pied, dit
Radoch, jouer du poignet ! De plus, il se vante de le faire tous les jours.
Quant à Tchaslav et à Zorko, ils appellent ça respectivement se taper
une branlette et jouer au billard anglais. Ils ne craignent nullement que,
à en croire les contes de bonne femme, cette jouissance pécheresse les
rende sourds ou dessèche leur colonne vertébrale.
Mais le pire, dans ce casse-tête, ce qui me donne des sueurs
froides dans l'eau chaude de mon bain, ce n'est pas l'acte lui-même,
c’est son piètre résultat. Mes amis disent qu’ils jouent du poignet pour
s'envoyer en l'air, pour déverser leur semence. Cette sacrée semence
que je n'ai jamais vue, je l'imaginais comme de grands grains de maïs
ou comme des graines de melon. Il est évident qu’elle n'a rien en
commun avec les vrais grains de maïs, ma semence, ce crachat
répugnant d'un garçon infirme, boiteux, laid comme un pou, espèce de
demi-portion, futur estropié impuissant qui ne pourra jamais avec Maya
mettre au monde un enfant.
Sous le signe du Lapin
Le 6 février
Premier jour de l'année du Lapin. Il me semble que le temps court
à toute allure comme cet animal. C'est le moment de faire un petit bilan
de l'année du Tigre, alors que j'ai un peu négligé Le Livre de ma vie
dans sa deuxième partie.

Nos deux Tigres hibernent dans la grotte de Tchaslav telles des
marmottes, après nous avoir servis vaillamment tout au long de
l'automne. Pendant ce temps, nous avons consacré tous nos moments
libres à la réparation du Petit cheval de fées et aux préparatifs de notre
opération secrète, dont le nom de code, inventé par Radoch, est « Icar
». J'espère que le destin de notre planeur ne sera pas aussi tragique
que celui du Grec légendaire, qui périt dans la mer, les ailes brûlées par
le soleil. Quant à tous ces noms de code, que Radoch multiplie jour
après jour, sans jamais se lasser, ils commencent à nous donner le
tournis.
Outre ceux-ci - la barque de l'oncle de Zorko s'appelle Noé, la
grotte de Tchaslav Poséidon, -, il a trouvé pour chacun de nous un nom
confidentiel, s’inspirant des quatre points cardinaux : lui, Radoch,
s'appelle évidemment Ouest, Tchaslav est devenu Nord, Zorko Est, et
moi Sud. Radoch s'est trituré la cervelle pendant une semaine pour
Maya, qui, faute d’un cinquième point cardinal, a été baptisée Sud-
Ouest.
Craignant les mouchards de la police et répétant sans cesse que «
les murs ont des oreilles », il nous remet par écrit des ordres codés.
Pour le sauver de l'oubli, je recopie ici le dernier qu’il nous a transmis,
inspiré par la lecture de l'Histoire de la Révolution française :
« Aujourd'hui, primidi ventôse, dans le ventre de Poséidon, Nord et
Sud continueront à nettoyer la force mouvante de Noé. À midi vingt,
Sud-Ouest rejoindra Nord à l'est de la Colline pour acheter la manne
terrestre destinée à nos vaillants citoyens. »
Traduit dans la langue des simples mortels, cet ordre serait le
suivant : Aujourd'hui, 1er février, Tchaslav et Mio continueront à nettoyer
le moteur de la barque. À midi vingt-cinq, Maya rejoindra Zorko devant
la boulangerie pour acheter deux sandwiches destinés à nos
camarades.... Étant donné que Maya et Zorko n'ont rien compris,
Tchaslav et moi sommes restés le ventre vide.
En attendant que le moteur soit réparé, j'ai appris à manier notre
barque avec un seul aviron, qui fonctionne à peu près comme l'hélice
d'un hors-bord. Mon entraînement a pris fin avec les premières gelées.
Cet hiver, il y a très peu de neige, mais la Save, couverte de glace, est
infranchissable depuis des semaines.

Chevauchant nos Tigres, nous avons suivi à plusieurs reprises
Gillé le Melon, qui ne cesse de rôder en scooter autour de l'épicerie de
Maya. La semaine dernière, faisant la roue comme un paon, il est
apparu sur la Colline dans une petite voiture empruntée, une Fiat
Topolino, conduisant engoncé dans son veston pour ne pas heurter le
plafond de la tête. La première chose qu'il a faite a été de proposer une
promenade à une jeune femme de petite vertu que tout le monde
appelle la Panthère, à cause de sa jupe courte couverte de taches
marbrées. La Panthère a accepté son invitation et il l’a emmenée vers la
forêt de Toptchider. Maîtrisant mal son vieux véhicule, Gillé a failli
déraper à deux reprises et n'a pas remarqué qu’il était poursuivi.
Après avoir dissimulé nos Tigres dans les broussailles, à la lisière
de la forêt, puis traversé un bosquet touffu, nous avons débouché sur un
cul-de-sac, où Gillé avait dû immobiliser sa Fiat. Nous sommes arrivés
juste à temps pour le voir essayer d'étreindre et d'embrasser la
Panthère. Féroce, courageuse et agile, comme toutes les panthères, la
jeune femme l'a repoussé et a sauté hors de la voiture.
Malheureusement, elle avait oublié son sac, resté accroché au
tableau de bord, un sac en plastique marbré assorti à sa jupe.
Cachés dans les fourrés, nous les avons entendus crier :
« Rends-moi mon sac, salaud !
- Prends-le toute seule, salope ! »
Bien qu’elle soit féroce et agile, la Panthère, hélas ! n'est pas très
sagace, ni clairvoyante. Elle se penche et introduit sa tête jusqu'aux
épaules à l'intérieur de la voiture pour tenter d'attraper son sac. La
malheureuse n'a aucune idée de ce qui va lui arriver. Agile lui aussi,
malgré sa corpulence, Gillé bloque la poignée de la portière tout en
fermant la vitre suffisamment pour la transformer en un véritable piège,
une sorte de nasse d'où sa proie, une fois entrée, ne peut plus ressortir.
La Panthère, d'origine hongroise, peuple champion en matière de
jurons, peste et fulmine, mais son geôlier, imperturbable, se tient coi.
Quoiqu’il soit membru et fessu, il est d'une souplesse surprenante. Il
glisse jusqu’au siège voisin puis s’extirpe de la voiture par l’autre
portière. Une cigarette éteinte au coin de ses grosses lèvres, il la
contourne, s'approche prudemment du félin en furie, retrousse sa jupe
et descend sa culotte jusqu'à ses genoux. Puis il ouvre sa braguette et
se colle contre elle comme un étalon.

Hors d’elle, la Panthère jure comme une païenne, mais ses
insultes se transforment rapidement en gémissements et en pleurs. Une
fois terminée son infâme besogne, Gillé se sépare de sa victime, fait le
tour de la voiture et regagne son siège, se tenant à distance de la
malheureuse, qui profère une nouvelle série de jurons.
Il met le starter, embraye, ouvre la vitre, libère la prisonnière, jette
son sac et démarre en trombe. Le pied au plancher, il fait un tête-à-
queue et disparaît en roulant à tombeau ouvert. Restée seule, pleurant
toutes les larmes de son corps, la Panthère remonte son slip et ramasse
les menus objets tombés de son sac.
Le jour déclinant, simplement vêtue d’une jupe et d’une pauvre
veste sous un ciel annonciateur d’orage, la Panthère ne peut guère
espérer une fin heureuse à son aventure, à cinq kilomètres de l’auberge
la plus proche. Écœurés par l’acte ignoble dont nous venons d’être les
témoins, nous échangeons un regard hésitant. Radoch est le premier à
surmonter son dégoût, le premier à sortir de notre cachette et à
s'approcher de la désespérée.
« Bonjour, madame la Panthère, dit-il.
- Par chance, madame... poursuit Zorko.
- Nous avons une place... continue Tchaslav.
- Une place libre... dis-je.
- Une place libre sur notre Tigre », conclut Radoch.
La jeune femme se renfrogne :
« Votre tigre ? grogne-t-elle. Une nouvelle saloperie ? Après ce
maudit éléphant, je dis merde à votre foutu tigre, bande de branleurs !
- C'est une bicyclette, lui explique Tchaslav, un tandem. Si vous
n'avez rien contre, nous pourrions vous déposer devant l'auberge Au
Ponceau du tsar.
- Si je n'ai rien contre ! s'esclaffe Mme la Panthère. Nom d'un
chien ! Que demandez-vous en échange ? Je ne peux pas faire l'amour
avec tous les quatre.
- Nous ne demandons rien, madame la Panthère, dit Radoch
poliment.
- Tiens ! s'esclaffe-t-elle de nouveau en jetant un œil vers moi.
Toutefois, je pourrais accepter un de ces gentlemen, de préférence le
plus jeune.
- C'est une proposition très flatteuse, madame la Panthère, dis-je
en bégayant. Mais je vous remercie.

- Tant pis pour toi, mon petit bonhomme », dit-elle.
Assise à califourchon derrière moi, elle ricane toujours, appuyant
ses seins opulents contre mon dos. Sa main gauche serre mon épaule
de plus en plus fort, tandis que sa main droite descend le long de ma
poitrine et se pose sur ma braguette bombée.
De retour à la maison, je voudrais me cacher dans un trou de
souris. Je me précipite dans la salle de bains pour me laver et changer
de caleçon. Plongé dans l'eau chaude de la baignoire, j'empoigne mon
éponge et je frotte, je frotte mon bas-ventre. Et, comme dans un rêve,
mon tuyau d’arrosage affolé, je revois madame la Panthère en train de
chevaucher mon Tigre. Nul doute que ma colonne vertébrale va se
dessécher et que je deviendrai sourd comme un pot à anses.
Brièvement, les autres faits de cet hiver, que je veux sauver de
l'oubli, bien que certains soient inoubliables.
Au dire de tante Milena, oncle Edouard va de mal en pis. Ses
facultés mentales se détériorant, incapable désormais de prendre soin
de son corps, ma tante se voit obligée de le laver, raser, peigner, de lui
épiler les poils du nez et des oreilles, ainsi que de lui faire les ongles.
Loudmila - qui n'est plus « notre Loudmila » et surtout pas la mienne -,
cette Loudmila a confié à Mlle Lecco que la pauvre tante Milena est
contrainte de suivre oncle Edouard même dans les lieux d'aisances pour
s’occuper de son hygiène la plus intime, vu que l'infortuné avait déjà
plusieurs fois raté la cuvette et fait ses besoins à côté.
« Les hommes au soir de leur existence, a dit Mlle Lecco, sont
sujets à l'orgueil comme aux pires humiliations. »
Ayant déjà connu toutes sortes d'humiliations, j'espère goûter
l’orgueil au soir de ma vie.
Quant à cette Loudmila, elle continue à traverser de temps à autre
ma chambre en chemise de nuit pour aller pousser en duo avec papa
des mugissements déshonorants. Je parviens tout de même à vaincre
mes insomnies en vidant chaque jour une flasque du vin capiteux de
papa. De plus, j'ai vu cette même Loudmila fumer dans le jardin une
cigarette de Maminka, l'une des trois qui sont restées, desséchées,
dans une tabatière après sa disparition. Cette dernière bassesse, elle
me la paiera cher, le jour où je l'emmurerai dans la cave avec papa.
Comme pour se faire justice, la nuit suivante, Maminka m’est
apparue en rêve, accompagnée de Blacky. Une cigarette desséchée

collée aux lèvres, elle tirait bouffée après bouffée et soufflait tant de
fumée qu’elle remplissait toute ma chambre, une fumée qui sentait le
parfum suave de son flacon. À ma grande surprise, j'ai remarqué que
Blacky, l'air dédaigneux et vindicatif, fumait lui aussi, rejetant comme
Maminka de gros panaches de fumée. Après leur disparition dans un
tourbillon vaporeux, je me suis réveillé avec mon pouce enfoncé dans
la bouche, décidé plus que jamais à mettre fin aux vices et à la
débauche dans notre maison.
Le 1er mai
Fête du travail, « fête des masses laborieuses », comme on dit
dans notre école ! Le plus laborieux de tous les travailleurs de notre
Colline, M. Samar, le père de Maya, a payé cette fête de sa tête. Quand
il a appris que son épicerie allait être réquisitionnée et qu'aucun recours
n’était possible, M. Samar a fait appel à sa manière.
Ç’a été un terrible événement, qui me fait penser que notre colline
de Toptchider mérite le nom de colline des Suicidés. Après avoir reçu
l'acte de réquisition de la main de Gillé le Melon, devenu coursier de la
mairie, M. Samar a décroché du mur son fameux fusil. Le corsaire s'est
sauvé sur son scooter, laissant l'épicier clouer la porte de sa boutique.
Mais ce n’était que le commencement de ce drame auquel Tchaslav a
assisté par hasard. Le lendemain matin, Radoch a été témoin de la suite
et nous a décrit la fin en entrant dans les détails les plus macabres.
Ayant condamné l'entrée de son épicerie avec des planches, M.
Samar a profité à l'aube du sommeil profond de sa fille, Maya, pour
mettre fin à ses jours dans la vitrine du magasin. Agenouillé à côté de
son mannequin noir et adossé contre un grand sac de farine, il a placé
les deux canons de son fusil de chasse sous son menton et appuyé
simultanément sur leurs deux gâchettes. Faisant sauter le sommet de
sa tête, bizarrement, les grains de plomb n'ont pas endommagé son
visage cireux. Après avoir transpercé son crâne, ils ont défoncé le sac,
derrière lui, et une horrible bouillie de farine et de sang s’est répandue
dans toute la vitrine.
Avant d'accomplir son geste désespéré, le pauvre homme avait
épinglé sur sa poitrine une feuille de papier portant l'inscription suivante
: « À bas la pègre communiste ». Radoch, qui se trouvait parmi une

demi-douzaine de passants et de badauds épouvantés quand la milice
est arrivée, a assisté à la sinistre procédure des agents, au bris de la
vitrine et à l'enlèvement du cadavre, qui a gardé, agenouillé, sa
pitoyable posture. Pour comble de malheur, le mannequin noir branlait
la tête d'arrière en avant, comme s'il approuvait l'inscription tachée de
sang : « À bas la pègre communiste ». Pour l'empêcher de se moquer
du monde, Gillé le Melon, présent sur les lieux, lui a assené un coup de
matraque qui l’a décapité.
Une fois l'ambulance et la police parties, ce même Gillé s'est mis
en quête de Maya. Il a passé au peigne fin la boutique et un petit
appartement, dans l’arrière-cour, puis s'est retrouvé devant la porte
blindée du grenier. Ne pouvant l’ouvrir, il est allé chercher des outils,
avec un policier en civil, pour forcer le blindage.
Hors d'haleine et fiévreux, Radoch finit son récit dans la cave de
Tchaslav. Nous avons à peine une heure pour sauver Maya, barricadée
dans son grenier. Nous sautons sur nos Tigres et nous élançons vers
l'épicerie. Nous prenons les virages sur les chapeaux de roue et nous
arrivons devant le magasin en moins de dix minutes. Dix minutes de
plus suffiront à Zorko pour escalader un mur et se hisser sur le toit de la
maison.
La quatrième dizaine de minutes nous ramène à notre point de
départ, dans la cave de Tchaslav. Maya, en état de choc, les yeux
gonflés, pleure à chaudes larmes, en proie à la fièvre. Nous poussons
la grande armoire et elle se couche sur un lit, dans la grotte, enveloppée
de trois couvertures. À l'extérieur retentissent les sirènes des sapeurs-
pompiers qui se dirigent vers la rue de Maya. Ce n'est qu'à ce moment-
là que Zorko, lui aussi étrangement fébrile, nous confie une chose qui
nous coupe le souffle.
« Avant de sortir avec moi, Maya a mis le feu à son grenier,
chuchote-t-il. Elle a jeté une lampe à pétrole allumée sur un tas de
marchandises. “La voilà, votre réquisition, maudite pègre !”, a-t-elle dit. »
Dans le silence de mort qui s'installe, nous regardons Zorko
trembler, comme Maya, en essayant vainement de retenir ses larmes.
« Va dans la grotte, lui dit Radoch d'un ton paternel. Maya a
besoin d'être réconfortée. Tu lui tiens compagnie et tu ne bouges pas
sans notre feu vert. »
L'air d'un petit enfant, Zorko obéit sans un mot.

Nous nous empressons de remettre la grande armoire en place et
nous attablons autour de l'échiquier de Tchaslav. Radoch, excellent
joueur, nous propose, à Tchaslav et à moi, une partie à l'aveugle. Il
commence et, d'emblée, nous frappe d'un coup forcé et nous étourdit
d'une fourchette, d'une attaque double. Implacable, il nous accule à des
cases d'où nous ne pourrons plus sortir. Nous finissons par oublier le
temps qui s’écoule... jusqu’à ce que des coups de bottes retentissent à
la porte.
Guidé par un policier en civil, Gillé le Melon fait irruption dans la
cave.
Il écume, fou de rage :
« Échec et mat ! tonne-t-il, rasant de sa matraque toutes les
pièces de notre échiquier. La partie est finie, bande de vauriens. Où est
la fille ? »
Nous prenons un air bête :
« Quelle fille ?
- La fille de l'épicier ! grogne le policier.
- Quel épicier ? demande Tchaslav, jouant les niais.
- Je t'écraserai comme un ver, Ruskof ! dit Gillé. C'est toi, fils de
traître, qui as mijoté ce complot. »
Ils inspectent toute la cave sans résultat et fouillent même la
grande armoire. Peine perdue.
Avant de partir, le policier s'enflamme à son tour :
« Savez-vous, bande de voyous, que la petite crapule a fait brûler
le magasin de son criminel de père avant de plier bagage ! L'épicerie est
totalement ravagée ! C’est un vrai crime ! Malgré son âge, l’incendiaire
va écoper d’une lourde peine !
- Ce n’est pas Maya, dit Tchaslav.
- Comment le sais-tu, voyou ?
- Je l'ai accompagnée moi-même à la gare routière. Maya est
partie chez sa grand-mère il y a trois jours.
- Où habite-t-elle ? s'impatiente Gillé le Melon.
- Aucune idée.
- Si tu bluffes, prends garde, Ruskof. Je t’aplatirai la figure comme
une pomme cuite !... »
Comme convenu, quinze heures plus tard, à minuit précis, Radoch
et moi rejoignons Tchaslav dans sa cave. Tout est prêt pour notre

aventure nocturne. Sans prononcer un seul mot, nous déplaçons
l'armoire, réveillons Maya et Zorko, enfourchons nos Tigres et nous
élançons vers un village, situé à vingt kilomètres de notre Colline, où la
grand-tante de Zorko possède une petite ferme, non loin de la métairie
de la grand-mère de Maya.
Chose étrange, les pointes de ses seins appuyés contre mon dos
ne font pas bomber ma braguette. Serrant fort mon guidon, la tête levée
vers le ciel bleu-noir, j'observe la constellation du Grand Chien. Elle
tourne sur elle-même à chaque virage de la route. Elle ressemble à
Blacky, qui portait une tache étoilée sur la poitrine. Une étoile filante
traverse la voûte céleste, suivie de sa queue d'étincelles, et s'éteint à
l'horizon, me donnant le vertige. Notre enfance subira-t-elle le même
sort, une courte vie de voleurs d'étincelles, d’enfants-météores ?
Une fois à l'abri du danger, au moment de l’au revoir, Maya nous
embrasse tous les quatre en guise de remerciement, elle nous
embrasse sur la bouche, nous faisant rougir comme des pivoines.
Sous le signe du Dragon
Le 5 mai
Pendant tout ce temps où je n’ai pas touché au Livre de ma vie, la
Terre a encore fait un tour autour du Soleil. Une année entière s'est
écoulée depuis la mort de M. Samar, et huit ans, jour pour jour, depuis
la disparition de Maminka. Sachant bien que papa et Loudmila se
rendraient au cimetière en fin d'après-midi, je les ai devancés d’une
heure, temps suffisant pour qu'une bougie allumée se consume
jusqu'au bout. Caressée par la brise, la cire jaune a pleuré à ma place.
Mes yeux sont taris, le temps qui s’écoule finit par sécher nos larmes,
mais le cœur reste serré à jamais. Avant de partir, j'ai gratté la cire pour
effacer les traces de mon passage et effleuré de mes lèvres la croix de
Maminka, dont le bois sentait la cendre.
Je doute que tante Milena puisse rejoindre papa sur le tombeau :
l'état d'oncle Edouard a encore empiré ces derniers jours. Je crains que
Le Livre de ma vie ne devienne une longue énumération de nos
malheurs. Tante Milena dit souvent : « Pas de nouvelles, bonnes
nouvelles. » Cela pourrait s’appliquer à mon journal, mais les rimes d’un
autre triste proverbe français lui conviennent mieux : « Les mauvaises

nouvelles ont des ailes ». C'est pour cette raison que je n'ai aucun
remords de l'avoir négligé pendant un an.
En rentrant du cimetière, je suis allé voir Tchaslav pour parler de
notre excursion qui doit avoir lieu demain. Menacé pour la énième fois
par Gillé le Melon, il a décidé de s'armer d'un stylet, qu'il portera jour et
nuit sur lui, caché dans sa botte gauche, comme l’assistant de Sherlock
Holmes, le docteur Watson, dans une nouvelle de Conan Doyle.
Le 8 mai
Quelle horreur, quelle atrocité, quel horrible coup du sort ! « Les
mauvaises nouvelles ont des ailes ! » Des ailes noires, des ailes
couvertes de sang !
Le 6 mai, comme prévu, nous sommes partis en train visiter le
Mémorial de Racha, un monument en forme de rose gigantesque, et ces
lieux saints où nos courageux combattants vainquirent les fascistes à la
fin de la Seconde Guerre mondiale. C'est le parcours obligatoire de tous
les écoliers.
Le train local était composé d'une voiture avec banquettes pour les
enseignants et de trois wagons à bestiaux pour les élèves. Le village de
Racha est situé sur un plateau élevé, à une trentaine de kilomètres au
nord de notre ville. Pour y accéder, notre tortillard a dû traverser un
tunnel en pente douce. Au beau milieu de ce tunnel, notre locomotive à
vapeur a soudain ralenti et, essoufflée, s'est arrêtée, se mettant à
cracher de grosses volutes d’une fumée noire.
Cinq minutes plus tard, serrés comme des harengs dans notre
wagon ténébreux, à moitié étouffés, nous vivons un long moment de
frayeur. « C'est la fin des haricots, tout est perdu », me dis-je en
écoutant les sanglots des filles, affolées. Collé contre Tchaslav, qui ne
cesse de tousser, je bâille comme une carpe derrière mon mouchoir.
« Je vais aller voir Radoch et Zorko, lâche-t-il entre deux accès de
toux, ils doivent être dans le dernier wagon. »
Il me quitte et disparaît.
Une fumée de plus en plus épaisse, âcre et pleine de suie,
m'enveloppe. Pris de vertige, pantelant, suffoquant, j'essaie de ne plus
respirer. Et je répète cette courte phrase qui résonne dans mon crâne
vide : « C'est-la-fin- des-haricots ! C'est-la-fin, la-fin !... »

Soudain, je ressens une secousse dans le corps. Un ébranlement
qui se propage dans mes os et me ramène à la vie. Notre train bouge, il
est reparti !... Mais, au lieu de continuer sa montée, il recule, de plus en
plus vite ! L'entrée du tunnel est sans doute plus proche que sa sortie !...
Au moment où, en marche arrière, nous sommes en train de
quitter la gueule noire de fumée, un cri épouvantable nous assourdit, un
hurlement déchirant que seul un homme ayant la mort entre les dents
peut pousser. Le train s'immobilise et une nouvelle aux ailes noires
circule de bouche en bouche. Nous venons d'écraser l'un des nôtres...
Le 19 mai
Son lit se trouve au fond de la salle, derrière un paravent blanc.
Tout est blanc autour de lui, le mur, les draps, les oreillers, couleur de la
mort chez les Chinois.
Jamais il n’a autant ressemblé à une souris. Amaigri, affaibli, les
traits tirés, la bouche en forme de museau pointu, ses grandes oreilles
transparentes, il occupe à peine la moitié de son lit. Seul son sourire est
resté intact, le sourire doux et un peu distrait de l'homme qui a eu la
mort entre les dents.
« Assieds-toi », me dit-il d'une voix frêle, presque inaudible, en me
montrant le bas de son lit tout plat, l’endroit où il aurait pu étendre les
jambes si elles n'avaient été amputées.
Toujours souriant, il me regarde, guettant la moindre hésitation de
ma part.
« Assieds-toi », répète-t-il.
Je m’assois prudemment au bord de son lit.
« La vraie taille d'un homme n'est pas la hauteur de son corps, dit-
il. Elle est dans sa tête. »
J'ai envie de lui répondre que sa taille est celle d'un géant, mais je
demeure silencieux. Je sais qu'il n’apprécie guère les phrases
grandiloquentes.
« Je voudrais que tu saches la vérité, poursuit-il. Ils étaient trois, je
crois qu'ils étaient trois. Il faisait trop noir pour que j’en sois sûr. Je me
préparais à sauter d'une passerelle à l'autre. L'un de ces mecs m'a
donné un coup de bâton et m'a poussé sur les rails. Peut-être était-ce
Gillé, j'ai eu l'impression d'entendre un de ses sales jurons.

- Il faut que tu les dénonces, dis-je. Ils seront jugés et condamnés.
- Je n'ai aucune preuve. Je ne peux pas les reconnaître, il faisait
noir comme dans un four. »
Subitement, ses yeux ternes se mettent à pétiller.
« Tiens, me dit-il en étalant sur sa maigre poitrine un morceau de
papier sur lequel il avait gribouillé un dessin. Je l'ai fait hier, se vante-t-il.
C'est une modification du système de commandes du Petit cheval de
fées. Génial, simple comme bonjour. Toutes les pédales deviennent
manuelles. »
Mon menton commence à trembloter. La gorge nouée, je réussis
quand même à retenir mes larmes. Je n'ose pas lui dire qu'il ne
s'envolera jamais aux commandes du Petit cheval de fées, que notre
rêve s'est écroulé comme un château de cartes. Exalté, malgré sa
fatigue, il ignore les sanglots que je viens de ravaler et continue à rêver.
Il va me confier à l'oreille un grand secret.
« Bouche cousue ! » me demande-t-il.
Je me hâte de prêter serment :
« Bouche cousue ! »
En quittant sa Russie natale, sa grand-mère avait gardé un petit
bas de laine, des boucles d’oreilles ornées de diamants. Cachées dans
un endroit inconnu même de lui, Tchaslav, elles serviront à acheter deux
prothèses pour son petit-fils cul-de-jatte. Comme il est interdit
d’exporter les pierres précieuses, Mme Karpov les avalera avant de
passer la frontière, puis se purgera à l’aide d’un puissant laxatif dans les
toilettes d'un notable, joaillier à Vienne, ancien collègue de son mari.
Cette confession a amolli son ardeur et il accepte volontiers mon
départ. Les titres des livres que nous lui avons prêtés, Radoch et moi, le
font sourire, La Maison des morts, de Dostoïewski, et Fort comme la
mort, de Maupassant.
« Nous sommes bêtes à manger du foin, Radoch et moi », me dis-
je, sur le point de sortir.
« Et Maya ? demande-t-il. Que devient-elle ?
- Elle a subi un interrogatoire serré. N'ayant aucune preuve, ils
l'ont libérée. Elle a trouvé refuge chez sa tante jusqu'à la fin de la
prochaine année scolaire. »
Il esquisse un sourire attendri et ferme les yeux, caressant du bout
des doigts le dessin posé sur sa poitrine, la modification des
commandes de notre planeur.

Craignant d'aggraver sa santé précaire, j'ai passé sous silence le
triste sort du Petit cheval de fées, détruit par la police, il y a une
semaine. Faute de temps, je ne dépeins cet événement qu'aujourd'hui.
Je dirai que l'année du Dragon ne nous a rien apporté de bon, ce
monstre fabuleux nous a déjà gratifiés d'une grande guerre.
Ayant décidé d'effectuer quelques derniers réglages sur notre
planeur, Radoch, Zorko, Maya et moi descendons vers la Save sur nos
Tigres. Assise à la place de Tchaslav, Maya pédale et manie le guidon
principal comme une vrai coureuse de vitesse. La crainte ressentie au
moment d’enfourcher ma selle se transforme en exaltation. Derrière elle,
accroché à mon guidon immobile, je m'enivre du parfum capiteux de ses
cheveux, une odeur de blé couvert de rosée matinale. Les yeux fermés,
je nous imagine courir à fond de train à travers champs.
Nous traversons la Save à la godille. Maya loue ma manière de
manier l'aviron ; je suis fier et rougis comme une écrevisse. En nageant
à la pointe, nous accostons le radeau pourri qui nous sert
d’embarcadère depuis la découverte du Petit cheval de fées. Nous y
arrimons notre barque et, sans nous douter de rien, pénétrons à pas de
loup dans le marécage.
L'accident de Tchaslav nous a rendus taciturnes. Aussi, nous
avançons sans desserrer les dents. À une trentaine de mètres du
planeur, une salve de rires et une odeur de viande grillée nous
contraignent à nous glisser dans un bosquet. Nous faufilant jusqu’à sa
lisière, nous apercevons une scène atroce qui nous casse bras et
jambes.
Quatre hommes en civil et deux policiers en uniforme, tous les six
avinés. Les flotteurs de notre pauvre Petit cheval de fées leur ont servi à
allumer une sorte de bûcher, un énorme feu, au-dessus duquel ils ont
installé la plus grande broche jamais vue. Tranchée et posée sur une
souche comme sur le tranchoir d'un boucher, la tête de l'infortuné bœuf
Alex regarde impuissante son propre corps tourner, embroché sur toute
sa longueur. Ce corps, les jambes coupées, est déjà bien rôti et
recouvert d'une croûte dorée que ses bourreaux découpent en gros
morceaux pour les ingurgiter aussitôt sur des tranches de pain.
À la lueur du feu, les yeux globuleux d'Alex paraissent perlés de
larmes, comme le sont les nôtres à la vue du Petit cheval de fées, qui,
dépouillé de ses flotteurs, s'enfonce lentement dans le marais. Avec ses
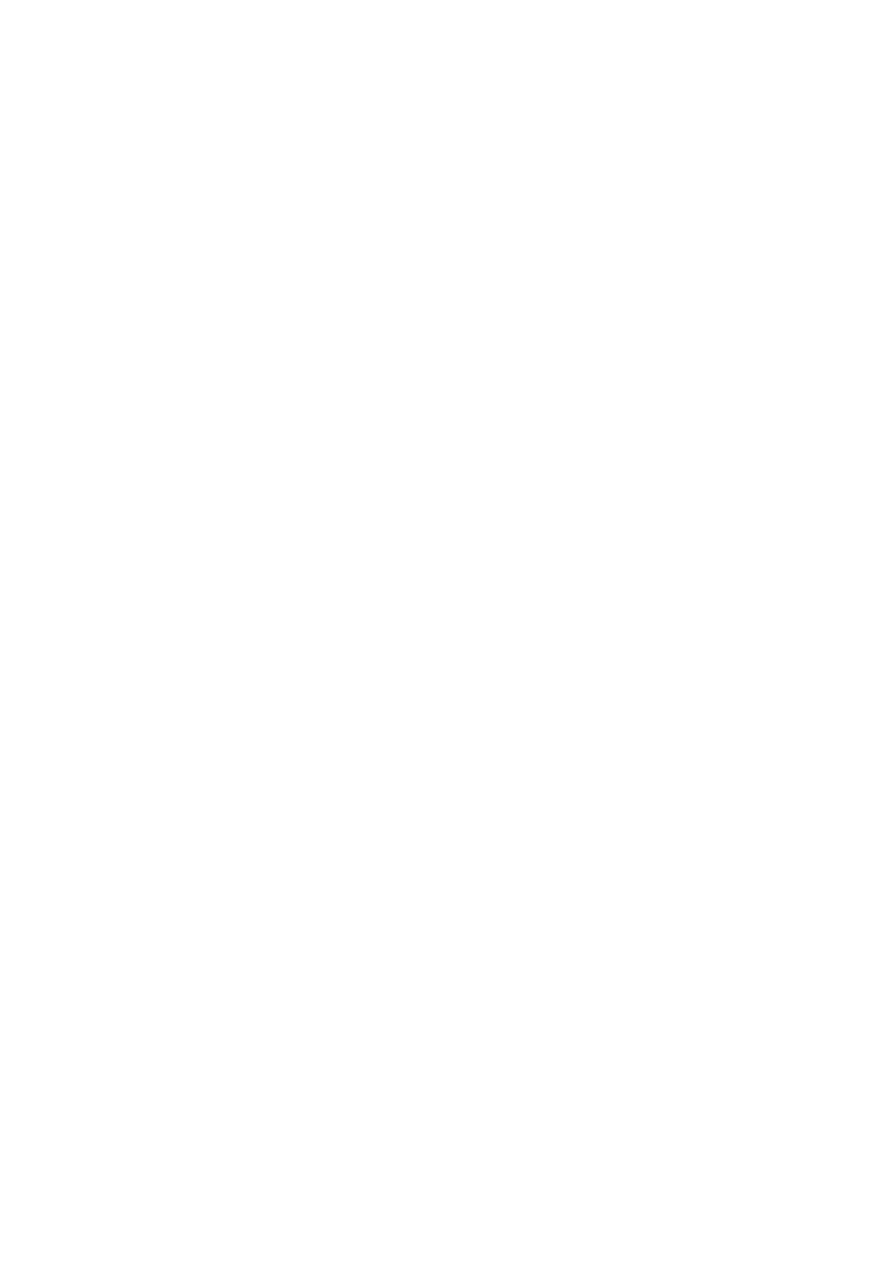
ailes imbibées d’eau, c'est le conte de fées de notre enfance qui sombre
à jamais dans la boue.
Le 31 mai
Oncle Edouard est mort dans son sommeil. Selon tante Milena, la
veille de son décès, il a recouvré toute sa lucidité, toutes ses facultés
mentales et physiques, revêtant même un habit à queue et lui proposant
de danser un charleston que diffusait la radio. À l'image d'une bougie
qui jette une dernière flamme juste avant de s'éteindre, il a dansé tout
seul dans son habit de cérémonie, une queue-de-morue qu'il avait
portée lors de leur mariage. Tout en gambadant joyeusement, il a récité
un très beau poème dont tante Milena n'a pas compris un seul mot,
vraisemblablement un poème chinois, qu’il a couronné de ses paroles
coutumières, les dernières de sa vie :
« Formidable, n'est-ce pas ! »
Il s'est couché sans se déshabiller, dans sa queue-de-morue
rongée çà et là par les mites, mais élégante et convenable, comme pour
un enterrement. Au dire de tante Milena, cela est bien tombé, elle n'a
pas ainsi été obligée de le changer pour la cérémonie religieuse.
Je n'y étais pas. Athée convaincu, papa n'a pas voulu que j'assiste
à l'exposition du corps, à la messe des morts, au glas et autres requiem
aeternam. En revanche, il m'a promis de m'emmener au cimetière le jour
où l’on déposerait l'urne d'oncle Edouard dans le tombeau de sa belle-
famille.
Il sera incinéré. Cela me réjouit. Parfois, avant de m'endormir,
j'imagine tous ces chers disparus en train de se décomposer dans leurs
cercueils et linceuls, Maminka, tonton Pinter, M. Samar, mon Blacky, les
os de notre chèvre Diana et même les pieds écrasés de Tchaslav. Cela
me donne la chair de poule, toutes ces bières et ces fosses abritant des
os nus, une armée de squelettes que nous foulons aux pieds. J'ai en
horreur ces enterrements. Quand mon heure arrivera, je me ferai réduire
en cendres. Oncle Edouard aurait été heureux lui aussi, s'il avait su qu'il
serait incinéré et qu’il échapperait à une décomposition et une
putréfaction humiliantes.

Fait bizarre, son décès ne m'a causé aucune douleur, car il est
mort il y a longtemps, le jour où je l'ai vu agenouillé devant une tête de
chou, dans notre jardin, le chou qui l'avait mis au monde.
Le 5 juin
Informés que la croix et l'urne funéraire de M. Janvier nous
seraient livrées aujourd’hui, nous nous rendons au cimetière à l'heure
dite, à quatorze heures. Préparant ma vengeance, un plat qui se mange
froid, mais qui est pour moi toujours bien chaud, je marche en tête du
cortège. Ils vont enfin payer pour m’avoir enlevé Maminka et pour
toutes ces années de dissimulation, d'un silence qui en dit long.
Deux
œillets à la main, un rouge et un blanc, je marche en tête,
boitillant, précédant papa, tante Milena et Loudmila d'une dizaine de
pas. Ils me suivent d'un œil méfiant : pour eux, c'est la première fois que
je mets les pieds au cimetière de Toptchider. J'emprunte l'allée
principale, tout en écoutant leurs souliers traîner sur les pavés. À
hauteur de la deuxième parcelle, je tourne à droite et me dirige tout droit
vers le troisième tombeau.
Une fois arrivé, je m'approche de la croix de Maminka et je glisse
mon œillet rouge dans un petit anneau de fer situé sur l’envers. Le
rouge, couleur de l'amour qui ne périt jamais, je l'offre à Maminka.
L'œillet blanc, couleur de la mort et de l'innocence, je le garde pour mon
meilleur ami, oncle Edouard, nouvelle recrue du monde des ombres.
Du coin de l'œil, je scrute mes proches, médusés, ahuris,
estomaqués. Les épaules tremblantes, les yeux baissés, tante Milena
et Loudmila essuient leurs larmes. Papa ne sait plus où se mettre, sinon
à cent pieds sous terre. Nageant dans son costume noir, visiblement
loué, il me paraît plus petit que jamais.
Heureusement pour eux, l’employé des pompes funèbres, que
nous attendons, fait son apparition. Il pose la croix d'oncle Edouard à
gauche de celle de Maminka. Cela me fait penser à nos déjeuners du
dimanche, quand ils étaient vivants : Maminka était toujours assise à la
droite d’oncle Edouard. Ainsi, remplacés par quatre planches croisées,
ils resteront côte à côte jusqu'à l’expiration de notre concession.
Le croque-mort essaie de remettre l'urne à tante Milena. Pâle
comme un linge, elle recule, n'osant pas toucher à ce petit vase de
bronze qui contient trente ans de sa vie. Papa baisse la tête à son tour

en murmurant quelque chose d’inintelligible. Un peu confus, un sourire
pincé sous sa moustache, l'homme en uniforme sable se tourne vers
moi. Dans un silence gêné, il nous explique d'une voix caverneuse qu'il
doit ouvrir le caveau familial et l'aérer avant d'y déposer l'urne du défunt.
Je prends mon oncle Edouard dans mes bras. Il est léger comme
une plume chinoise. Son urne, de forme ovale et couverte d'une calotte
où sont gravées des feuilles, ressemble à une petite tête de chou. Je
retiens à grand-peine un sourire, me répétant une phrase insensée : «
Sorti du chou, tu retourneras au chou !... » Le vase porte une simple
inscription, la même que sur sa croix : Edouard Janvier, 1887 - _1952.
L’employé des pompes funèbres disparaît dans la cavité
souterraine et regagne la surface trois minutes plus tard, trois minutes
qui me semblent interminables. Un peu essoufflé, il essuie la sueur sur
son visage parcheminé avec un mouchoir crasseux. À force de
fréquenter jour après jour les insectes rongeurs de cadavres, il a fini par
ressembler à une blatte incolore.
« M'sieurs-dames, vous êtes des veinards, lâche-t-il. Si vous
continuez à vous faire incinérer, vous aurez ici de la place pour dix
générations.
- Formidable, n'est-ce pas ! » dis-je.
Je ne sais quelle mouche me pique au moment où je lui rends les
restes d'oncle Edouard : je désire tout à coup qu’ils soient remplacés
dans l’urne par les cendres de papa et de Loudmila. Après les avoir
réduits en miettes dans notre cave, en raison de la souffrance que me
cause leur débauche, il y a fort à parier que je ferais peau neuve et me
régénérerais comme la queue d’Hercule, mon lézard.
Sous le signe du Serpent
Le 5 mai
Une révolution de plus autour du Soleil ! Ce Soleil doit être bien
petit, puisqu’un tour autour de lui passe si vite. Encore une année
pendant laquelle j'ai négligé Le Livre de ma vie. Le jour anniversaire de
la mort de Maminka sera dorénavant consacré, vaille que vaille, à
l’écriture.

Cette fois, c'est un grand jour pour Tchaslav et pour nous !
Toujours au moyen de ses trois coups de fil, il nous a convoqués
dans sa cave pour nous faire une démonstration du bon fonctionnement
de ses prothèses flambant neuves, que sa grand- mère a achetées à
Vienne, en même temps qu’une paire de béquilles. Ces dernières ne
serviront à Tchaslav que temporairement, jusqu’à ce qu'il s'habitue à ses
prothèses. Pour nous montrer toute l’étendue de son savoir-faire, il s’est
emparé du ballon de football de Zorko et s'est mis à dribbler, tirant
ensuite à deux reprises sur une cage de but imaginaire, avant de tomber
de tout son long.
« Je méprise les faveurs qu’on accorde aux victimes ! a-t-il
déclaré.
- Tu es une vraie queue de lézard », ai-je dit, enthousiaste.
Hélas ! personne n'a compris.
« Ma queue de lézard, me suis-je dit, ce seront mes livres que
j’écrirai. Je refuse aussi le sort de victime. La plus sombre des
souffrances peut être surmontée si on en fait un récit. »
Démoralisé par la destruction de notre Petit cheval de fées,
Radoch n'a pas renoncé à fuir et à rejoindre son grand frère au Canada.
Il prépare un autre plan d'évasion : nos ailes ayant brûlé comme celles
d'Icar, nous nous enfuirons par le chemin de fer.
Comment ? Sans passeport et sans argent, mais non dépourvus
d'imagination, nous prendrons le large « sous le manteau de la
cheminée », en voyageurs clandestins. Sous le manteau de la
cheminée veut dire : attachés au-dessus des essieux d'un train, sous le
plancher d'un wagon de l'Orient-Express.
Tchaslav refuse d'emblée, il est encore trop faible pour se lancer
dans ce genre d'aventure. Dès qu'il aura recouvré ses forces, il nous
rejoindra en Occident, où il étudiera l'aéronautique. Présente pour la
première fois au quartier général depuis l’incendie de son grenier, Maya
renonce à son tour : bien que Gillé le Melon la menace toujours, elle ne
peut abandonner sa grand-mère. De plus, après sa terminale, elle
voudrait s'inscrire dans une école d'infirmières pour s'occuper de cette
même grand-mère malade.
Enfin, elle pose une question simple qui nous met dans l'embarras
:
« Pourquoi fuir votre pays, celui que Dieu vous a offert ? »

Après un long silence, Radoch répond d'un ton mal assuré :
« J'ai des raisons idéologiques. Et puis je voudrais vivre dans la
contrée de Moby Dick et du Vieil Homme et la mer.
- Le goût de l'aventure, déclare Zorko. En plus, le grand frère de
Radoch m'a promis le rôle de gardien de but dans son équipe de water-
polo. »
Quant à moi, je suis forcé aussi de renoncer. J'hésite sur
l'explication à donner. Récemment, papa a été victime d'une petite
congestion cérébrale. Une gouttelette de sang coagulé derrière son
oreille a provoqué une paralysie partielle de trois doigts : le pouce,
l’index et le majeur. Par chance, ce sont ceux de sa main gauche.
Pendant quelque temps, il va falloir que je l’aide au cabinet. Loudmila
est trop maladroite. Et puis, cette même Loudmila, si je partais, papa
l'épouserait et ce serait la fin des haricots.
« Je ne peux pas partir, dis-je. J'ai des raisons littéraires. »
Mes amis restent interdits :
« Littéraires ?
- Je ne peux pas partir avant d’avoir achevé Le Livre de ma vie.
- Tu écris un livre ? Un livre sur quoi ?
- Sur nous tous. Je dois respecter l'unité de lieu, de temps et
d'espace, comme certains grands dramaturges.
- Bon sang, dit Tchaslav, nous allons nous retrouver dans un
bouquin !
- Tant pis, dit Radoch. Ou plutôt tant mieux. Quand nous aurons
plié bagage, tu pourras décrire en détail notre évasion, une espèce de
manuel pour futurs fugitifs. Mais avant, mon pote, bouche cousue. »
Il nous dévoile les grandes lignes des préparatifs que lui et Zorko
ont entamés. Couchés dans une sorte de hamac, ils seront suspendus
sous un wagon au moyen de plusieurs cordes. Muni d'une gourde d'eau
et de quelques sandwiches, chacun d'eux disposera aussi d'un couteau
afin de pouvoir couper ses cordes en arrivant à la gare de Trieste, où le
grand frère de Radoch les attendra.
Notre renoncement temporaire à partager leur aventure tombe très
bien, ils auront besoin de notre assistance pour installer les hamacs. Ils
sont déjà allés trois fois en reconnaissance jusqu’à un poste d'aiguillage
situé en dehors de la gare, où les employés des chemins de fer ajoutent
deux wagons à la rame arrivant de Sofia. Notre mission sera de nouer

les cordes. Le seul problème qui risque de se poser, le grand hic, est
l'orientation de leur tête.
« Pas de problème, ta tête est toujours tournée vers l'ouest, dit
Maya d’un ton badin.
- Ma tête, oui, répond Radoch en soupirant, mais comment savoir
de quel côté le wagon va être raccroché. Nous sommes obligés de nous
y attacher avant le raccordement. Si notre tête se retrouve orientée vers
la locomotive et exposée au vent, on risque fort de débarquer à Trieste
avec une inflammation du cerveau. »
Zorko, qui a une idée derrière la tête, finit par trancher :
« Nous nous mettrons tête-bêche, chacun dans un sens. »
Radoch le gratifie d'un large sourire approbateur :
« Rendez-vous ici, dimanche, à minuit. Nos deux wagons doivent
être raccordés à deux heures du matin. Mot de passe : “tête-bêche”. »
Dimanche, minuit précis. Ne pouvant nous accompagner à cause
de ses jambes, Tchaslav confie à nos soins les deux Tigres et donne en
cadeau à nos fugitifs deux tablettes de chocolat viennois. À l'heure de
l'au revoir, il a peine à retenir ses larmes. Nous descendons vite sur nos
tandems jusqu’aux Six Peupliers, cachons les Tigres dans les roseaux
du marais et poursuivons notre route à pied, les cheveux pleins des
flocons blancs tombés des arbres.
Nous nous taisons, comme si tout était dit entre nous. Les deux
wagons sont déjà garés à l'endroit que Radoch et Zorko connaissent
comme leur poche, sur une voie de garage qui longe le marécage. Dans
la nuit noire, deux douzaines de grenouilles coassent à qui mieux mieux
pendant que Zorko, Maya et moi nouons le hamac de Radoch sous le
wagon. Au loin apparaissent deux yeux jaune-vert, clignotant tels les
ventres des lucioles : les projecteurs d'une locomotrice. Sa sirène
rouillée corne comme un bateau dans la brume. Elle fait taire les
grenouilles et nous emplit d'une émotion poignante, indicible. Consultant
l'étoile polaire pour s'orienter, Radoch se ravise à la dernière minute et
décide de tourner la tête vers l'est.
« Tu n'as rien contre, mon pote ? demande-t-il à Zorko, en
grimpant maladroitement dans son hamac sans attendre la réponse. De
cette façon, nous dit-il, je pourrais faire mes adieux à la Colline.
- Rien, répond Zorko, qui se glisse dans son hamac, la tête
pointée vers l'ouest. Je porte la Colline en moi », ajoute notre ami

débonnaire aux poches toujours pleines de choses et de paroles
précieuses.
Ce furent leurs derniers mots.
Le 15 mai
Ne se servant plus que d'une seule béquille, Tchaslav trottine à
petits pas rapides de-ci de-là dans sa cave pour se remettre en forme. Il
nous offre, à Maya et à moi, un verre de vin rouge de la bouteille que
Radoch lui a laissée pour que nous buvions à sa santé et à celle de
Zorko. Avant d’aller trouver la mère de Radoch, à la bibliothèque, nous
trinquons : « Bonne chance à nos fugitifs ! » Tchaslav et moi vidons
notre verre d'un trait. Quant à Maya, qui ne boit jamais de vin, elle avale
une petite gorgée symbolique.
Nous nous réjouissons d’avance : comme d'habitude, la maman
de Radoch, qui est bibliothécaire, nous prêtera à chacun au moins deux
ou trois livres, bien que le règlement le lui interdise. Grâce à sa
générosité, nous sommes au courant de toutes les nouveautés, nous
disposons de toutes les traductions des textes en provenance des
grandes langues. Grâce à elle encore, nous lisons deux ou trois livres
par semaine. « Si le chat de la légende a eu neuf vies, dit-elle, un
lecteur passionné pourrait en avoir trente-six mille, autant que de livres
lus. » Maya préfère les auteurs russes d'avant la révolution d'Octobre,
Tchaslav se jette avec avidité sur tous les écrivains anglo-américains
contemporains. Quant à moi, je dévore des auteurs du monde entier, à
condition qu'ils appartiennent à la veine fantastique.
La lecture d'un livre fantastique ressemble à une plongée en
apnée : plus on retient sa respiration, et plus profond on descend, en
courant le risque d’avoir les tympans crevés par l'ivresse des
profondeurs. Un livre fantastique est une sorte de tête-bêche en soi : on
n’est pas obligé de s'orienter vers l'est ou l'ouest pour aller où que ce
soit. Débarrassé de ses béquilles, prothèses et autres semelles
orthopédiques, on est libre comme l'air, délivré de l'insupportable
pesanteur du réel, cette force pernicieuse qui attire les corps vers le
centre de la Terre.

La visite de la bibliothèque nous a laissés sur notre faim. Il faudra
y retourner demain ou après-demain. Affichée à la porte d'entrée, un
mot crayonné à la hâte sur une feuille de bloc-notes :
« Fermé. Cas de force majeure. Décès. »
« Pauvre madame Andrea, ai-je dit.
- Ce ne peut être la maman de Radoch, a protesté Maya. C'est
son écriture, je la reconnais. Elle n'aurait pas pu annoncer sa propre
mort. »
Le 16 mai
Divorcée du père de Radoch depuis belle lurette, madame Andrea
se vêt toujours d'habits de deuil comme une veuve. Ensevelie sous la
montagne de livres posés sur son bureau, en face de l'entrée, coiffée
d'un bonnet de fourrure à longueur d'année, elle ressemble à une taupe.
Je suis très content de la retrouver vivante, bien que Maya m'ait assuré
hier avoir reconnu son écriture.
« Cas de force majeure. Décès ! »
Un noir pressentiment m’étreint...
Elle est au téléphone, à moitié cachée par deux piles de livres.
C'est la première fois que je la vois sans ses petites lunettes. Ses yeux
délavés et larmoyants pareils à ceux des aveugles nous traversent sans
nous reconnaître.
« Oui... chuchote-t-elle dans le combiné. Oui... Oui... »
Chaque oui qu'elle énonce veut dire non, chaque oui prononcé
d'une voix grêle enfonce de plus en plus sa tête dans ses épaules
tremblantes.
« Oui, mon amour, à demain, dit-elle, et elle raccroche.
- Radoch ? lâche Maya, sachant que madame Andrea s'adresse
souvent à son fils cadet en utilisant ce “mon amour” mi-tendre, mi-badin.
- Non, chuchote la petite femme en habits de deuil. C'était son
frère aîné. Radoch n'est plus de ce monde. Il va être incinéré à Trieste
et emporté aux Amériques. Ainsi, il demeurera à jamais au pays de
Moby Dick, comme il l'a si ardemment désiré. »
Pétrifiés, nous écoutons le bref récit de la tragédie.
La tête orientée à l'est pour faire ses adieux à son enfance et à la
colline de Topchider, notre ami Radoch ne pouvait deviner que le wagon

serait raccordé en sens inverse et que le grand froid de la nuit suivante
abaisserait la température de sa tête au point de la geler. Les jambes
pointées vers la locomotive, Zorko a débarqué à Trieste souffrant
d'engelures mais vivant. En attendant qu’il sorte de l'hôpital pour pouvoir
l'emmener au Canada, comme convenu, Nicolas s'occupera de
l'incinération de son malheureux petit frère.
« Au pays de Moby Dick... répète madame Andrea d'une petite
voix, comme une boîte à musique au ressort brisé. Au pays de Moby
Dick... »
De retour dans la cave de Tchaslav, muets, nous le regardons
ouvrir sa grotte pour en sortir un très vieux phonographe avec une corne
en bois. Prudemment, il tourne sa manivelle pour retendre le ressort
spiral et charge un disque soixante-dix-huit tours.
Avant de le mettre en marche, il nous explique :
« Nous allons rendre hommage à la courageuse madame Andrea
et les derniers honneurs à notre Radoch. Pour ce faire, nous allons
écouter Stabat Mater, du célèbre Pergolèse, qui a transporté plusieurs
fois ma mamie au neuvième ciel.
- On dit au septième ciel, le corrige Maya.
- Les Russes montent au neuvième, tranche Tchaslav.
- O. K., montons-y, dit Maya. Que veut dire Stabat ?
- Ça signifie “debout, la mère était debout”. Ce chant retrace les
douleurs de la mère du Christ. Nous allons le dédier à madame Andrea.
- Chacun devrait apporter sa contribution à cette cérémonie, dit
Maya. Radoch était une partie de nous. Toi, tu t’occupes de la musique ;
et moi je lirai un petit fragment d'un livre qu'il admirait, Le Journal d'un
fou, de Gogol.
- Radoch n'était pas fou, sourcille Tchaslav.
- Il était fou de l'Amérique, précise Maya.
- Je voudrais moi aussi apporter ma contribution, dis-je. Je
voudrais réciter un poème.
- De qui ?
- De vingt-quatre grands poètes français.
- Soit ! » dit Tchaslav et il met en marche la tête de son
phonographe.
Le crépitement et les gémissements du vieux disque sont vite
noyés sous des sons merveilleux, qui n'existent pas sur la Terre, une

sorte de magma céleste tourbillonnant dans l'infini, que seule la musique
peut dépeindre. Puis peu à peu émerge une voix qui ne peut être que
celle d’une divinité, une voix de femme et son écho sublime, la voix de
la mère de tous les humains.
« Tu avais parfaitement raison, murmure Maya les yeux fermés.
Ce n'est pas le septième, mais le neuvième ciel. »
Un sourire attendri sur les lèvres, Tchaslav garde aussi les yeux
fermés. J'en profite pour palper le flacon de Maminka, pendu à mon cou
depuis plusieurs mois, depuis que je l'ai trouvé dans la salle d'eau de
Loudmila. Je le sors de dessous ma chemise, j'enlève son capuchon et
je hume ses senteurs angéliques. Le flacon est vide, mais son parfum
est toujours présent, comme défiant la mort et la fuite du temps.
Bouleversé et soudain très fier, je reconnais dans ces voix divines
le timbre de Maminka. Enfin, j'ai retrouvé ma maman fugitive dans la
mère de tous les hommes.
La voix de Maya, étranglée par l'émotion, me fait sursauter. Elle lit
le texte de Gogol, que je connais par cœur :
« ”Est-ce ma maison, cette tache bleue dans le lointain ? Est-ce
ma mère qui est assise devant la fenêtre ? Maman ! Sauve ton
malheureux fils ! Laisse tomber une petite larme sur sa tête douloureuse
! Regarde comme on le tourmente ! Serre le pauvre orphelin contre ta
poitrine ! Il n'a pas sa place sur la Terre !”... »
La voix de Maya s’interrompant dans un sanglot, j'enchaîne avec
mon bouquet de vers, Prends garde, enfant :
« “Et quand il croit serrer son bonheur il le broie.
Il fait noir, enfant, voleur d'étincelles !
Oisive jeunesse à tout asservie,
Prends garde à la douceur des choses.
Mais viendra le jour des adieux,
Quand tu aimes il faut partir.
Il me reste d'être l'ombre parmi les ombres.” »
Maya et Tchaslav, frottant leurs yeux pleins de larmes, me
regardent comme s'ils me voyaient pour la première fois. Leur visage
change, s'éveille, prenant un éclat inaccoutumé.
« Voleurs d'étincelles ! dit Tchaslav. Voleurs de feu !
- Quand tu aimes, il faut partir », murmure Maya.
Elle nous embrasse tous les deux sur les joues, la joue gauche,
puis la droite et encore la gauche. Ensuite elle s'en va, les épaules

fuyantes, sans se retourner. Elle sort de notre vie de même qu'elle y
était entrée, sur la pointe des pieds.
« Il nous reste d'être l'ombre parmi les ombres », dis-je.
Sous le signe du Cheval
Le 5 mai
Autant en emporte le vent ! Rien ne restera de notre bel âge, tout
sera entraîné par les remous impétueux de la vie !
Le dernier acte a commencé le 21 mars, premier jour du
printemps. Papa m’a surpris tandis que je sortais de notre buanderie
avec une bouteille remplie de son vin jaune.
« Tu t'es mis à boire. À ton âge ?
- Non, père, c'est un cadeau pour Tchaslav.
- Alors c'est ton meilleur ami qui caresse la bouteille !
- C'est pour fêter son anniversaire.
- Les anniversaires ne sont qu’un prétexte pour s'adonner à de
mauvais penchants.
- Les anniversaires doivent être respectés, mon cher père, ceux
des vivants et ceux des morts !... »
Ce fut le prélude d'une terrible altercation, la première et, j'espère,
la dernière de notre vie, de cette boule de « neige noire » qui finira par
tout ravager sur son passage, au numéro un, rue de Septembre.
« Tu as déjà levé le coude, espèce de soûlard ! Mon fils un ivrogne
! me crache-t-il à la face, en reniflant l'odeur d'une gorgée de vin que j'ai
déjà bue.
- C'est pour m'endormir, père, lorsque vous recevez cette chèvre
de Loudmila dans votre chambre à coucher !
- Comment oses-tu, face de rat ! s'écrie-t-il, en montant sur ses
grands chevaux. C'est comme ça que tu parles de ce cœur d'or qui a
remplacé ta mère, de cette bonne âme que je devrais épouser pour la
remercier de tout ce qu'elle a fait pour nous !
- Pour nous ou pour vous, père ? Elle n’a jamais remplacé ma
mère, rien ne peut remplacer la présence de Maminka, que vous
voudriez oublier, que vous m'avez enlevée, dont vous m'avez volé la
mort et le deuil ! Si vous prenez cette femme en mariage, vous ne me
verrez plus !

- Comment oses-tu ! gargouille-t-il dans le feu de la colère. Face
de petit rat ! » crache-t-il entre deux râles.
Je sors du jardin en courant.
J’ai passé deux nuits dans la grotte de Tchaslav. Il a bien fait de
prendre des précautions, d'en obstruer l’entrée avec la grande armoire,
comme s'il pressentait que Loudmila se rendrait dans sa cave dès le
lendemain matin, guidée par sa grand-mère. Ignorant l'existence de la
grotte, elles ne m'ont pas trouvé. Tandis que j’écoutais leurs voix
étouffées de l'autre côté de l'armoire, j'ai pu apprendre que papa était
fou d'inquiétude, qu’il craignait que son fils unique n'emboîte le pas à sa
pauvre mère.
« Qu'il crève d'inquiétude, ai-je dit à Tchaslav après leur départ.
Qu'il casse sa pipe.
- La plupart des pères veufs sont maladroits comme des éléphants
dans un magasin de porcelaine, a-t-il répondu. Mais cela ne veut pas
dire pour autant qu'ils ne nous aiment pas. La tendresse paternelle bride
souvent son cheval par la queue.
- Qu'il ne crève pas », ai-je dit en rougissant.
Puis, honteux, je me suis tu.
Le matin suivant, Loudmila est revenue accompagnée de Mme
Karpov. Tremblant comme une feuille, l'oreille collée contre l'armoire, je
les ai de nouveau écoutées.
Elles ont supplié Tchaslav de me retrouver, papa avait été victime
d'une nouvelle congestion cérébrale. La veille, au début de l'après-midi,
il s'était retiré dans sa chambre pour se reposer, lui qui n'avait jamais
fait de sieste. Beaucoup plus tard, à l’heure du dîner, Loudmila est allée
voir et l'a retrouvé sans connaissance dans son lit, en bien piteux état,
gisant dans ses propres excréments. Paralysé du côté gauche, il a été
hospitalisé à la polyclinique du quartier, débordant de malades.
Sitôt que Loudmila et Mme Karpov sont parties, Tchaslav a ouvert
la grotte.
« Seigneur, qu'il ne crève pas ! ai-je dit. Seigneur !... »
Nous nous retrouvons face à face dans la salle des malades du
centre hospitalier, où il a été transporté faute de lits libres à la
polyclinique. Alors qu’on l’y conduisait, il allait déjà un peu mieux. Hélas
! entre les deux établissements, les vitres de l’ambulance étant restées
imprudemment ouvertes, il a contracté une inflammation du poumon.
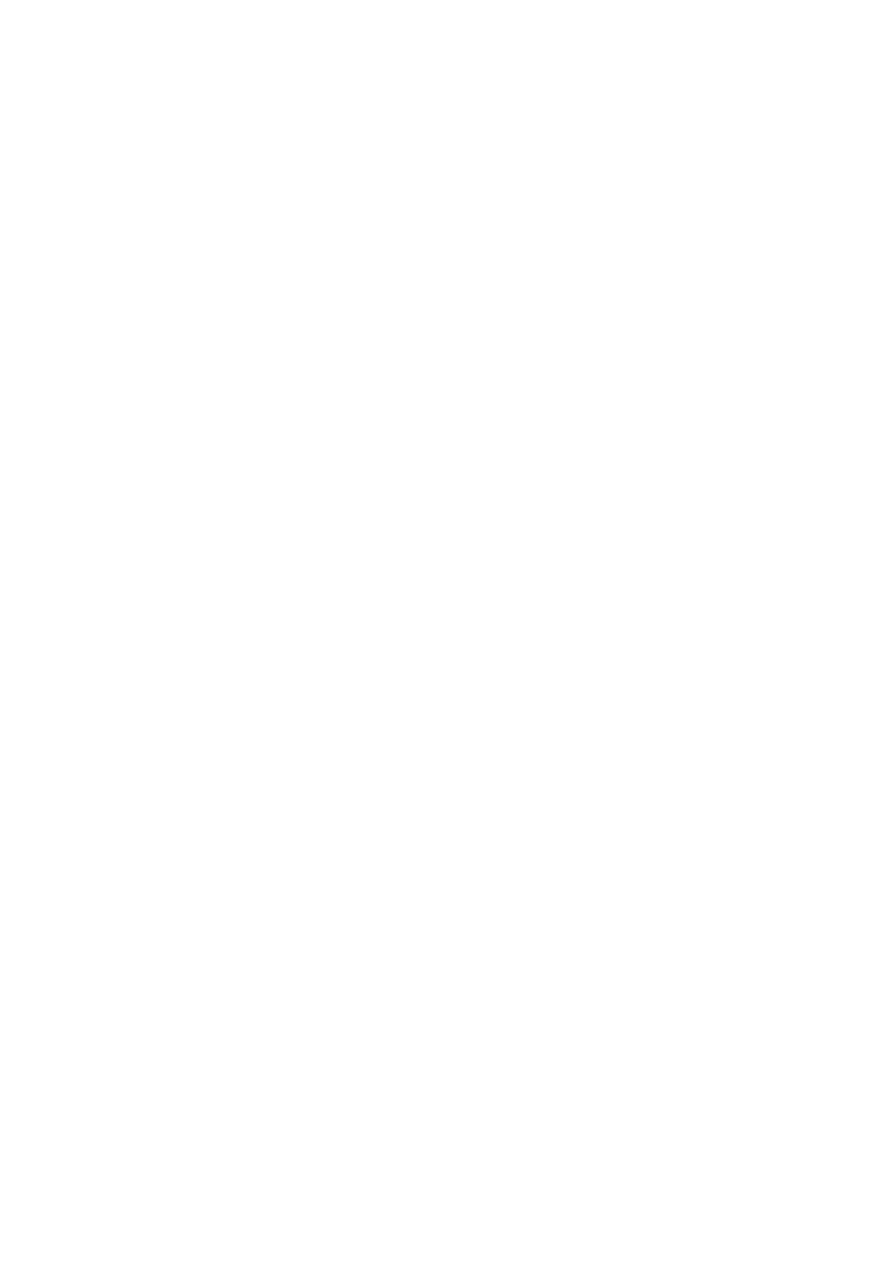
Isolé du reste de la salle derrière un paravent, relié à un poumon d'acier,
il est depuis trois jours à la merci d’un système de respiration artificielle.
Il lutte avec acharnement pour chaque bouffée d'air.
Sous le masque transparent qui lui couvre la bouche et le nez, sa
respiration se fait striduleuse, ses aspirations brusques, entrecoupées
de hoquets et de sanglots, ainsi que ses expirations, suivies d’accès de
toux et de brefs étranglements. En quarante-huit heures, il a vieilli de
vingt ans. Ses lèvres béantes laissent apparaître une langue d'un blanc
jaunâtre, une langue qui claque d'une manière atroce au fond de cette
bouche édentée. En moins de trois jours, il a perdu presque toutes ses
dents de devant.
Des mots idiots roulent dans ma tête, des synonymes du verbe
détériorer, trouvés dans son Petit Larousse :
« Papa s'est abîmé, la rouille abîme le fer. Papa s'est détraqué
comme une horloge, papa se dégrade, après avoir subi des dommages
irréparables dans tout le corps... »
Sa petite main pleine de crevasses repose dans la mienne. Il me
semble qu'elle répond par une légère pression à la mienne. Seuls ses
yeux enfoncés gardent encore une faible lueur de vie, seuls leurs iris
décolorés peuvent encore me transmettre ses pensées. L'ombre d'un
sourire soumis se dessine au creux de ses joues, un sourire martyr à
peine esquissé, mais qui me fait comprendre ce qu'il a dans le ventre :
« Pardonne-moi cet état humiliant, me dit-il en gardant le silence.
J'ai honte de cette terrible déchéance. Il faut y mettre fin, mon Marie-
Loup... »
J’effleure sa main en signe de consentement.
Il me remercie d'un clignement d'œil : le père maladroit et son fils
rebelle sont réconciliés à jamais. Nous sommes enfin délivrés de nos
jougs : lui, craignant la douleur et la mort, de sa lâcheté ; moi, de mon
enfance meurtrie et intransigeante.
Une nouvelle quinte de toux l'éloigne de moi, il franchit un seuil
invisible, celui qui sépare les vivants des mourants.
La gorge nouée, les yeux embués, j'aperçois derrière moi une
jeune femme en manteau blanc. Une plaquette épinglée sur sa poitrine
me fait sursauter : Dr Lecco !

« Oui, Mio, me dit-elle en s'approchant et en posant ses mains sur
mes épaules. Mon premier boulot, me murmure-t-elle à l'oreille. Depuis
deux jours, je m'occupe de l'infortuné monsieur Janvier.
- Merci infiniment, dis-je. Quelle est votre décision ?
- C'est à toi de décider, Mio, me susurre-t-elle. Quoique tu ne sois
pas encore majeur...
- Un autre traitement pourrait-il... ?
- Non. Il ne lui reste que la souffrance. Pourtant, il suffirait
d'enlever son masque pour... »
Je baisse les yeux une dernière fois vers papa, agonisant,
pantelant, s’étranglant à nouveau, le visage empourpré sous son
masque, dont la base et le tuyau en caoutchouc brun ressemblent
étrangement à une sorte de pipe renversée.
Machinalement, je touche mon cou à l'endroit où je ressens un
petit picotement. C'est la glande héritée de Maminka qui s'est mise
soudain à sécréter sa goutte glaireuse insipide et inodore. Est-ce
Maminka qui m'envoie un message, est-ce elle qui lui souhaite la
bienvenue ?...
« Soit ! dis-je à Mlle Lecco, en lâchant la main flasque de papa, qui
glisse sur sa poitrine.
Ce mot à peine audible résonne dans mon crâne comme un coup
de tonnerre, le coup de grâce assené à papa.
« Sors », m'ordonne Mlle Lecco.
Le dernier acte
Oui, voici l’acte ultime de notre jeunesse, de cet âge nubile chargé
de bâcler à tort et à travers les adultes, futurs esclaves de nos maux. Ce
sera aussi le post-scriptum de mon journal. Je n’y écrirai plus. Au
moment où j'ai cassé la pipe de papa, quelque chose se brisait en moi.
Définitivement. Je ne serai jamais écrivain. À quoi bon avancer à tâtons
derrière une vie sans limites en s’efforçant en vain d'égaler sa plume
toute-puissante ?
Avant de quitter la dernière chambre, où je suis allé chercher mes
reliques, j'ai sorti tout le contenu d'une mallette de Maminka : son flacon
parisien, Le Livre de ma vie, le Petit Larousse, mes dictionnaires et un
marron desséché mais toujours lustré, couleur de la mort. La tête vide,
autant que le cœur, j'ai remarqué que tous les tableaux de la collection

de papa s'étaient volatilisés, vendus sans doute pour couvrir les frais de
deux maladies et de deux obsèques.
Le cimetière de Toptchider n'a jamais été aussi beau
qu'aujourd'hui, jour de l’enterrement de papa. Comme par miracle, les
ailes de la brise nous ont apporté en offrande de nombreux flocons
blancs arrachés aux Six Peupliers, qui, papillonnant autour de nous, ont
décidé de se jouer de nos cheveux soigneusement peignés pour la
cérémonie, si tant est que notre petite « file indienne » mérite un mot
aussi pompeux.
Je marche en tête, suivi par tante Milena, Mlle Leco, Loudmila et
Tchaslav. Mlle Lecco est très enrhumée et n'arrive qu'à grand-peine à
retenir ses éternuements. L'air est humide après la grosse pluie de la
nuit précédente, et l'une des prothèses de Tchaslav grince tous les deux
pas. Pour dissimuler ses mains couvertes de phlegmons, tante Milena
porte son manchon en astrakan, cadeau de mariage d'oncle Edouard.
Quant à Loudmila, elle est chargée de cette même petite valise en
carton avec laquelle elle était venue chez nous il y a dix-sept ans. Ne
voulant plus continuer à vivre aux côtés d'un garçon ingrat, elle se
rendra à la gare juste après l'enterrement et retournera dans son pays
pour toujours. Tante Milena, qui a déjà emménagé chez nous,
s'occupera de moi jusqu'à ma majorité, puis nous vendrons notre
maison et je partirai pour la France, chez une amie de Maminka, la
généreuse Mme d'Alembert.
À hauteur de la deuxième parcelle, je tourne à droite et me dirige
vers notre tombeau, demeure éternelle de Maminka. Une pensée me
poursuit : son geste désespéré n’a-t-il pas déclenché notre boule de
neige noire ? Le suicide n'est-il pas un crime contre la nature ? comme
l'affirmait Radoch. Il nous assurait même qu'en Amérique on risquait
trois ans de prison ferme si on se tuait.
L’employé des pompes funèbres, un petit bonhomme blafard, est
déjà là avec l'urne de papa, qu'il tient sous son aisselle à la manière
dont on porte un pain rond. C'est un vase cylindrique en bronze aussi
modeste et insignifiant que celui d'oncle Edouard.
Un sentiment d'amertume et de révolte m'envahit subitement. Tout
comme ma cachette et la mallette de Maminka, la valise en carton de
Loudmila, le manchon de tante Milena ou les prothèses grinçantes de
Tchaslav, l'urne de papa ne referme que la vacuité de notre destin sans
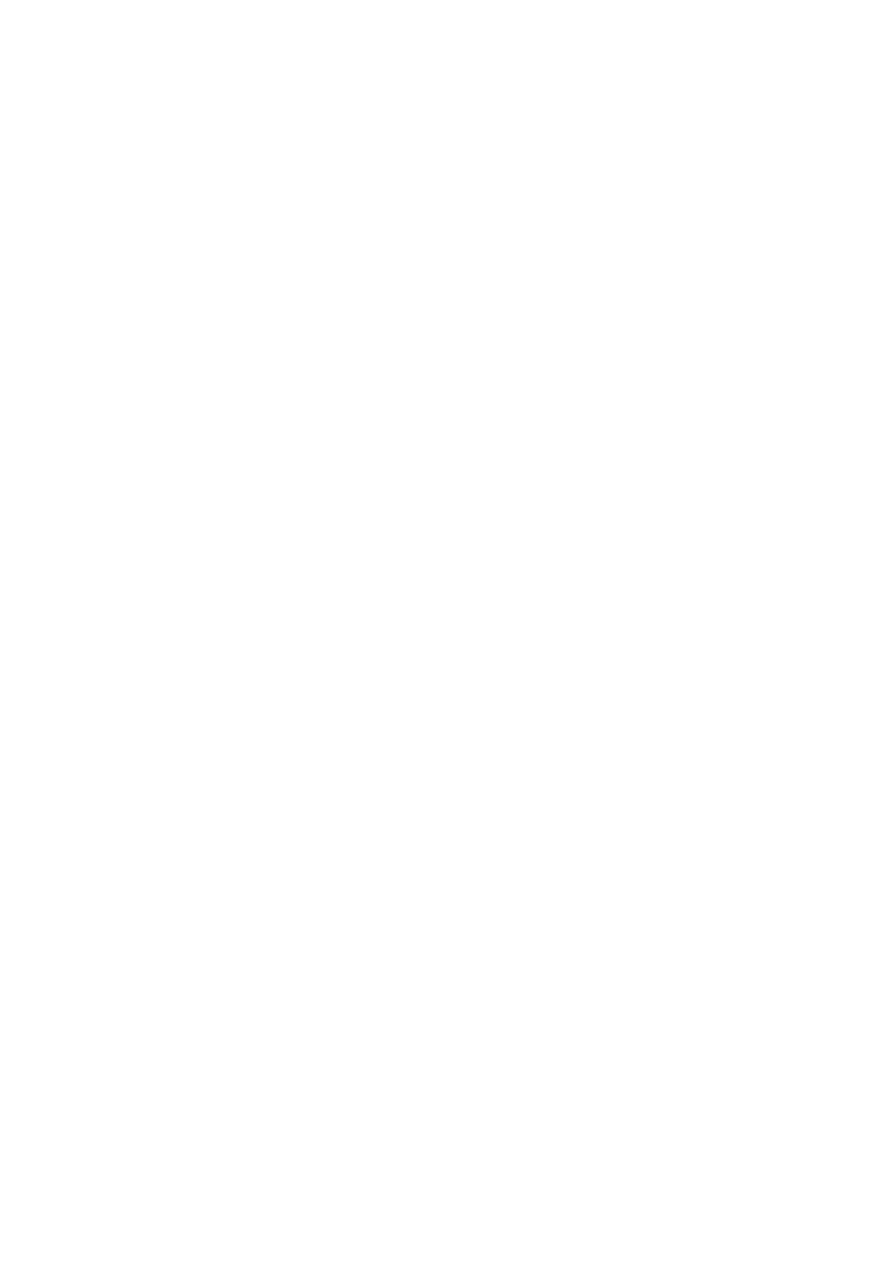
merci. Naître, être, connaître, rêver, aimer, fêter, forcer, foncer... pour
finir dans une piètre boîte, mot que mon dictionnaire définit comme un «
réceptacle plus ou moins petit, généralement portatif, à usages multiples
: boîte à chapeaux, boîte à ordures... » C'est peu encourageant pour un
garçon au seuil de la vie, qui craint comme la peste le lourd fardeau de
l'âge mûr.
Tandis que je tiens papa (aussi léger qu'oncle Edouard) sous mon
bras pendant que le croque-mort aère notre caveau, je m’aperçois qu’il
a fait une chose inadmissible : il a posé la croix de papa non pas près
de Maminka, mais à côté d'oncle Edouard. Je corrige cette erreur :
dorénavant et jusqu'à la fin des temps, ils seront ensemble, comme lors
de leurs déjeuners carnivores du dimanche.
Une fois tante Milena et Loudmila parties en pleurant, Tchaslav
m'aide à disposer les fleurs de papa au pied des trois croix. Une jeune
femme coiffée d'un grand chapeau de paille, son enfant dans une
poussette, nous contemple tranquillement par-dessus une haie de buis.
Nous la reconnaissons enfin et nous nous approchons, n'en croyant pas
nos yeux.
C'est Maya avec un bébé !
« Salut, mes petits pères ! » nous dit-elle.
Tchaslav se penche vers la poussette.
« Beau gosse, dit-il. À qui est-il ?
- Il est à vous », réplique Maya souriante.
Bouche bée, nous échangeons un regard affolé.
« Il est à vous tous, à tous les quatre, dit Maya.
- Comment un enfant peut-il être issu... de quatre hommes à la
fois ? bégaie Tchaslav.
- Bien sûr que non. Comme j’ignore qui est son vrai papa, j'ai
décidé de vous rendre responsables tous les quatre. Je vous avais bien
avertis de faire attention.
- Il te ressemble, remarque Tchaslav. Regarde ses yeux.
- C’est plutôt à toi qu’il ressemble, dis-je du tac au tac. Regarde
ses oreilles. »
Maya finit par trancher :
« Ne vous en faites pas, mes petits pères. Son papa légitime sera
notre Radoch, c’est le seul à ne pas pouvoir nier, et madame Andrea l’a
déjà reconnu. Aussi, mon bébé porte son nom. Nous avons déjà
emménagé chez madame Andrea, à sa demande, elle est ravie de la

présence de son petit-fils. Zorko, son parrain, nous a envoyé de Québec
l'argent pour acheter la poussette du petit Radoch.
- Est-ce possible ? Il s'appelle Radoch ! » lâchons-nous,
émerveillés.
Maya nous prend sous le bras et nous poussons ensemble la
voiture d'enfant vers la sortie du cimetière. Le petit Radoch agite ses
mains potelées en essayant d'attraper les flocons des peupliers qui
voltigent autour de lui. Il rit et babille, en observant les fleurs blanches
se poser sur nos cheveux. Un nouvel orage de printemps s’annonce.
Les cimes des arbres nous font la révérence, à nous, garçons boiteux,
comme si nous étions des têtes couronnées.
« Merci pour votre lettre, nous dit Maya. J'ai lu ton Vieil Homme et
la mer, Tchaslav. Et j'ai appris par cœur ton bouquet de vers, Mio, ton
Prends garde, enfant.
Bras dessus, bras dessous, nous quittons le champ des morts,
pendant qu'elle nous récite d’une voix claire :
« “Mon beau navire ô ma mémoire,
J'ai plus de souvenirs que si j'avais mille ans.
À mes pieds c'est la nuit, le silence.
Le vent se lève !... Il faut tenter de vivre !”... »
Fin de mon journal

DERNIER ACTE
Bien qu'ayant eu un petit malaise vers minuit, j'ai réussi à terminer
les trois derniers paragraphes du journal. Quel coup de théâtre que
l'apparition de ce « petit Radoch » sur la triste scène de ce cimetière !
Quelle promesse que cette vie nouvelle dans ce sinistre théâtre
d'ombres ! Pourtant, je n’ai guère eu le temps de m’attendrir, comptant
les années écoulées depuis cet heureux moment. Hélas ! l’enfant qui
agitait ses bras dans la poussette de sa jeune mère, ce petit garçon, s'il
est toujours vivant, doit avoir aujourd'hui la cinquantaine.
Sa vie, ma vie ou bien la vie de n’importe quel petit cheval
éphémère d’un conte de fées pourrait être racontée en cinq ou six
lignes. « Une fourmi périt le jour où elle acquiert des ailes », disait l'un
de mes proches parents. C'est pour cette raison que je n’ai jamais pu
tirer du désert de la page blanche plus de quelques pitoyables mots,
bien que j’aie caressé l’idée de faire de l’écriture mon métier. Quant au
Gamin, cet adolescent insatiable que j'ai surnommé Petit Tyran et qui
rêvait de devenir homme de lettres, il a été écrivain sans le savoir,
cessant de l'être le jour où sa vengeance s’est accomplie, à la mort de
son père. Ne souffrant plus, il ne pouvait plus écrire, contrairement à
moi, qui n'ai jamais été capable d’aligner deux phrases si je n’étais pas
heureux.
Chose étonnante, je regrette que le petit Radoch ait vieilli mais ne
pleure pas ma propre déchéance. Car cette fourmi dont parlait mon
parent, ailée au soir de sa vie, n'est personne d'autre que moi, qui
survole à présent un passé révolu. Depuis quelque temps, je sens
éclore en moi une sorte de fleur empoisonnée et je me doute bien que
c’est la mort qui naît. Ce voyage sans retour, ce vieillissement sourd à
toutes nos prières de nous épargner, nous conduit, impitoyable, à
l'humiliation suprême : se savoir encore en vie bien que, fait navrant, on
ait dépensé tout son temps. La seule chose qui me consolerait serait

l'apparition miraculeuse du petit Radoch, cet enfant prodige, né de
quatre pères et d'une sorte d'Immaculée Conception.
Je l'imagine tirer la cloche, à l'entrée du domaine. Et la cloche
sonne pour de bon. Byzance lève son museau du Petit Larousse et
pousse un grondement. Le cœur battant, je me précipite vers la fenêtre.
Le clair de lune sur les congères me laisse entrevoir quatre ou cinq
ombres fugitives près de la porte cochère : c'est encore la bande de
Molo, qui ne cesse de rôder autour du chalet.
Sur un drôle d'engin, une sorte de side-car, de motocyclette
accouplée à une nacelle, ils quittent la vallée pour passer leur soirée ici
deux ou trois fois par semaine. Leur partie de billard à l'Auberge du Roi
me pèse de plus en plus, quoiqu'ils ne m'agressent plus directement.
Néanmoins, je me méfie d'eux et je me tiens sur mes gardes, car leur
présence ne présage rien de bon. Après avoir été absente une dizaine
de jours, la jeune fille enceinte a réapparu accompagnée de son soi-
disant frère et des trois autres voyous. Je n'ai guère été surpris de la
voir avec un sac à dos pendu sur la poitrine abritant un nouveau
membre de leur bande, un bambin à grosse tête ovoïde, qu'elle allaite
sans pudeur, entre deux coups de batte de base-ball, sur le bord même
de la table de billard. Pendant ce temps, le faux blond lape sa bière en
tirant la langue comme un chien et choque sa chope contre celle de ses
compagnons, tout en jetant un œil de renard sur ma table, au fond de la
salle.
Je suis vraiment un homme chanceux. J’ai de la chance d'avoir
toujours bon pied, bon œil, malgré quelques soucis avec mes dents. Je
n'ai jamais connu de rage de dents avant ce Noël, où une incisive cariée
m'a fait passer plusieurs nuits blanches. Faute d’avoir la sécurité sociale
et de l'argent pour payer un dentiste, j'ai dû recourir à un remède
pratiqué jadis par les paysans pauvres de mon ex-pays.
Le remède en question : une simple ficelle de cuisine d'une
longueur d'environ un mètre, dont les deux bouts sont solidement
attachés d’un côté à la dent gâtée et de l’autre à la trappe grande
ouverte de la cave de mon défunt maître. Sitôt décidé, sitôt mis en
œuvre. Jambes écartées, la bouche béante et les yeux mi-fermés, j'ai
compté jusqu'à cinq avant de claquer la porte à tour de bras. Une
douleur fulgurante m'a jeté sur les genoux. À ma grande surprise, j’ai
découvert dans la flaque de sang deux dents au lieu d'une, une incisive
et une canine attaquées par le même abcès.

Le matin suivant, brûlant de fièvre, je suis arrivé à l'écurie de M.
Pétré avec une demi-heure de retard. Après avoir nettoyé la stalle du
vieux Paul, je me suis senti mal et j’ai perdu connaissance.
Heureusement, une heure plus tard, M. Pétré m'a trouvé dans la paille
des poneys, en piteux état, le visage enfoncé dans un tas de crottin.
Compatissant et charitable, il m'a forcé à avaler deux gélules d'un
antibiotique et deux calmants, des médicaments qui traînaient chez lui
depuis le décès de sa « seconde regrettée ».
Ayant recouvré mes forces, je me suis remis au travail dans
l’écurie, résolu à accomplir ma tâche quotidienne. J'ai ramassé les
excréments de Jean, Pierre et Paul, j'ai changé leur litière et me suis
occupé de leurs mangeoire et abreuvoir pour que Byzance gagne
honnêtement son escalope du soir. Visiblement surpris, les trois petits
landais débonnaires ont reniflé avec joie leur odeur sur mon visage
comme s'ils étaient en présence d'un quatrième cheval. Une fois ma
besogne achevée, je me suis empressé de rentrer au chalet pour
prendre une douche, hélas ! glaciale, étant donné que la veille de Noël
notre chauffage était tombé en panne de combustible.
Depuis lors, c’est ce qui me cause le plus de tracas. Le chalet se
refroidit chaque jour davantage, surtout les pièces orientées vers la
chaîne du Mont-Blanc, le salon et le grand séjour, qui abrite toujours les
deux philodendrons grimpants de Mme Canac. L'air piquant qui y règne
fait beaucoup souffrir les pauvres plantes. Elles ne croissent plus et leur
feuillage luxuriant est devenu terne. La petite, faible et fragile, est
encore assez bien portante : les pots fêlés durent le plus. La plus
grande, celle qui avait presque atteint la porte vitrée de la terrasse,
montre des signes inquiétants : la chute prochaine de ses feuilles. Sa
nudité et son air chétif m'ont empêché la semaine passée de la
photographier et d'envoyer cette preuve de sa bonne santé à la veuve
de mon maître.
J’ai au moins trois bonnes raisons à avancer : la voiture n’étant
plus en état de marche, je ne peux descendre dans la vallée pour y
acheter une pellicule ; je n'ai plus d'argent pour payer les frais d'envoi ;
et puis, hospitalisée à Biarritz pour une congestion cérébrale, aveugle et
paralysée, Mme Canac ne pourra de toute façon pas profiter de mes
photos. Outre cette maladie, une courte lettre de l'une de ses petites-
nièces m'annonce que le chalet sera vendu dès que la vieille dame se

sera présentée devant Dieu, et que ses biens, meubles et immeubles,
seront partagés entre ses descendants.
Ce courrier m'a débarrassé d'une partie de mon fardeau :
connaissant la vitalité de la pétulante Mme Canac ainsi que la lenteur de
la justice, j'en ai conclu que je pouvais dormir du sommeil du juste au
moins jusqu'à la fonte des neiges.
Une fonte des neiges qui ne me réjouit point depuis mes
fiançailles avec la montagne, moi, admirateur de la Méditerranée, qui
me suis épris de cette mer de pierre dressée, de l’onde de cet océan
pétrifié, de ses flots rocheux plantés dans le ciel pour l'éternité. Car,
dans leur redoutable grandeur, haute mer en furie et haute montagne
tempétueuse portent en elles le même besoin de changement, cette
lame de fond dont les entrailles renferment le secret de la naissance et
de la fin du monde.
L'automne dernier, assis avec Byzance près du panier où les
randonneurs déposent parfois les restes de leur casse-croûte, j'ai
entendu un petit vieux, revenant tout essoufflé de la pointe de Marcelly,
s’exclamer : « Quand tu as atteint le sommet de la montagne, continue à
grimper, mon ami ! » Quel beau conseil à tous ceux qui sont à bout de
souffle, une leçon que je prends au pied de la lettre et à laquelle j’essaie
de me conformer lors de mes promenades avec Byzance, surtout les
jours où notre humeur nous guide vers les Lions de faïence.
Quand nous nous arrêtons, mon regard continue à grimper vers
deux énormes rochers, au sommet de la chaîne ouest qui entoure le
Praz-de-Lys. Insignifiants et peu visibles en été, les deux géants qui
dominent la falaise escarpée se transforment sous la neige en profils de
lions, un mâle et une femelle, qui se regardent en chiens de faïence par-
dessus un précipice, avec la même hostilité que les deux dogues de
terre émaillée reposant sur la cheminée de notre séjour. Aussi, les ai-je
surnommés Lions de faïence. Bizarrement, c'est devant eux et non pas
en face du mont Blanc que je pénètre l’âme véritable de la haute
montagne.
En hiver, nulle part la montagne ne ressemble plus qu’ici à une
mer tumultueuse. Si les bottes empruntées à mon défunt maître
n'étaient pas un peu justes pour mes pieds et ne m'engourdissaient pas
les orteils, je passerais des heures entières devant mon couple de lions
à admirer leur vol impétueux à travers les nuages. À vrai dire, ce sont
plutôt les nuages qui nous survolent à tire-d'aile, engloutissant les
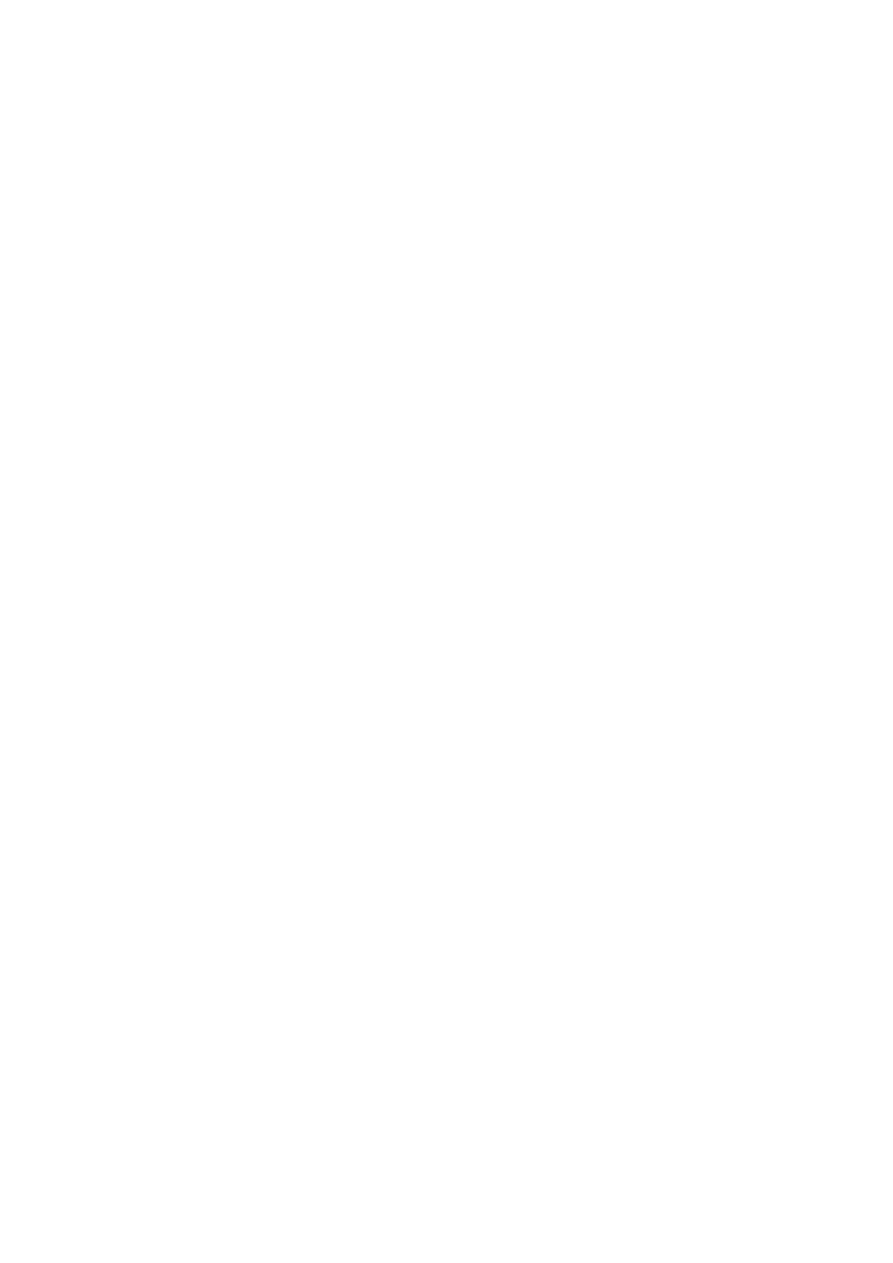
crêtes tels des oiseaux de proie géants. Ils me donnent le vertige et
créent une vraie confusion dans mon esprit, comme si je descendais de
la planète en plein vol, comme si je sautais du marchepied d'un tramway
céleste. Atteindre le sommet et continuer à grimper m'enivre à un point
tel que je sens naître en moi une sorte de troisième œil, qui me sort de
ce cours d'eau boueuse où je me suis si longtemps noyé, pour me tirer
enfin sur la terre ferme, m’emplissant d'un sentiment d’exaltation
ineffable, qui me rend capable d'accomplir des choses grandioses, peut-
être même d'écrire le récit de ma vie.
_
Je ne cesse de travailler sur ma traduction du journal, de la
réviser, de la polir, de la ciseler. Les mots arrachés à leur nid de guêpes
continuent à me mettre au supplice, surtout tard dans la soirée, vers
minuit, quand je prends la liberté d'ajouter quelques passages au texte
du Gamin, que j'efface aussitôt, me répétant que ma tâche ne doit être
fondée que sur la plus grande délicatesse morale. J'ai même essayé de
rédiger la suite des souvenirs du Petit Tyran, une sorte d'épilogue
hypothétique, dont le héros principal aurait été le petit Radoch, seule
promesse d'un avenir favorable. Hélas ! ces tentatives avortées ont
redoublé mon angoisse devant le désert de la maudite page blanche, le
pire des martyres que j'aie jamais endurés.
Mon dernier espoir de faire émerger quoi que ce soit de ma tête
désespérément creuse était le flacon de porcelaine que j'avais retiré de
la mallette du Gamin. Ôtant son capuchon, les yeux fermés, j'ai senti
cette minuscule grotte de fées, profonde comme un abîme, qui m'a
toujours attiré comme pour m'engloutir. Doux et volatile, son parfum était
encore présent, cinquante printemps après la disparition de sa
propriétaire, mais il est resté muet, de même qu'une porte condamnée
interdisant à tous ceux qui en sont indignes de retourner vers le passé.
À moi en premier lieu, qui devrais me contenter d’un travail scrupuleux
de traducteur.
Toutefois, j’ai une consolation, et non des moindres. Transposer
dans une autre langue le récit du Gamin me fait endosser le rôle de sa
mère et celui de son père, comme si je l'engendrais de nouveau. Car
une langue, quelle qu'elle soit, est un moyen de respirer, et la vie dans
une nouvelle langue est presque une seconde existence. Ne pouvant

m'offrir par l’écriture cette fabuleuse résurrection, j’en fais cadeau au
Petit Tyran en le traduisant.
Je n'exercerai donc jamais le métier d'écrivain. J’ai baissé les
bras, la mort dans l'âme, n'ayant pour me disculper que l’obscurité qui a
envahi la maison après l'inexplicable coupure de courant. Nul doute
que, même sur son lit d'hôpital, Mme Canac a trouvé un nouveau moyen
de nous serrer la ceinture.
Après le gaz, c'est l'électricité ; après le froid, c'est le manque de
lumière qui gâche nos soirées. La pile de bois trouvée dans la cave est
presque épuisée. Au lieu de m'en servir pour allumer un feu de
cheminée une fois par semaine, je coupe les bûches en quatre afin de
nourrir le petit poêle de ma chambre, qui remplace le radiateur
électrique désormais inutilisable. Heureusement, M. Pétré m'a prêté sa
lampe à pétrole et offert un bidon de cinq litres de ce précieux
combustible en échange de quelques menus travaux dans sa grange.
Nous avons de la chance : non seulement sa lampe éclaire mon
secrétaire, mais elle nous chauffe depuis que le poêle a consumé notre
dernière bûche.
Un accident fâcheux m'a récemment presque fait sortir de mes
gonds, plus que toute autre infortune. Après avoir dîné avec Byzance
chez M. Pétré, j'ai croisé dans le vestibule la bande de Molo, les quatre
garçons et leur comparse, la jeune mère, tous ivres, dégageant la
répugnante odeur de leur bibine. En passant à côté de moi, le plus
jeune, le morveux aux oreilles pendantes, a vilement frappé Byzance
avec sa batte. Le glapissement de la pauvre chienne a fait pouffer de
rire ses vauriens d’amis, l'air fier comme s'ils venaient de commettre un
acte valeureux, le seul qui soit capable de satisfaire leur méchanceté.
À leur âge, nous avions de l'affection pour toutes sortes
d'animaux, nous nous y attachions, ce dont le Gamin témoigne dans son
cahier de souvenirs. Ces jeunes laissés-pour-compte qui courent les
rues d'aujourd'hui, ces garnements, ces vagabonds, ce gibier de
potence, futurs gens de sac et de corde, viennent au monde, dirait-on,
plus cruels que les enfants d’autrefois, aussi barbares que ce monde
l’est devenu. C'est pourquoi j'ai été effrayé, mais nullement surpris, de
les voir, l'automne dernier, tirer avec une arbalète des flèches sur un
écureuil à la magnifique queue touffue. Pour le transformer en un
hérisson ensanglanté aux piquants d'acier.

Leur air dédaigneux et leurs ricanements à l'entrée de l'auberge
n'étaient pas fortuits. Bien au contraire. De retour au chalet, j'ai
découvert des traces de pas le long de l'escalier menant à la terrasse, et
un carreau cassé au milieu de la porte vitrée. Heureusement, le
blindage, installé par M. Canac, a déjoué leur tentative de cambriolage.
Ensevelies sous une nouvelle neige abondante, l’empreinte de leurs
pieds ne valait plus un clou. Aussi ne m’est-il pas venu à l’esprit
d'informer la police, et je me suis empressé d'obstruer le carreau
manquant avec les moyens du bord, papier journal et ruban adhésif,
pour empêcher la poudreuse de se répandre sur les tapis et les meubles
du séjour.
Il était temps que je rentre : la bise, qui avait soufflé du nord tout
l'après-midi, se transformait en un vent glacial, accompagné de
tourbillons de neige. Une fine couche de cristaux couvrait déjà la table
de la salle à manger, le téléviseur et le vaisselier de Mme Canac. Une
semaine après cette première agression, bien que les fortes chutes de
neige aient persisté, la bande de Molo a repris ses activités criminelles.
Leur butin : deux nouveaux carreaux cassés. Malgré le froid de loup qui
sévit depuis lors dans la maison, un froid cuisant et pénétrant, je
parcours toutes les pièces deux fois par jour avec ma balayette, afin de
débarrasser les meubles de la gelée blanche qui les recouvre,
semblable aux stalagmites d’une grotte calcaire.
Je cherche à prolonger au maximum mes heures de service dans
l'écurie, dans la chaleur humide et odorante de la paille, près de Jean,
Pierre et Paul. Quand j’ai commencé ce travail de valet d'écurie, les
relents de leur urine et de leurs excréments me prenaient à la gorge,
mais peu à peu je m'y suis accoutumé et, depuis quelque temps, je les
trouve plutôt agréables. Dernièrement, j’ai passé une journée entière sur
la litière des poneys, au fond d'une de leurs stalles, en compagnie de
Byzance, qui se couche avec plaisir entre les sabots d'un landais, à
l'image de ses ancêtres, les schnauzers d'autrefois, compagnons des
chevaux de poste. Il arrive aussi que je m'installe près des poneys avec
le journal du Gamin et ma liasse de papier à musique, pour reprendre
ma traduction, la raboter, la limer. Son nid de guêpes linguistiques
ressuscite sans cesse de vieux mots oubliés de sa langue, tels qu'ils
étaient dans sa prime jeunesse, comme le verbe défier, si cher à cet
enfant prêt à affronter sans crainte la vie qui l'attend, à braver hardiment
ses dangers et à les narguer avec insolence. Un vrai guêpier pour

l'adulte qu'il allait devenir, l'homme mûr courbé sous le poids des désirs
d'un petit tyran.
Les exigences de cet adolescent à l'égard de son avenir me
semblent de plus en plus démesurées, tout comme son ambition
d’écrire, ses convoitises immodérées allant au-delà de ses réelles
possibilités. En cherchant les mots justes et les plus fidèles à ses
paroles, j’essaie en même temps de tempérer leur crudité enfantine.
Ce travail délicat devient franchement difficile sans mes lunettes,
détruites l'autre jour par le petit voyou de la bande de Molo. Se dirigeant
vers les toilettes, il a heurté comme par hasard ma table et fait tomber
mes verres stigmatiques, pour ensuite les écraser de sa botte ferrée. Ce
geste ignoble et prémédité a été salué dans une explosion de rires par
ses complices goguenards, ravis une fois de plus d'avoir assailli et
humilié un adulte. Leur cruauté vient de ce qu'ils n'ont aucun avenir, de
ce qu'ils refusent de mûrir dans un monde ou tout espoir a été tué dans
l'œuf. À la différence de mon Gamin d'autrefois, qui ignorait que l'homme
mûr allait le trahir, ces nouveaux petits tyrans le savent très bien. C'est
pourquoi ils infligent à ce traître d'homme la pire des peines, comme s'ils
repoussaient ainsi l’idée d’une soumission et d’une défaite futures.
Heureusement, j'ai pu de nouveau apprécier la gentillesse de M.
Pétré, qui m'a prêté les lunettes de sa « première regrettée », des verres
qui corrigent ma vue en partie, m'aidant à lire et à écrire, mais qui me
causent de légers maux de tête. Cet acte amical n’a pas été le dernier :
il m’a aussi tiré d’un piège mortel, grâce à l’intelligence de Byzance.
L’accident pendant lequel j'ai failli périr a eu lieu le lendemain de la
dernière agression des jeunes vauriens. À la fin de l'après-midi, alors
que je n'étais pas encore en possession de mes lunettes de substitution,
après ma visite quotidienne aux Lions de faïence, je m’empressais de
rentrer au chalet pour éviter la nouvelle chute de neige qui s'annonçait.
Je devais traverser le ravin qui nous sépare du bosquet dit Entre chien
et loup. Pour ne pas piétiner la belle piste de ski de fond qui longe le
bas d'un coteau, j'ai choisi un chemin de traverse où passent de
nombreux promeneurs avec leurs raquettes. Ne voyant rien, Byzance
tirant sur sa laisse, j'ai posé le pied en dehors du sentier et suis aussitôt
tombé dans une crevasse formée par le lit d’un torrent.

Enfoncé dans la neige jusqu'aux hanches dans la position
incommode d'un nain, je suis la proie sans défense des débordements
de tendresse de Byzance, qui adore lécher les oreilles de tout humain à
portée de son museau, enfant ou adulte. Au début, cette mésaventure
me paraît plus risible que grave, mais je me rends vite compte que je
continue à glisser doucement sous les amas de neige, semblables à des
flots gelés.
Ma situation empire. Je coule centimètre après centimètre, comme
dans des sables mouvants, et bientôt la congère qui est en train de
m'engloutir m’arrive au nombril. Sentant le sol se dérober sous mes
pieds, qui pédalent en vaine dans une sorte de bouillie, je me rappelle
la noyade du Gamin, les adieux qu'il a chuchotés au monde, comme
moi, soumis sans révolte au même sort. En dépit de cette résignation,
mon instinct de conservation me dicte autre chose. Je tiens toujours
fermement la laisse de Byzance, qui pourrait me sortir de cette
périlleuse posture.
« Tire, Bybi ! Tire, Bizou ! » lui dis-je en me servant de tendres
surnoms que son défunt maître employait.
Malheureusement, pour Byzance, c'est un jeu : pour les chiens, la
mort est aussi naturelle que la vie, grâce à quoi ils n'ont pas peur de
mourir.
Au lieu de tirer, elle s'approche pour enlever avec sa langue
quelques flocons de neige collés sur mes cils et sourcils. Elle me lèche
exactement comme si j'étais déjà mort de froid. C'est seulement alors
que je m'aperçois que la neige tombe, de gros flocons bruissant comme
des feuilles mortes dans un frou-frou de soie. Les alentours deviennent
encore plus irréels, le bosquet de sapins, d'un côté du ravin, et les
congères, en face, derrières lesquelles, à trois cents mètres, j'entrevois
un bout de toit et la cheminée de l'Auberge du Roi.
Si j’appelais au secours, ce serait peine perdue, personne ne
m'entendrait, surtout pas M. Pétré, un peu dur d'oreille. Je lâche la
poignée de la laisse et je pose mes avant-bras jusqu’aux coudes sur la
neige, comme sur une bouée de sauvetage. Le cordon s’étant
rembobiné dans la poignée, celle-ci se trouve maintenant trop loin, aux
pieds de Byzance, assise sur son arrière-train. Elle m'observe avec
attention sous sa mèche, comme si elle voulait savoir quelle attitude
j’adopterai au seuil de la mort, puis elle secoue la neige de son garrot,

me tourne le dos, s'éloigne et disparaît dans des haillons de nuages
rasant le sol.
Seul ! Aussi seul au monde pour le quitter qu’en y venant.
Pourtant, curieusement, au lieu de me concentrer sur mon drame, je me
souviens de celui du Gamin, qui a cru se noyer avant de découvrir que
le Bon Dieu ne voulait pas de lui. Je me tourne subitement vers ce Dieu,
même s’il n’a jamais existé pour moi : Vous, que j'essaie maintenant
d'inventer de toutes pièces, Vous, qui imprégnez le monde entier et que
« l'on peut trouver même dans une ortie », comme disait mon oncle.
Vous inventer tout bêtement, Vous faire tomber du ciel ! Il est tard, me
dis-je, trop tard pour un tel exploit. Vous, Seigneur, il aurait fallu Vous
édifier dans mon cœur il y a belle lurette, car le Bon Dieu ne s'invente
pas. Il aurait fallu Vous extraire du fond de mon âme, Vous tailler durant
toute ma vie comme une pierre dure qui peut éclater à tout moment,
Vous polir, Vous poncer et Vous limer à l'instar d'un diamant...
Avec une sensation de plus en plus agréable, je m’assoupis en
ruminant ma prière et en constatant que j’ai déjà de la neige jusqu’aux
épaules. Cerné par ces flots d'écume blanche, je m'imagine nageant
dans une mer chaude, cette mer que je voudrais revoir une dernière fois
avant le grand voyage. Mais Il ne me laisse pas tranquille, ce Dieu muet
au cœur de marbre. Il se décide enfin à se montrer à son pauvre fils
esseulé, sous une drôle de forme et avec un drôle de comportement.
Grand, carré, des moustaches rousses et une tête hirsute, il me gifle
violemment quatre ou cinq fois de suite.
« Mais c'est la mort que frôle m'sieur Paul ! » s'écrie-t-il.
Les lèvres engourdies, je balbutie :
« Merci, mille mercis, Seigneur...
- Remerciez plutôt votre chien », réplique M. Pétré.
_
Le même soir, pour fuir le froid de canard qui règne dans le chalet,
Byzance et moi nous réfugions dans ma loge. Par chance, elle n'est
pas plus grande que la cabine d'un bateau, et la lampe à pétrole de mon
sauveur parvient tant bien que mal à la tiédir. Suffisamment en tout cas
pour que Byzance et moi ne grelottions pas sous les couvertures, que
j'ai ramassées dans le grenier et dans les chambres à coucher de mes
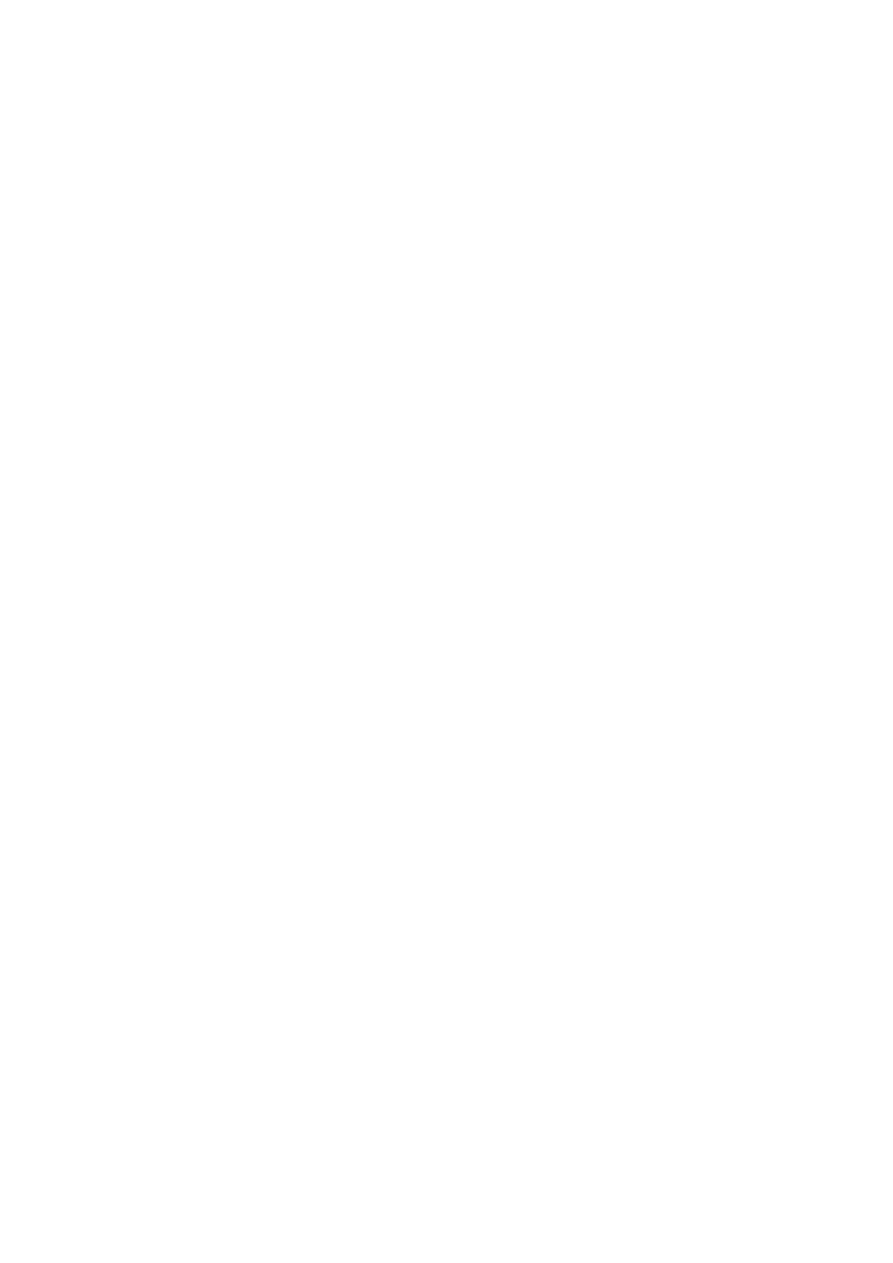
maîtres. Mon aventure m'a laissé quelques souvenirs que ni le thé au
rhum ni deux comprimés d'aspirine offerts par monsieur Pétré ne
peuvent effacer : des mains gourdes, un claquement de dents et la chair
de poule.
En vérité, c'est avant tout Byzance que je dois remercier pour ce
prodigieux sauvetage. Au dire de monsieur Pétré, c'est elle qui l'a alerté.
Se faufilant entre les jambes d'un client dans son auberge, elle s’est
mise à glapir et à japper comme une damnée. C'est elle qui lui a montré
le chemin pour rejoindre le funeste ravin où son maître maladroit était en
train de succomber à un sommeil éternel.
C'est donc elle, cette force animale de la nature, qui a lutté pour
ma survie, alors que je polissais, ponçais et limais mon diamant de
Dieu. Saisi d’une émotion poignante, je lui tends ma main droite, où,
entre l'index et le majeur, une gerçure commence à saigner.
« Comment te dire toute ma reconnaissance, Bybi ? lui dis-je dans
un murmure. C'est tout ce que je peux t'offrir, Bizou. »
Attirée par l’odeur douceâtre du sang, elle renifle ma plaie et se
met à la lécher, d'abord d’un air soupçonneux, puis avec un plaisir de
plus en plus vif, une sorte de volupté animale, comme si en elle
s'éveillait l'héritage de ses ancêtres, les bêtes fauves. Étrangement,
j'éprouve la même jouissance, comme étourdi par cette idée maladive
de lui faire cadeau de mon seul bien, les dernières gouttes de ce nectar
qui coule encore dans mes veines.
Fiévreux, je me rappelle le rite ancestral du sang échangé entre
les hommes, et je lui chuchote :
« Nos noces de sang, Bybi, une alliance fraternelle !... »
Au petit matin, à ma grande surprise, ma gerçure paraît être
miraculeusement cicatrisée. Nous sortons comme d'habitude pour une
promenade dans les alentours. Le sentier menant aux Lions de faïence
nous fait passer devant une chapelle ensevelie sous la neige fraîche en
ce troisième jour de printemps. J'ai de la peine à me frayer un chemin
jusqu’à l'une de ses fenêtres, où l’on a cloué à la hâte deux planches
croisées.
Le soleil éblouissant, réapparu après la tempête, darde un rayon
semblable à une flèche d'or à l'intérieur de la misérable cabane, laissée
à l'abandon. Le nez collé contre une vitre couverte de saleté, je jette un
regard dans la pièce, pleine de poussière et de débris enveloppés

d'épaisses toiles d'araignée. Au beau milieu de tout ce fatras de
vieilleries, je Le vois, peint sur une plaque en bois, un beau colosse à la
longue barbe chenue et à la chevelure blanc argent, pareille à la traînée
lumineuse d'une comète. Ses ailes de velours déployées, Il plane dans
l'air, tendant sa main vers celle d'un jeune homme : le Créateur est en
train d’insuffler le principe de vie au corps d'Adam. Hélas ! leurs deux
index, pointés l'un vers l'autre, n'arrivent pas à se toucher, leur mariage
a échoué à jamais, ainsi que mon intention de Le remercier de m'avoir
protégé. De même que sur le tableau, nos yeux se croisent, mais nos
doigts ne se touchent pas.
Le
cœur vide, je Lui tourne le dos en murmurant : « Il est trop tard,
le loup mourra dans sa peau ». Ce n'est qu'à ce moment, en me
dirigeant vers mes Lions de faïence, que j'embrasse la montagne dans
toute sa splendeur. J'avais pu auparavant assister à ses changements
imprévisibles et à ses caprices impétueux, à sa perfidie et à sa cruauté.
Cette fois, après une succession de violentes chutes de neige et de
jours ensoleillés, cette fois, c'est le printemps pour de bon.
Rien de plus enchanteur que cette saison au Praz-de-Lys, devant
la crête dentelée du-Mont Blanc, cette vague géante, pétrifiée entre ciel
et terre. Débordant de joie, Byzance se vautre dans un amas de neige
soyeuse, la léchant et la lapant comme un chiot. Je ne résiste pas, moi
non plus, cette fête me fait tourner la tête : agenouillé dans la poudreuse
tel un gamin, j’y goutte moi aussi, avalant toute une poignée de cristaux
étincelants. Mon regard, embué par une larme, plane sur les collines
avoisinantes, sur les lambeaux de fumée flottant au-dessus des
cheminées du village et sur les sapins qui secouent leurs bonnets
blancs, ces centenaires déconcertés, qui ont l'air de réapprendre à
siroter leur sève et à respirer.
Leur réveil subit est encore troublé par les chants et le remue-
ménage de leurs hôtes ailés, parmi lesquels les plus agités et les plus
bruyants sont les pics qui tambourinent sur l'écorce des arbres leur
hymne à la gloire de cette nouvelle vie, face aux corneilles, qui graillent
contre toute cette liesse. Ces images et ces sons à vous couper le
souffle me submergent, tandis que dans mon esprit commence à
poindre une vérité aussi simple qu'extraordinaire, très difficile à traduire,
une vérité supérieure, sortant de l'ordre de la nature mais demeurant
parfaitement naturelle.

Il est là, omniprésent, devant et derrière moi, dessus et en
dessous, imprégnant tout, ce Dieu que l'on peut trouver même dans une
ortie, si laide soit-elle, laide comme les « têtes de serpent » - ce
surnom est de moi ! -, les premières fleurs à émerger de la neige au
printemps. Le bourgeon vert demi-ouvert, une mâchoire jaune
triangulaire, ces petites plantes d'une laideur repoussante solennisent
aussi Sa grandeur en sécrétant des gouttelettes semblables à des
topazes.
Transportée de joie, les sens subjugués, Byzance se comporte de
nouveau comme un chiot, flairant avec ardeur tout ce monde frémissant
qui nous entoure. De temps à autre, la tête levée et les oreilles
dressées, elle s'immobilise et caresse des yeux de petits monticules
autour de nous. J'ai l'impression qu'elle L'entend et Le voit, que je suis le
seul, parmi tous ces animaux et végétaux, à être aveugle et sourd à Sa
présence. Aveugle-né, ayant marché toute ma vie à l'aveuglette, finirai-
je mes jours dans cette pitoyable cécité ? Je n'ai que peu de temps pour
pénétrer ce secret tout aussi simple qu'extraordinaire, l'art de la prière.
Peut-être, en fin de compte, sommes-nous nous-mêmes cette prière,
tout comme notre acte de prier : ainsi, il n'y aurait plus de différence
entre nous, solliciteurs, notre prière et celui que nous prions. La prière
serait un tout, à l'image de Dieu.
Ces paroles me trottaient toujours dans la tête en fin d'après-midi,
quand je me suis rendu à l'Auberge du Roi. Je craignais cette visite,
mais Byzance et moi avions une faim de loup. Je l’ai regretté dès que
nous avons franchi le seuil du restaurant, plongé dans une lumière
tamisée. Le plafonnier vert, allumé au-dessus de la table de billard,
n’annonçait rien de bon : la présence de la bande de Molo.
Le fait qu'ils aient déjà pris d'assaut la table de jeu me force à
m'installer le plus discrètement possible dans mon coin, près des
lavabos. La salle est pleine de la fumée irritante de leurs cigarettes à la
marihuana et, au-dessus de leur tête, ondoient des rubans bleuâtres
ressemblant à des auréoles de saints. Des saints de l'enfer, me dis-je,
en observant leurs nouveaux accessoires vestimentaires, sans doute
dérobés quelque part : des gants noirs aux mains de tous les garçons et
des bandeaux blancs ceignant leur tête, sauf celle de la jeune mère,
dont le front est paré d'une bande rouge. D'ailleurs, c'est la seule chose
qui la différencie de ses comparses : elle fume la même herbe, n'est pas
moins bruyante et est aussi ivre qu’eux. Les pleurs du bébé, blotti dans
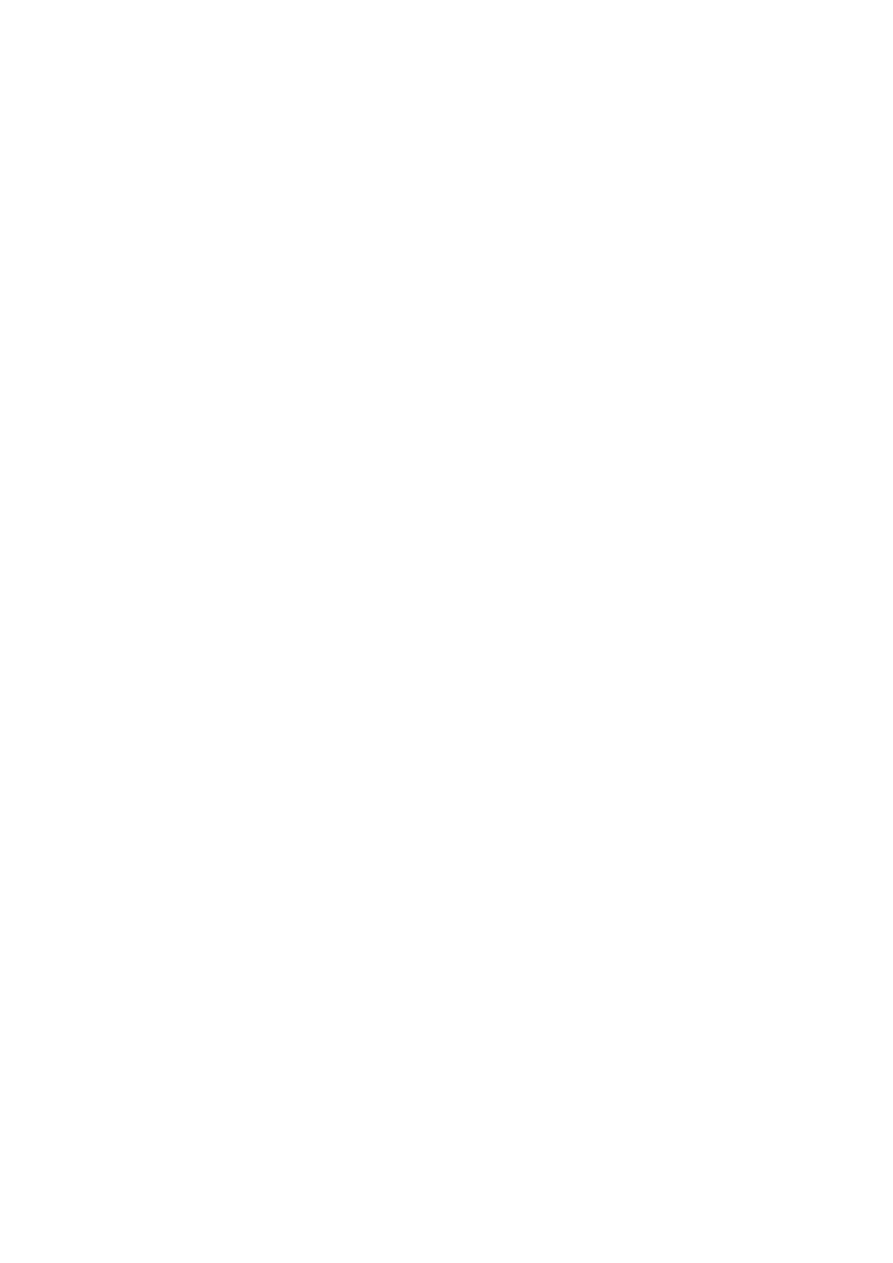
son sac tel le petit d'un kangourou, l'emportent sur la clameur des autres
vauriens.
Par malheur, je n'échappe pas au regard en coulisse de son frère,
le père de son enfant. Sa crinière jaune, fraîchement pommadée et
dressée, se dirige vers moi comme la nageoire d'un requin. Une fois
arrivé devant les toilettes d'un pas un peu titubant, il pose sa chope sur
ma table. Il sourit avec malignité et me dévisage d'un œil fou, brouillé par
la drogue et l'alcool.
« C’est mon anniversaire, pépé, me dit-il, je voudrais être
généreux avec toi. Je t'offre une partie de billard.
- C'est très gentil de votre part, monsieur, dis-je, mais je n'ai
jamais joué au billard. »
L'air subitement sombre, il se racle la gorge et projette dans sa
chope un crachat répugnant.
« Dans ce cas, pépé, rétorque-t-il, tu vas choisir : ou tu fais un
billard avec nous, ou tu ingurgites cette moussante d'un seul trait.
- Je préfère le billard », monsieur, dis-je.
La gorge sèche sous le plafonnier vénéneux, encerclé par cinq
visages cireux dans un panache de fumée, je m'efforce de ne pas
trembler de peur. Molo me laisse choisir ma queue, restant, lui, fidèle à
sa batte de base-ball, ainsi que les autres joueurs. Ils frottent la rondelle
de cuir de mon bâton avec une craie bleue. Ils me laissent aussi faire le
premier coup, le premier et, j’espère, le dernier de ma vie.
« Vas-y ! m'exhortent-ils à l'unisson. Joue par la bande !
Carambole ! Pique, pique ! Prends la bille en tête, en plein, en dessous,
sur le côté !... »
Je ferme un œil et je pique la bille rouge.
Leur hilarité m’oblige à fermer l'autre œil et à protéger mes oreilles
de leur fou rire en y plaquant mes paumes. L'un d’eux me secoue
brutalement et me force à reprendre la queue, qui a dégringolé par terre.
Cette fois, je suis fermement décidé à faire mouche : au bout du
compte, une bille de billard n'est que la sœur aînée de la simple bille de
verre que je maniais, enfant, à la perfection. Je me concentre, retenant
ma respiration, je prends cette sacrée bille rouge en ligne de mire et, de
nouveau, je ferme l'œil gauche, prêt à mettre dans le mille. Et, à cet
instant crucial, mon avant-bras tendu en avant pour lancer le manche de
la queue, la sale main d'un de ces pervers m'enfonce son majeur entre
les fesses. Sursautant comme mordu par un serpent, je manque la bille

et la pointe de mon bâton dérape sur le tapis vert en y faisant une
vilaine déchirure.
Tandis que ces vicieux rient à gorge déployée, mon protecteur, M.
Pétré, se dirige vers moi d'un pas lourd, les yeux exorbités, cramoisi de
colère.
« Ras le bol, m'sieur Paul ! peste-t-il.
- Je vous demande pardon, monsieur, fais-je, rouge de honte.
- Savez-vous, crétin, combien coûte un tel tapis ? écume-t-il.
- Aucune idée, monsieur, suis-je forcé d’avouer.
- Bon sang ! Vous allez me payer cette bêtise ! Bien que vous
n'ayez que votre cul et pas un sou vaillant en poche, vous allez quand
même vous acquitter de votre dette, vieux schnock. L'auberge est
approvisionnée en boissons tous les lundis. À partir de demain, outre
votre travail auprès de mes poneys, vous déchargerez le camion. Tous
les lundis, sans exception, jusqu'à acquittement de votre dette.
- Volontiers, monsieur », dis-je, abasourdi par un nouveau éclat de
rire des bandits.
Lorsque, suivi de Byzance, je me retrouve dans le vestibule, leur
hilarité n'empêche pas le plus jeune d'assener un coup de pied à la
pauvre chienne, qui, à la surprise générale, lui montre les dents en
poussant un grognement menaçant. Byzance, le plus doux de tous les
chiens que j'aie jamais connus, est prête à le prendre à la gorge, ce
méchant gamin, pâle comme un linge.
_
J’aurais dû m'y attendre, il n'y avait pas l'ombre d'un doute là-
dessus. Après six heures de déchargement, mon nerf sciatique ne
pouvait qu’être victime d’une inflammation comme jamais auparavant.
C'était à prévoir, mais je ne devinais pas que les lourdes caisses de
bière, de vin et autres jus de fruits allaient me clouer au lit au début de la
soirée avec une douleur insupportable dans le bas du dos et des
hanches. Ne me rappelant que trop bien ma précédente sciatique,
endurée à Paris, j'ai pris quelques précautions : j'ai rempli à ras bord les
mangeoires des poneys de farine de maïs et d'avoine concassée, j'ai
placé à côté de la gamelle de Byzance une bassine pleine d'eau, j'ai

ouvert en grand la porte de ma loge et laissé entrouverte celle qui donne
sur la terrasse, afin que la pauvre chienne puisse aller faire ses besoins
à sa guise.
Plié en deux et souffrant le martyre, j'ai passé une nuit blanche,
malgré les deux calmants avalés à minuit, les deux derniers comprimés
laissés par Mme Canac, qui était parfois atteinte de lumbago. Mon
supplice atroce m'a empêché de me rendre aux toilettes et j’ai dû faire
une chose méprisable : uriner et vomir, à cause de la douleur, à trois
reprises sur le bord de mon lit, dans le beau chapeau haut de forme de
mon défunt maître.
Comme moi, n'ayant rien mangé la veille, Byzance est sortie au
lever du jour et n'est revenue qu'à midi, en se léchant les babines,
visiblement rassasiée par les restes d’une boîte à ordures. Dix minutes
plus tard, elle a vomi à son tour et a passé la journée au pied de mon lit
dans une torpeur aussi profonde que la mienne. Le soir, à l'heure
habituelle de ma toilette, j'ai renoncé même à me débarbouiller,
incapable de mouvoir ne serait-ce qu’un peu la partie inférieure de mon
corps. Je suis donc resté allongé tout habillé, chaussé, les orteils
engourdis par le froid et les talons gonflés dans les bottes trop étroites
de M Canac.
Le jour suivant, très affaibli, j'assiste impuissant au retour de
Byzance, encore partie en vadrouille, et à ses vomissements sur le
seuil de ma chambre. Grâce au froid vif qui règne dans le chalet, les
aliments qu'elle rejette ne sentent pas mauvais. En revanche, ses selles
liquides, répandues sur la moquette, me causent beaucoup de souci,
comme la lampe à pétrole, hors de portée de ma main, qui reste allumée
jour et nuit. Le tuyau de caoutchouc la reliant au bidon de M Pétré
risque d'absorber tout le précieux combustible si je ne parviens pas à
l'éteindre. Quant à l'aubergiste, en voyage d'affaires à Annemasse
pendant deux jours, son absence ne m’inquiète pas : Jean, Pierre et
Paul auraient disposé d’assez de nourriture et d’eau pour attendre le
retour de leur maître, si celui-ci ne les avait déjà conduits à l'abattoir.
De plus en plus épuisé, le corps et l'âme broyés, je n'ai aucun
moyen d’empêcher Byzance de sortir pour ramasser une nouvelle
saleté. Seul dans le chalet, je sombre dans un état bizarre, une sorte de
rêve éveillé. Je vois le Gamin en face de mon lit, un garçon maigrelet de
neuf ans, les traits tirés, les pommettes saillantes, avec, sur son petit
menton tremblant, un grain de beauté. Je distingue sur son cou, du côté

droit, une petite glande ouverte un peu enflammée, pareille à la mienne.
Ses oreilles pendantes sont presque transparentes dans le contre-jour.
Manquant d’aplomb sur ses jambes, il déplace le poids de son corps
d'un pied sur l'autre, tout en clignant de ses grands yeux noisette.
Visiblement, il veut me réprimander, me jeter à la figure quelque faute
commise par inadvertance.
Mes prévisions se révèlent justes :
« Pauvre mendiant ! Tu es devenu un véritable gueux ! lâche-t-il.
Tu as trahi tous mes serments ! De surcroît, toi, vil écrivassier, tu as
mal traduit ma pensée.
- J’ai fait de mon mieux, dis-je, autant qu'il était en mon pouvoir.
- Le mieux est souvent l'ennemi du bien, me rétorque-t-il
froidement, blême de colère. Je devrais te châtier, mais ce n'est pas
indispensable : à l'heure de vérité, tu te puniras tout seul. »
Trop, c'est trop. Mon sang ne fait qu'un tour.
« Tu abuses de ta jeunesse, espèce de tyran vaniteux, dis-je en
criant. Je te hais, morveux, tu as empoisonné ma vie ! Formidable, n'est-
ce pas ! »
Il est trop tard pour lui clouer le bec. Il disparaît d’un coup de
baguette magique, et me laisse ensorcelé au bord de ma couche,
grelottant et frissonnant telle une feuille. La longue absence de Byzance
commence à m’inquiéter : à en juger par la position du soleil et d'après
ce qu’indique la montre empruntée à mon défunt maître, nous sommes
dimanche, dix-sept heures, jour du retour de M. Pétré d'Annemasse et
vingt-quatrième heure de vagabondage pour ma chienne. En ce
troisième jour de crise, la douleur dans mon dos s'est un peu apaisée,
ce qui me permet de descendre du lit et de me diriger, chancelant, vers
la porte grande ouverte de la terrasse.
Elle gît sur trois marches, au milieu de l'escalier, à l'endroit où elle
a poussé son dernier soupir. Derrière elle, dans la neige, une longue
trace de sang témoigne d’une tout aussi longue agonie. La fléchette
d'une arbalète saille de son cou, un de ces joujoux meurtriers que les
bandits de Molo utilisent en été pour assassiner les écureuils.
_

« Une arme de dissuasion », disait monsieur Canac.
« Vu qu'il est trop tard pour les dissuader, me dis-je, nous allons
nous en servir pour enrayer le mal. »
Lorsque j'enjambe le seuil de l'auberge, ils sont déjà là. La bretelle
de mon lourd fusil, qui me taillade l’épaule, me cause une nouvelle
douleur dans les lombes. Ils sont là, tous les cinq, accompagnés de leur
bébé en pleurs dans son sac à dos, accroché sur un portemanteau
comme un nid de faucon. Leur partie de billard bat son plein et ils ne
daignent me remarquer qu'au moment où, avec la crosse de mon arme,
je tape furieusement contre un gros vase de cuivre. Le bruit
assourdissant que je produis les fait sursauter et ils se retrouvent nez au
nez avec les deux canons de mon fusil.
Dans le silence de mort qui s'installe, j'active ma culasse mobile,
soulève les deux chiens et libère le cran d'arrêt, exactement comme le
faisait mon défunt maître. Chacun de ces gestes, qui ressemblent à des
grincements de dents, les fait trembler de peur. Sans souffler mot, je les
mets en joue, lentement, l'un après l'autre, promenant mon point de mire
d'une tête aux cheveux dressés à l’autre, d'un visage décomposé à
l’autre.
« Que faites-vous, vieux ? me demande M. Pétré d'une voix
blanche, pétrifié derrière son comptoir.
- Ils ont tué Byzance, dis-je, en ravalant un sanglot. Ils seront
punis. Œil pour œil, dent pour dent. »
Et, une fois de plus, je promène les gueules de mes deux canons
d'une face livide d'effroi à l’autre.
« Ce sont des enfants, chevrote monsieur Pétré. Méchants, mais
des enfants. »
Je n'arrive plus à retenir mes larmes et je hurle, d'une voix
étrange, aigrelette, qui ne m'appartient plus :
« Il n'y a plus d'enfants en ce bas monde ! Les enfants, c'est une
race en voie de disparition ! Ces jeunes tyrans, graine d'autrefois, sont
devenus nos pires ennemis ! »
Un petit geste de Molo, qui tapote sa batte de ses doigts,
redouble ma rage et je crie à pleine gorge :
« Tournez-vous vers le mur ! Tout le monde contre le mur, les
mains sur la tête ! »
Plus morts que vifs, claquant des dents, ils s'empressent
d'exécuter mes ordres. Un nouveau silence se met à régner, un silence

de glace, interrompu enfin par une horloge à carillon qui sonne sept fois
de suite. Pour les effrayer davantage, je plie et déplie les canons
juxtaposés de mon fusil, tout en les observant frissonner. Aussitôt, l'un
des deux jumeaux se met à glapir comme un chiot et je remarque de
grosses gouttes ruisselant le long de ses bottes pour former une flaque
d'urine autour de ses semelles. L’instant d’après, je sens une odeur
nauséabonde, émanant de l’'un de ses comparses, de son frère jumeau,
de la jeune mère, du garçon de neuf ans aux oreilles pendantes ou
même du chef de cette vermine, une odeur d'excréments que l'un de
ces couards a lâchés dans son caleçon.
Étouffant mes larmes, je m'entends marteler d’une voix stridente :
« Scélérats et poules mouillées, pauvres pleutres, assassins sans
courage ni dignité ! Je vous ferai pisser des lames de rasoir !
- Pitié, m'sieur Paul ! » chevrote l'aubergiste.
Ne décolérant pas, je me récrie :
« Pitié ? Pour ces bandits cruels ! Je pourrais leur faire sauter la
cervelle, mais ils ont de la chance !
- De la chance ? s'étonne M. Pétré.
-
Oui, dis-je. Puisque je ne dispose d'aucune cartouche. »
Mes paroles irréfléchies et lâchées à la hâte laissent les cinq
coquins interdits. Abasourdis, humiliés, morts de honte, leur visage se
crispe, blanc de colère.
« C’est ce qui s'appelle avoir une chance folle, espèce de
méprisables crapules ! » dis-je, en leur tournant le dos.
Sur le chemin qui me ramène au chalet, je traîne avec peine mes
pieds dans la neige lourde. Titubant sous le poids de mon fusil, je n'ai
qu'une seule envie, irrésistible : dormir, dormir... Pendant ce trajet, les
étranges paroles du Gamin me poursuivent : « Je devrais te châtier,
traître, mais ce ne sera pas indispensable... à l'heure de vérité, tu te
puniras tout seul !... » Dès que je pénètre dans le séjour, les yeux à
demi-fermés, n'ayant même plus la force d’atteindre ma chambre, je
m'écroule sur un canapé et succombe au sommeil, couvert d'un sac de
couchage qui sent fort ma petite Byzance.
_
Je me réveille en sursaut, échappant à un cauchemar.

Ils sont là, devant moi, coiffés de leurs cagoules, munis de battes
de base-ball. Ils me dévisagent un instant sans bouger, puis ils se ruent
sur moi en jurant et en me frappant. Le coup le plus violent, qui
m’atteint sur le haut du crâne, me projette instantanément dans une nuit
noire.
Cela ne dure qu'un très bref laps de temps, à peine une fraction de
seconde, avant que je ne me retrouve, sain et sauf, au-dessus de mon
corps, léger comme une plume, voltigeant dans l'air à la manière d'un
cerf-volant. Je suis un homme chanceux, me dis-je, content de m'être
évadé de la prison de mon misérable corps à la tête fracassée et à la
cervelle répandue, ce corps sans vie qui est en train de subir un nouvel
assaut dans la pénombre du séjour, avant que le plus jeune bandit ne
s’en approche avec ma lampe à pétrole. Je n’ai pas besoin de sa
lumière pour distinguer le visage de mes bourreaux sous leur cagoule,
leurs traits défaits, leurs yeux égarés et épouvantés à la vue de mon
cadavre.
Je suis émerveillé par mes nouveaux pouvoirs, qui paraissent
presque surnaturels : quel bonheur de planer dans l'air tel un oiseau et
de voir ce qui est invisible pour l’œil d’un mortel ! Je suis un homme
chanceux, me redis-je. C'est la première fois que j'ai l'occasion de
considérer lentement et tranquillement la face du petit dragon qui tient la
lampe allumée : ses cheveux hirsutes, ses oreilles pendantes et
transparentes telles des feuilles de chou, ses yeux noisette, sauvages
comme ceux d'un loup-cervier, son menton tremblant, marqué d’un grain
de beauté. J’ai l’impression de le connaître ou alors il ressemble à
quelqu'un que j'ai connu. Ce qu'il se prépare à faire me remplit d'un
sentiment de satisfaction, d'une joie presque enivrante : poussant un cri
perçant, il lance la lampe sur le corps immobile et se précipite vers la
sortie, talonnant ses camarades tueurs dès que la lampe se brise et que
son contenu s’embrase sur le sac de couchage.
C'est bien l'heure de vérité, me dis-je, caressant du regard le
tourbillon de flammes qui dévore le canapé de mes maîtres et son
pitoyable occupant. Grâce à la fine couche de neige qui recouvre le sol
depuis des semaines, le feu ne se propage pas et épargne les
meubles. Je prends mes aises, je me laisse bercer par le plaisir doux
qui dilate mon cœur. Évadé de prison, je savoure mon retour au foyer,
comme si, après toute une vie passée au fond d’une eau trouble, je
refaisais surface pour respirer enfin un air frais en toute liberté.

Cette jouissance devient ivresse lorsque j’aperçois, près de moi,
Byzance. À demi transparente, flottant dans le vide, elle fait un tour
autour de moi comme pour fêter nos retrouvailles, elle pose son museau
sur mon genou et contemple avec moi les flammes, qui vont réduire en
cendres le corps de l'homme qui gît au-dessous de nous. La main sur sa
nuque, je la caresse. Un seul attouchement, un seul regard nous suffit
pour tout nous dire et nous comprendre. Dans notre foyer naturel, entre
deux vies, nous ne sommes plus ni homme, ni animal, ni mâle, ni
femelle. Nous sommes plutôt une sorte d'énergie pure, une espèce
d'espoir, de promesse d’existence future.
La mort serait une aussi grande école d'humilité que la traduction
: passer d'une vie à une autre, comme on passe d'une langue à une
autre, en faisant renaître la flamme de la parole. Car l'homme, me
semble-il, n'est qu'un simple jeu de mots inventé par Dieu.
Soudain, le tohu-bohu indescriptible qui envahit le chalet me tire
de mes réflexions. Gendarmes, pompiers, secouristes et M. Pétré, à
la tête des badauds. Fièvre, agitation et confusion générale. Ceinturé
par deux agents de police à la porte du séjour, les poignets menottés,
en proie à des hoquets convulsifs, Molo, mon meurtrier et bienfaiteur,
secoue sa crinière flétrie, qui n'a rien plus en commun avec la nageoire
d'un requin carnassier. Le cœur subitement serré, j'observe ses yeux
taris, les yeux de cet adolescent, qui, depuis belle lurette, dans cette
vallée de misère, a pleuré toutes les larmes de son corps. N'ayant
aucun ressentiment envers ce pauvre hère, j’excuse sa vie de chien,
mais mon pardon, que je crie à tue-tête au moment où il part, est étouffé
par le tumulte.
Tout ce remue-ménage, fort déplaisant, ne s'apaisera que quand
le feu sera éteint et ma dépouille emportée sur un brancard, couverte
d'un joli drap blanc. Deux policiers profitent de ce bref répit pour
perquisitionner ma loge. Ils rejoignent leur supérieur à la sortie du séjour
avec la liasse de papier à musique qui m'a servi pour ma traduction et
mon porte feuille. Ils n'éprouvent aucune honte à y fouiller.
« Drôles de prénoms ! lâche celui le plus âgé. Miodrag, Marie,
Loup Janvier. »
Sans-gêne, il déplie tous mes documents.
« Figure-toi, dit-il, qu’il a payé d'avance sa propre incinération et
celle de son chien.

- Il était sans doute un peu toqué, avance son jeune collègue en
feuilletant ma liasse de papier à musique. Regarde-moi ça : il a écrit son
journal comme si c’était une partition, des mots à la place des signes de
musique, comme des notes, rondes, blanches, noires.»
Après avoir claqué la porte de la terrasse, ils entreprennent de la
clouer et leurs voix se perdent dans les coups de marteau. Je ne
connais que trop bien ce bruit. Quoiqu'il ressemble à s'y méprendre à
celui d'un cercueil qu’on cloue, je pousse un grand soupir de
soulagement, en chatouillant Byzance derrière l'oreille.
« La prochaine fois, ma belle, lui dis-je, ça ira mieux. »
Je ne me rends compte qu’alors que nous ne sommes pas seuls.
Un être volant nous aborde, luisant et plat comme un carrelet, ce
poisson qui n'a point d'envers, ses grands et beaux yeux situés d'un
seul côté de son corps. Tout comme nous, il n'a pas de sexe ou plutôt il
les a tous : homme, femme, animal, insecte, il est aussi plante, fleur,
minéral, eau, air et flamme. Je ne m'étonne pas qu’il nous souhaite une
bienvenue muette, sachant que ce n’est personne d'autre qu'un ange.
En vérité, dans cet entre-deux-vies, je sais tout sans l'apprendre, tout ce
qui m’a précédé et tout ce qui me suivra. Je reconnais notre hôte sans
me tromper : c'est l'Ange de l'Oubli, chargé d'effacer en nous tout
souvenir de notre vie passée, afin que nous puissions reprendre sans
crainte le lourd fardeau d'une vie nouvelle.
Un sourire tendre et un peu rusé aux coins de la bouche, il vient
tout près de moi pour me pincer le nez et presser légèrement de son
index le milieu de ma lèvre supérieure. Grâce à ce rite de l'Oubli, je
renaîtrai sans souvenirs comme tous les humains, portant au-dessus de
ma lèvre l’empreinte indélébile du doigt de l'ange, cette fossette que la
langue du Gamin appelle razlioubak, baiser qui divise et lie deux vies
successives, baiser du courage de vivre que nous partageons devant la
mort.
Avant de désapprendre ce mot, le nom du Gamin et les langues
que je connais, tous mes souvenirs s’embrouillant rapidement, je
m’efforce de nouveau, avant de sombrer dans l'oubli, de faire part de
ma dernière pensée à Byzance :
« La prochaine fois, ça ira mieux !.

Vouk Voutcho
ÉDITIONS DE CHAMBRE
AU PRAZ-DE-LYS EN HAUTE-SAVOIE
2003
Wyszukiwarka
Podobne podstrony:
Vouk Voutcho Enfer d un paradis
Vouk Voutcho Contes a dormir debout
Un Homme et Une Femme pdf
Beigbeder Memoirs d'un jeune homme?range
Beigbeder, Frédéric Mémoires D un Jeune Homme Dérangé
Une chance sur un million
PRS UN str 20 21 i 38 43 nr stron nadrukowane
Akumulator do?UN AK414 HW AK414 HW
Hydrant z wezem polsztywnym HW DN 25W UN LIGT SLIM
Neurobiol Ontogeneza UN
garcía márquez relato de un naufrago SHKZ4CT2UHSJNWSO5K5EW6DD2CZUIW3DGFKWLWI
5 UN obwodowy, anatomia
Pale PN + Wi un
UN wejściówka 1
Le taux? chômage atteint un niveau historique en France
un lab
3 02 Un progetto per le vacanze PARTICELLA NE e CI
Comment fonctionne un TCAS
cbd un en
więcej podobnych podstron